|
La basilique arienne de RAVENNE
"San
Apollinar Nuovo"
Photos: Bernadette PLAS & Alain DELIQUET
Texte Alain Deliquet

Une basilique ostrogothe de religion arienne.
(Un
clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec
votre navigateur.)
Au VIe siècle, la ville de
Ravenne était le foyer le plus représentatif de
l'évolution artistique de l'art chrétien, qui
est surtout oriental byzantin. L'une des
constructions les plus fascinantes de cette
époque est la basilique de "San Apollinar
Nuovo".
Théodoric, roi Ostrogothe élevé à la cour
romaine orientale, conquit Ravenne et une grande
partie de l'Italie et y établit son royaume,
respectant la ville et contribuant à sa
continuité artistique et culturelle. San
Apollinar Nuovo fut une grande église de culte
arien que l'empereur a ordonné de construire en
505 parmi d'autres édifices religieux. Quelques
décennies plus tard, une autre église dédiée
au saint patron de Ravenne, la basilique de San
Apollinar in Classe, a également été
construite.
|

|
Une basilique hérétique, revisitée cinquante ans plus
tard pour éliminer les traces ariennes.
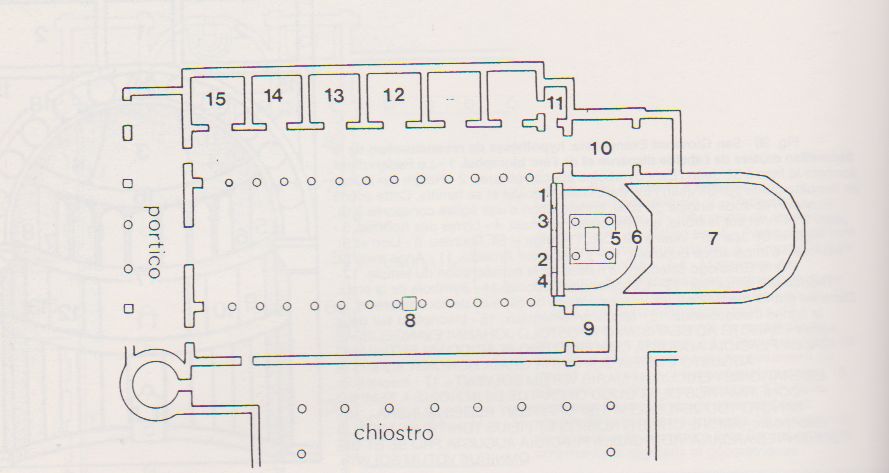 |
- 1_ Pièce du
chancel du VIe siècle
- 2_ Transenne de
paons (IIe moitié du VIe)
- 3_ Transenne de la
croix et grappes ("")
- 4_ Transenne
probablement du VIIIe siècle.
- 5_ Autel du VIe
siècle
- 6_ Chaire de marbre
- 7_ Abside d'époque
baroque.
- 8_ Ambon du VIe
siècle.
- 9 à 19 _ Chapelles
- 11_ Chapelle dite
"des reliques"
- 12_ Chapelle
Rasponi
- 13_ Chapelle
Pasolini
- 14_ Chapelle des
comtes Scala
- 15_ Chapelle de la
victoire
|
Les panneaux du chancel typiquement orientaux:




On ne pénètre pas directement dans un lieu sacré à l'époque,
un sas ou avant-nef ou narthex sépare l'entrée dans le
sanctuaire du monde profane de l'extérieur. Le narthex
actuel a été remodelé au XVIe siècle. Le campanile
date des VIIIe-IXe siècles, et sa particularité réside
dans le fait que plus la construction s'élève et plus
les ouvertures sont grandes.
La basilique est composée d'une grande nef centrale
séparée des bas-côtés par des rangées de douze
colonnes de marbre surmontées de chapiteaux corinthiens
qui se distinguent par une simplification du nombre de
feuilles d'acanthe.

On
peut remarquer la présence de la croix dans l'immense
tailloir, thème totalement absent de nos églises
romanes, où il est très rare d'y trouver des croix.
Théodoric a ordonné la décoration des murs ( et
de l'abside, _reconstruite au XVIe_ elles ont été
perdues). Destinée à "Notre Seigneur Jésus-Christ"
par les ariens, l'église fut rebaptisée "Saint
Martin" lorsqu'elle passa aux mains des catholiques
romain, altérant (d'autres disent épurant !!) certaines
de ses mosaïques, celles où notamment figuraient des
princes goths. Puis elle devint " San Apollinar
Nuovo" bien que nuovo soit
inapproprié.
Les sept espaces en chapelles, du mur Nord, sont du XVIe
siècle.
La nef est très éclairée, huit fenêtre basses dans le
mur sud côté cloître et onze fenêtres hautes de
chaque côtés.

(Un clic
ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec votre
navigateur.)
Seules les mosaïques du registre supérieur, au-dessus
des fenêtres, et celles du registre des fenêtres, juste
en-dessous, sont d'origine et n'ont pas été touchées.
La basilique montre trois registres, au sommet : 26
scènes de la vie du Christ dédiées à ses miracles et
à la Passion.
Entre les fenêtres ce sont les Prophètes, Saints et
Martyrs et au-dessous il y avait à l'origine sur chaque
mur une procession, avec côté Sud probablement en tête
Théodoric l'empereur, venant présenter des offrandes à
Jésus, en majesté, tandis que du côté Nord des
vierges précédées des mages viennent également en
procession devant la Vierge portant l'enfant Jésus.
Le registre supérieur d'époque Théodoric :
Voici
quelques scènes du registre supérieur :

Jésus conduit devant le Sanhédrin.

La
cène.

Les femmes devant le tombeau vide.
La vision mystique de ce que l'on
appelait «l'autre monde», au temps où l'on ne
dissuadait pas les chrétiens d'y croire, se
caractérise par la lumière et la densité. Cet
autre monde impossible à localiser, puisqu'il
échappe aux lois qui régissent le nôtre, est
un univers spirituel non pas désincarné,
abstrait ou fantomatique, comme on a trop souvent
tendance à le représenter, mais au contraire
prodigieusement concret ; c'est un monde sans
vide, dont la lumière résume toutes les images,
toutes les couleurs et toutes les pensées
possibles. Il est l'ultime réalité, la
réalité absolue, dont les sensations les plus
intenses de ce monde-ci ne nous donnent qu'une
vague idée. Ces deux caractères se retrouvent
en partie dans la mosaïque de Ravenne, qui est
la représentation la plus approchée de l'autre
monde que l'art nous ait jamais proposée.
(André
Frossard dans l'Évangile selon Ravenne ) |

Jésus bon pasteur probablement comme l'empereur
Théodoric ?
Un thème récurant à Ravenne.
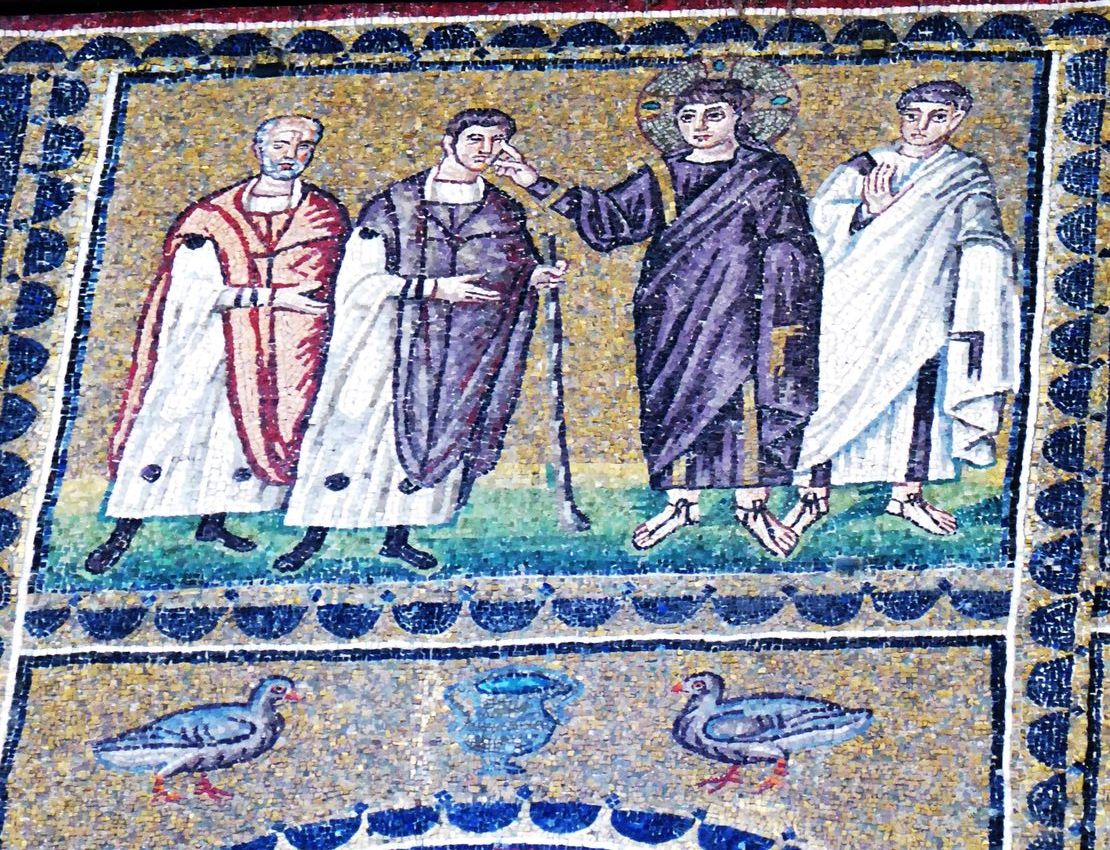
Les pèlerins d'Emaüs.
La mosaïque donne également l'impression
d'un monde sans vide, en ce sens qu'il n'y a
pratiquement pas d'intervalle (si ce n'est une
mince fissure de néant) entre ses atomes, dont
le moindre est absolument nécessaire à la
cohésion de l'image. La sensation d'entrer dans
un univers follement concret est avivée par la
discrétion du recours à la perspective, à
peine indiquée ça et là par un trait d'ombre
ou une amorce de dépliement géométrique. Le
premier effet de la perspective est de suggérer
un espace, donc un vide potentiel, et son
inconvénient spirituel majeur est de faire du
sujet humain le centre de la composition, qui s'organise
autour de lui, toutes choses contraires à la
plénitude éblouissante de la vision mystique,
phénomène d'objectivité pure dont le centre
est partout.
(André
Frossard dans l'Évangile selon Ravenne) |

La pêche miraculeuse.
Le
registre entre les fenêtres toujours d'origine
Théodoric :

(Un
clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec
votre navigateur.)
Au registre entre les fenêtres, des personnages vêtus
de blanc qui s'identifient avec des prophètes ou des
saints sur fond doré et sur fond vert.

(Un
clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec
votre navigateur.)
Le registre sous les fenêtres revisité par Justinien :
D'un côté un cortège de vierges et de rois mages et de
l'autre un cortège de Prophètes, Saints et Martyrs.
Les rois mages avec leurs noms est une mosaïque d'origine,
c'est la plus célèbre.
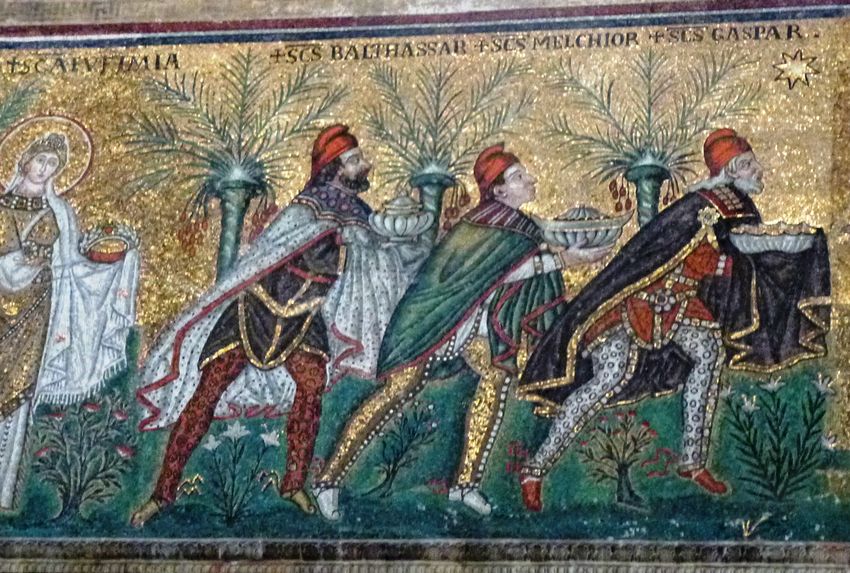
(Un
clic ou deux pour agrandir mais il faudra revenir avec
votre navigateur.)
Côté gauche 22 vierges et les rois mages,

Côté droit 26 martyrs dont Saint Martin de Tours en
premier
( il y avait auparavant Théodoric en tête du cortège
pour présenter des offrandes à Jésus.)
Quelques vierges :

Les vierges viennent en procession depuis le port de
Classe
Les Saints et Martyrs viennent du palais.
André Frossard à propos des
femmes sur les mosaïques :
(Inutile de dire que je ne partage pas ses
conclusions fortement vaticanes...)
Elles donnent la vie, non la mort, et n'ont joué
qu'un rôle bienfaisant durant toute l'existence
du Christ. Fidèles sans défaillance et par
suite choisies pour témoigner les premières de
sa résurrection, elles n'ont été pour rien
dans sa condamnation et son supplice, illustrés
sur le mur d'en face, au-dessus du défilé des
hommes. Or la fonction essentielle du prêtre
étant de dire la messe, et la messe, mémorial
de la Passion, comportant le rappel d'une
effusion de sang (... «qui sera versé pour vous
et pour la multitude»), il s'ensuit qu'elle ne
peut être dite que par un homme, ce qui n'implique
nulle supériorité, mais des vocations
distinctes. A vouloir à tout prix qu'en toutes
choses hommes et femmes soient interchangeables,
on les prive de cette différence qui les rend
indispensables les uns aux autres.
(André
Frossard dans l'Évangile selon Ravenne) |

Les mosaïques ont été reprisent par Justinien ( le fils de Galla
PLACIDA)
soit une cinquantaine d'années
après celles que THÉODORIC avait fait réaliser.
Ces dernières sont de style hellénistique romain
caractérisé par la beauté plastique et le réalisme
des gestes et du paysage. Celles de l'époque de
Justinien sont plutôt de style byzantin, les personnages
évoluent plus dans l'irréel, plus dans la dorure.
Lorsque Justinien est arrivé au pouvoir, il a éliminé
les processions royales ariennes, pour les remplacer par des
processions de Saints et de Vierges. Il a épargné la
structure du palais et du port de la ville, ainsi que les
figures du Christ, de la Vierge et de l'Épiphanie.
Voici une partie du palais de Théodoric revisitée pour
faire disparaître les hauts fonctionnaires et religieux
goths dont il ne reste plus qu'une petite main:
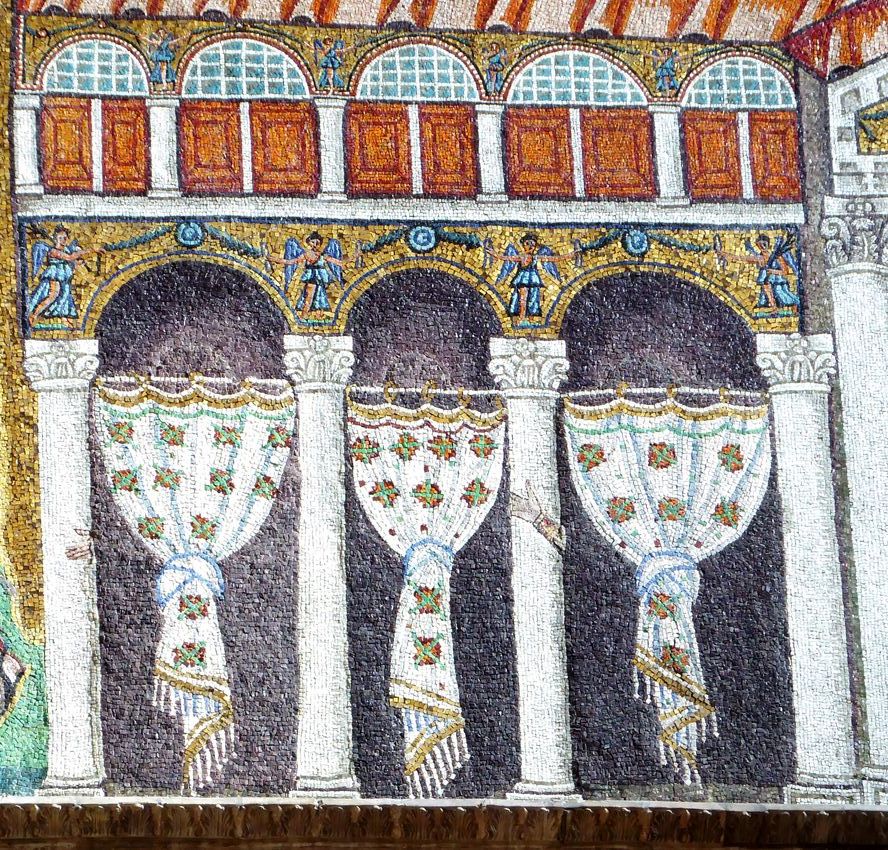
Des personnages il reste les mains sur les colonnes !
Une mosaïque se compose, on le sait, d'une
infinité de tesselles ou petits cubes
irréguliers de marbre, de pierres dures, de
verre coloré dans lequel on insère parfois une
feuille d'or ou que l'on recouvre de confettis de
nacre. La technique n'est pas sans rappeler celle
de la fresque, dans la mesure où elle exige elle
aussi une certaine rapidité d'exécution. On
trace ou l'on reporte sur le mur recouvert de
plusieurs couches de mortier et de plâtre le
dessin d'une scène ou d'un motif, on évide l'intérieur
du contour et l'on y coule le plâtre tendre dans
lequel on enfoncera les tesselles, non pas de
manière à former une surface parfaitement plane,
mais au contraire accidentée ou hérissée d'aspérités
qui feront ricocher la lumière. C'est ce qui
donne à la mosaïque vue de profil sous une
lumière oblique l'aspeâ d'une pluie serrée de
gravillons qui m'a fait parler tout à l'heure d'«averse
tombée du septième ciel». Le peintre à
fresque, technique dont la difficulté décourage
aujourd'hui beaucoup d'artistes, ne voit pas son
&oeliguvre tout de suite ; elle émerge peu
à peu de l'enduit, et les couleurs qui
apparaissent ne sont pas exactement celles qu'il
a posées, de sorte qu'il lui faut, s'il ne veut
pas avoir à constater de fâcheuses ruptures de
tons, couvrir le maximum de surface dans un
minimum de temps. Le mosaïste n'est pas exposé
au même danger, puisque ses couleurs ne changent
pas quand le support sèche. S'il ne parvient pas
à remplir le creux destiné à recevoir sa
composition dans le délai voulu, il peut ôter
le surplus de plâtre fin et reprendre son
travail plus tard sans avoir de mécomptes à
craindre. Il doit cependant travailler vite, et
il ne peut guère se corriger comme le peintre a
la faculté de le faire. Un texte officiel de l'empereur
Dioclétien nous donne la répartition des
tâches, et la valeur attribuée à chacune d'elles
: le créateur de l'illustration était
évidemment le mieux rétribué ; il fournissait
ce que les tapissiers appellent un «carton» à
un «peintre mural», qui reportait le dessin sur
la surface à décorer (son salaire était deux
fois moindre), préparée par un spécialiste,
payé au même tarif (encore un peu moins élevé)
que l'ouvrier d'art chargé de poser les
tesselles. Ce dernier n'inventait rien, certes,
mais à Ravenne il a souvent fait preuve de
génie dans l'utilisation des quarante couleurs
de sa palette, jouant aussi bien de l'irrégularité
des cubes que de leurs différences de reflets.
Les empereurs ont toujours le même défaut, ils
surestiment l'idée et sous-estiment le réel.
(André
Frossard dans l'Évangile selon Ravenne)
|

La mosaïque montrant le port est d'origine, mais les
barques ne le seraient pas.
Le port de Classe était le port de Ravenne.
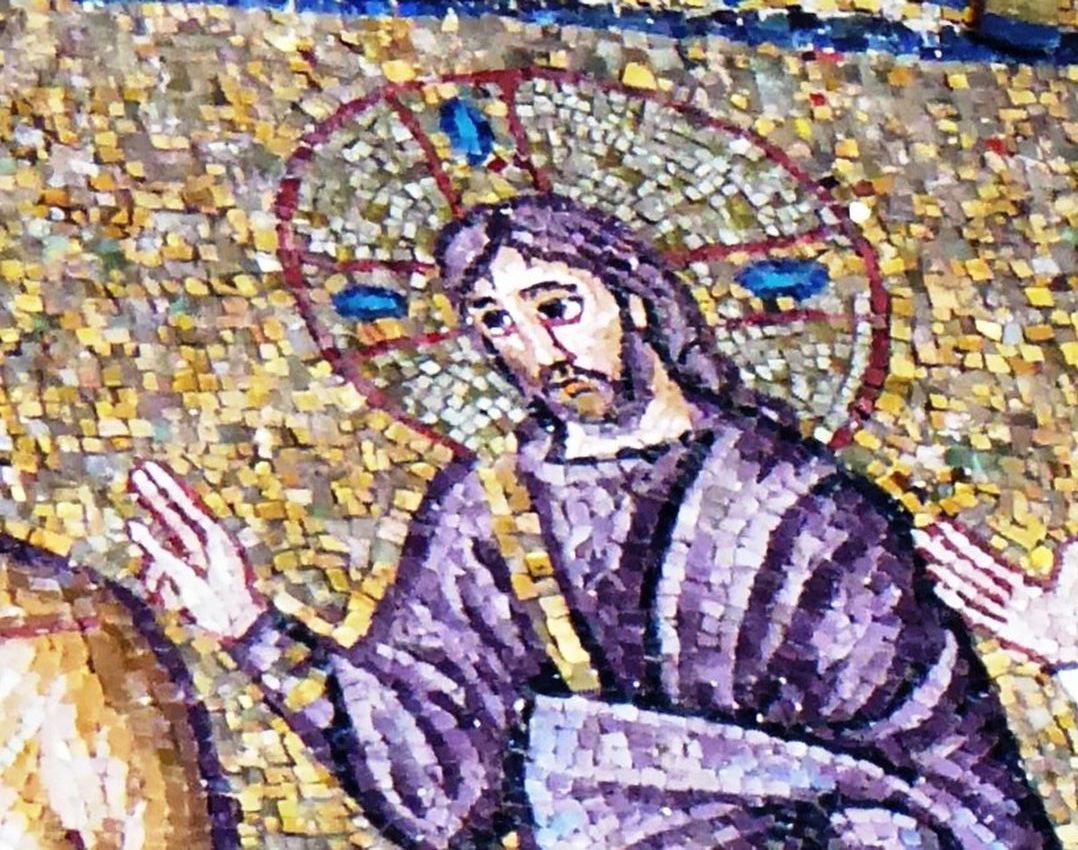
Jésus par les Ostrogoths.
.

Un
livre en français remarquable pour les photos et les
textes :
"L'Évangile selon Ravenne " aux
éditions Robert LAFFONT (épuisé)
Liens sur cet édifice :
http://masarteaun.blogspot.com/2010/11/iglesias-de-ravena-i-san-apolinar-el.html
https://seordelbiombo.blogspot.com/2017/10/san-apolinar-el-nuevo-ravenna.html
__________
Le plan du
centre de Ravenne :

Avril 2020/AD troisième semaine de confinement !

|
 Vers le Mausolée
de GALLA PLACIDIA à RAVENNE
Vers le Mausolée
de GALLA PLACIDIA à RAVENNE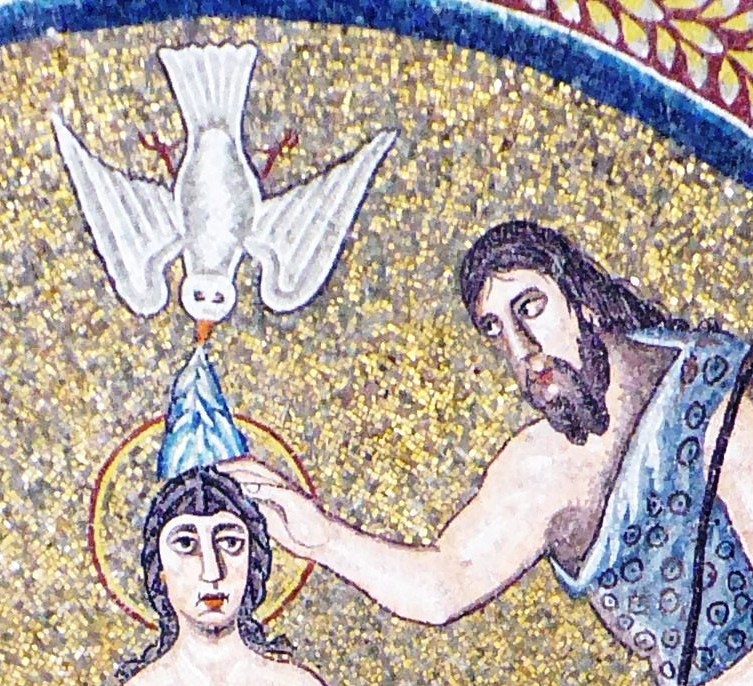 Vers le baptistère des Ariens à RAVENNE
Vers le baptistère des Ariens à RAVENNE Vers
le baptistère des orthodoxes
Vers
le baptistère des orthodoxes 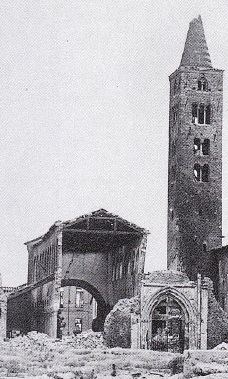 Vers la basilique Saint Jean l'évangéliste de RAVENNE
Vers la basilique Saint Jean l'évangéliste de RAVENNE