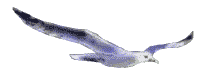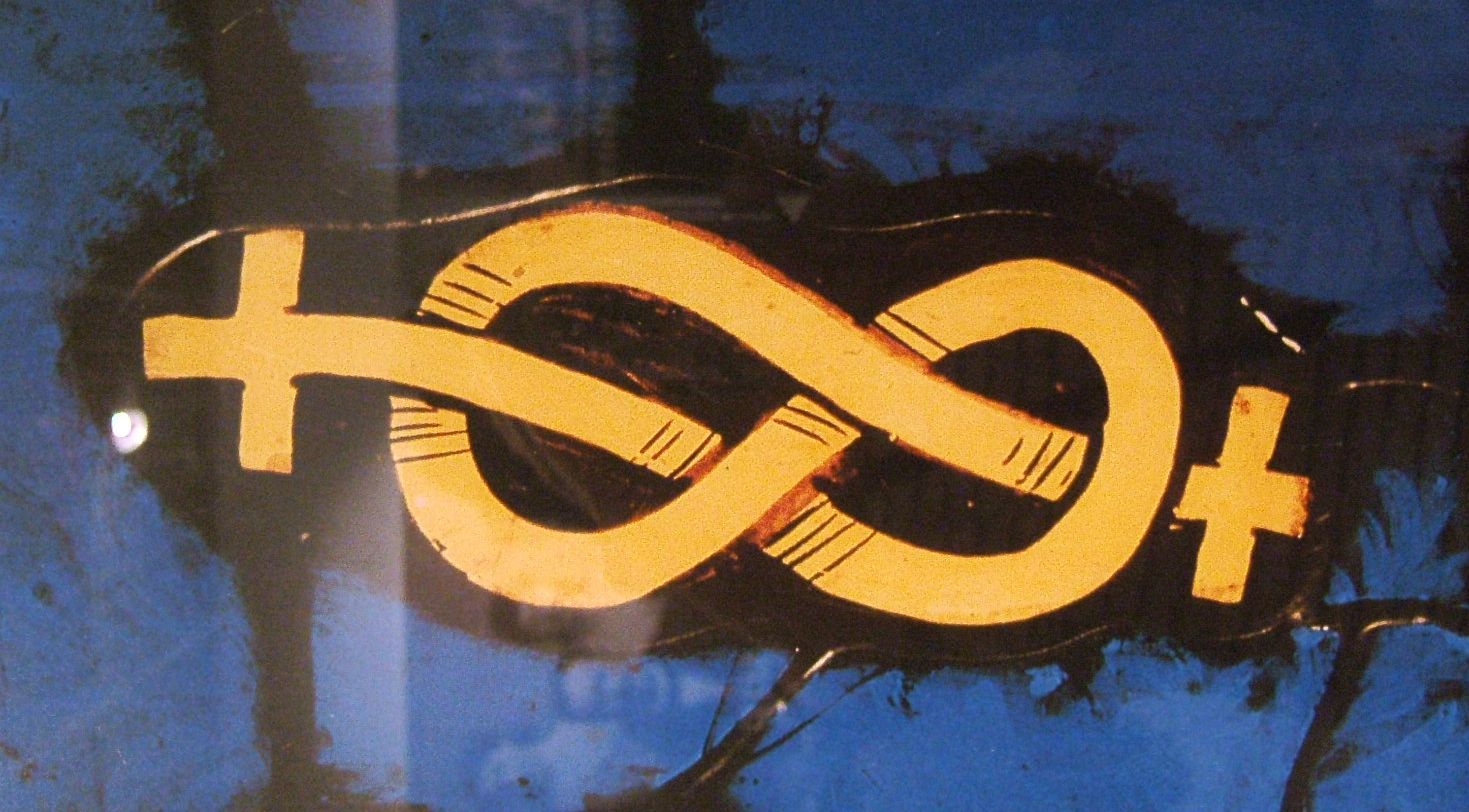|
L'église d'ALBIGNAC en Corrèze (19)
SITUATION:
Albignac
était, à
l'origine, un prieuré d'hommes dépendant de
l'abbaye de
Saint-Michel de Cluse, en Piémont. L'éloignement
de la
maison mère, et les guerres, amenèrent la
décadence du prieuré. Une bulle du pape
Clément
VI, signée en Avignon autour de 1394, rattache Albignac au
monastère de Coyroux. Albignac devient alors
prieuré
cistercien de filles. De l'église romane, qui devait compter
parmi les plus importantes de la Corrèze, ne subsiste plus
que
le clocher. La nef et le choeur actuels ont été
reconstruits à une époque
indéterminée.
Le
clocher devait
primitivement se situer sur la travée
précédant le
choeur. Au nord et au sud de ce massif apparaissent, très
mutilées, des colonnes engagées et des
départs
d'arcs correspondant certainement à des passages
voûtés qui devaient assurer la communication entre
les
collatéraux de la nef et le choeur.
Quelques chapiteaux décorés de feuillages et d'animaux fabuleux (hydrocentaures, femmes-oiseaux) subsistent encore. La travée sous le clocher est remarquable par sa hauteur : les chapiteaux sont à environ onze mètres au-dessus du sol. Ils soutiennent des arcs en plein cintre et sont portés par des colonnes engagées. La nef, le choeur et la sacristie ont été construits avec des matériaux de remploi de l'église primitive. Le mot d'un ancien maire d'ALBIGNAC: L'origine du village remonte a des temps très lointains. II aurait servi de résidence au General romain ALBINUS lors de l'invasion des GAULES et c'est de la que lui viendrait son nom qui fut d'abord ALBI-GNUS. puis ALBINHAC et enfin ALBIGNAC. Quoi qu'il en soit, c'est au Moyen-Age qu' ALBIGNAC connut son apogée. Ce fut, il y a un millénaire, le siège d'un important prieuré d'hommes, situé sur chemin de St-Jacques de Compostelle et placé sous la dépendance de 1'abbaye de CLUSES, en Piedmont. Du point de vue féodal, ALBIGNAC relevait de GIMEL jusqu'en 1164, date à laquelle il passa à la vicomté de TURENNE. La vie monastique y fut intense jusqu'au milieu du XVe siècle, mais la guerre et l'occupation anglaise qui dévastèrent et ruinèrent le pays, n'épargnèrent pas notre communauté. Les moines disparurent . Un pape limousin, Clément VI, rattacha alors le prieuré d'ALBIGNAC au monastère de filles de COYROUX, fondé par Saint Étienne d'OBAZINE, en 1142, et dont on voit encore les ruines en bordure de la route qui va d'ALBIGNAC à OBAZINE. On eut donc, a ALBIGNAC, des religieuses sous la dépendance des prieures de COYROUX. L'une de ces prieures, Jeanne de BADEFOL, fut la marraine de la plus petite de nos deux cloches, baptisée en 1604. Quelques années plus tard, en 1622, Jeanne de BADEFOL demanda et obtint du Roi Louis XIII 1'autorisation de s'installer à TULLE avec ses soeurs, connues longtemps dans cette ville sous le nom de " Bernardines ". L'heure du déclin avait sonne pour COYROUX et pour ALBIGNAC ou il ne resta plus que quelques religieuses. Les bâtiments des deux communautés furent plus ou moins laissés à l'abandon; une partie de ceux d'ALBIGNAC fut vendue après la Révolution comme bien national. Vous en verrez les restes au Sud de l'église, de l'autre côté du chemin. Avancez vers le choeur. Sur chacun des piliers du grand cintre un système d'éclairage vous permettra d'admirer les colonnes ornées de besants, les chapiteaux sculptés et la grande voûte sur lesquels dix siècles d'histoire ont passé. Vous remarquerez le maître-autel de 1'église primitive rétabli sur ses colonnes de pierre. La voûte du choeur qui s'était effondrée a été reconstruite avec les mêmes matériaux au début du XVIIe siècle.
Au fond de 1'église, un bénitier creusé dans une tête de chapiteau est classe par les Beaux-Arts; dans le mur de gauche, sous une sorte de voûte surbaissée, un sarcophage gallo-romain, deux urnes funéraires et quelques débris de pierres sculptées. Si vous n'avez pas trop le vertige, vous pouvez monter au clocher par un escalier a vis pris dans le mur, à gauche, sous la grande voûte. De là-haut vous aurez une belle vue sur la vallée et vous pourrez lire sur la petite cloche 1'inscription suivante: I H S. - M A. - S. LVPE, ORA PRO NO BIS DAME JANE PRIEURE de COYROUS, M(ARRAINE) M. M° FRANSOYS GEOFFRE, IVGE P(ARRAIN) M° FOURNET C(VRE) D'ALBINHAC 1604 A I'exterieur, vous remarquerez: dans la façade, le portail et une fenêtre romane de 1'ancienne église; au Nord et en haut des colonnes, le départ d'une voûte aujourd'hui disparue, au Sud. un chapiteau sculpté et en bas, le tracé en demi-cercle d'une absidiole. En face de vous, de l'autre côté du chemin, une tour carrée de l'ancien prieuré. Cette tour, propriété privée, renferme un escalier monumental a vis et de belles caves en voûtes d'arêtes. _ Les hommes passent, dit-on, les pierres restent. Hélas, rongées par le temps ou mutilées par les hommes, les pierres meurent aussi! C est pour préserver de ce sort malheureux celles de notre vieille église, tant de fois remaniée au cours des siècles que nous avons entrepris, Monsieur le curé et moi-même, cette oeuvre de restauration dont vous pouvez déjà apprécier les effets. II reste encore beaucoup à faire, surtout à l'extérieur, et nos moyens financiers sont très limites. AIDEZ-NOUS ! ^Votre obole, si modeste soit-elle, sera la bienvenue. D'avance MERCI! P. BROUSSE Maire d'ALBIGNAC Le panneau informatif: Classé MH partiellement, inscrit MH partiellement, protection totale. Date et niveau de protection de l'édifice 1972/02/29 : classé MH ; 1972/02/29 : inscrit MH Précision sur la protection de l'édifice Clocher (cad. B 528) : classement par arrêté du 29 février 1972 ; Église, à l'exclusion du clocher classé (cad. B 528) : inscription par arrêté du 29 février 1972 Statut juridique du propriétaire de l'édifice: Propriété de la commune AD Mars 2021
|