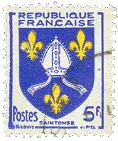|
L' église romane de DAMPIERRE-sur-BOUTONNE (17)
Texte
intégral de Charles CONNOUË DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE Commune du Canton d'AULNAY (à 7 kms au Nord-Ouest d'Aulnay et à 17 kms de Saint- Jean-d'Angély) La belle et intéressante église de Dampierre dresse sa haute façade sur le bord escarpé d'une colline au pied de laquelle se pressent les maisons du village et coule la Boutonne qui baigne les tours d'un château célèbre, ses beaux jardins et les arbres magnifiques du Tabarit chanté au XVIIIè siècle par le poète Jacques Delille.  De cette église, dédiée à Saint Pierre, édifiée au XIIe siècle, il ne subsiste des constructions anciennes que l'abside mutilée et quelques murs de la nef. La façade a été rebâtie au XVè siècle et sur le côté Sud à hauteur du chœur, a été ajoutée au XVIè siècle, une double chapelle seigneuriale au beau plafond orné de caissons. Cette chapelle communique avec l'église par deux larges baies en plein cintre.  La nef est à quatre travées vastes et dégagées. Il n'y a pas de transept, et, quoi qu'en aient dit quelques auteurs, il n'y en a jamais eu. Un simple examen le prouve. Les murs de la nef, sont percés au Sud. de trois fenêtres en plein cintre petites, étroites et très ébrasées. Celles du Nord, plus hautes et plus larges sont ornées de tores et de pointes de diamant. Sur une grande partie de ce mur Nord, court à hauteur des cintres des fenêtres, un cordon de demi-besants opposés. Une charpente a remplacé l'ancienne voûte et sans doute même les deux anciennes, la première romane, détruite pendant la guerre de Cent ans, l'autre ogivale, abattue au cours des guerres de Reli gion. Les colonnes de la nef, côté Nord, portent encore, en effet, des départs d'arcs en plein cintre et celles du côté Sud, des départs d'ogives appuyés sur de petits chapiteaux à feuillage. Un arc surbaissé, posé sur deux forts massifs à colonnes ornées de beaux chapiteaux et adossées à des pilastres très saillants, sépare la nef de la travée qui portait autrefois le clocher (remplacé aujourd'hui par une petite construction sans intérêt). Cet ancien carré couvert d'un plafond moderne cintré est éclairé par des fenêtres à colonnettes. La double ligne de besants poursuit sur son mur Nord son cheminement et se prolonge tout autour de l'abside où, par endroits les demi-disques sont remplacés par des triangles. Deux autres massifs de six colonnes séparent le carré — chœur actuel — de l'abside. Les chapiteaux ont disparu, sauf trois et ceux-ci, par leur beauté, font regretter les absents. Sur les bases des colonnes est répétée l'ornementation du cordon supérieur. L'abside en cul-de-four, plus étroite que le chœur, est éclairée par trois fenêtres semblables aux précédentes, mais elles s'appuient sur un nouveau cordon orné cette fois de marguerites. Ces diverses sculptures méritent de retenir l'attention, les romanes surtout. Les feuillages notamment sont parfaits et semblent de la même main que ceux de Nuaillé. On y retrouve la fermeté du dessin, l'élégance et la même exécution très fouillée. La qualité de cette décoration ressort davantage encore à l'extérieur de l'abside qui a conservé côté Nord d'admirables fenêtres du XIIe siècle. Elles sont chacune encadrées de faisceaux de colonnes montant du sol jusqu'à la corniche portant la toiture. Les arcs, chapiteaux, bandeaux et modillons sont remarquables. Il faut détailler spécialement la fenêtre axiale.  Une très fine « Vierge à l'hostie »,  y fait pendant à une tête de démon et voisine avec un chapiteau à trois têtes humaines — peut-être des portraits — d'un modelé extrêmement délicat. Sous le choeur existent deux caveaux. L'un était destiné à la sépulture des prêtres (une inscription encastrée sur un pilier de l'église informe que François Picart, prêtre, est enterré au pied de la muraille). L'autre était réservé aux seigneurs. Ils ont été ouverts et pillés en 1798 ; « des débris de cercueils en chêne gisaient sur le sol, les ossements étaient entassés pêle-mêle au milieu des décombres ». La nef, de son côté, pavée de dalles, funéraires est, au dire d'un chroniqueur « une véritable nécropole ». Ce monument qui, dans son état primitif devait être magnifique a été inscrit à l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de SAINTONGE (livre III épuisé) édition: R.DELAVAUD (Saintes)______avec leur aimable permission_________________________  Voici un chapiteau de Champagne (17) L'air de famille est évident, il s'agit du même symbole _ une belle femme montre des hosties _ à Champagne (17) comme à Dampierre-su-Boutonne. Vierge, ce n'est pas sûr ? Ici le sculpteur montre à gauche celui qui pourrait être son amant. Au-dessus du visage masculin le démon, entre eux la feuille creuse nouée et orientée vers le ciel, mordue par un visage qui grince des dents !! (Je pense à Abélard ((1079-1142), clerc enseignant _ donc astreint à la chasteté _ lequel enseignait dans l'université hors les murs de Paris qu'il avait crée et était très réputée. Abélard au plus haut de sa carrière a séduit ou été séduit, par une de ses élèves, Héloïse, probablement la première étudiante universitaire féminine. Ils eurent un fils Astrolabe et durent affronter de terribles épreuves et finirent leurs vies, elle comme abbesse du monastère fondé en 1131 par son mari Abélard, ce dernier comme moine. Non seulement Abélard fut émasculé pour avoir épousé son élève...mais en 1140 la théologie d'Abélard très en avance pour l'époque, fut condamnée pour hérésie.)
L'opposé
de la virginité,
la feuille
creuse, symbole du sexe féminin. Celle-ci non
seulement est orientée
vers le sol, mais elle est
|