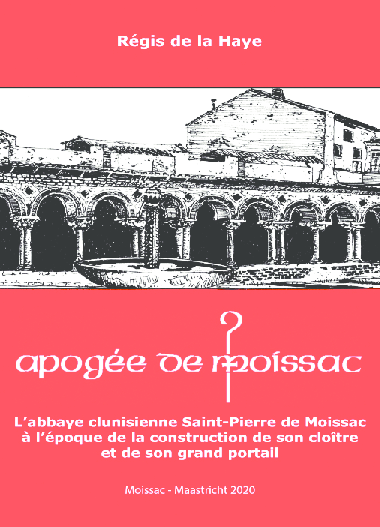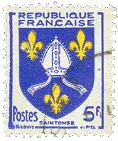Régis de La Haye
APOGÉE de MOISSAC
L’abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac
à l’époque de la construction de son cloître
et de son grand portail
_________________
PAGE 257
_________________
Relations avec la péninsule ibérique et avec l’Islam
De par sa proximité, l’abbaye de Moissac avait des relations privilégiées avec la
péninsule ibérique. Les progrès de la Reconquista étaient suivis par les moines
avec le plus grand intérêt(2). Les acquisitions en Catalogne ravivaient encore
l’intérêt pour les régions
pyrénéennes orientales. Moissac y possédait
Camprodón
et Arles-sur-Tech, pour ne citer que les établissements les plus importants, et
entretenait des relations suivies avec un monastère comme Ripoll.(3) Ensuite,
Moissac était une étape importante sur la Via Podiensis,
le chemin de Notre-Dame-du-Puy vers Santiago-de-Compostella.
Pour illustrer les relations de Moissac avec la péninsule ibérique, quoi de plus
exemplaire que la vie de saint Gérald ? La vie de ce moine de Moissac du XIe
______________
2 Guy de Valous, « Les monastères et la pénétration française en Espagne du XIe
au XIIIe siècle », in: Revue Mabillon 30 (1940), p. 77-97.
3 Juan Ainaud de Lasarte, « Moissac et les monastères catalans de la fin du XIe
au début du XIIe siècle », in: Moissac et l’Occident, p. 223-227. – Anscari Mundó, « Moissac, Cluny et les
mouvements monastiques de l’Est des Pyrénées du Xe au XIIe siècle », in: Moissac et l’Occident, p. 229-251.
_________________
PAGE 258
siècle, devenu en 1095 archevêque de Braga au Portugal, proposée en exemple à
ses frères, était lue en l’abbaye de Moissac au chapitre.(1) Gérald était né dans une
famille noble de la région de Cahors. Entré à l’abbaye de Moissac comme ‘donat’,
petit garçon (puer parvulus), il fut formé au monastère. Parce qu’il était toujours
plongé dans les livres, il fut nommé custos de la bibliothèque, là où se trouvaient
les « livres divins » (armarii in quo libri divini reponebantur custos factus est),
charge qu’il assurait durant de longues années. Mais il était aussi très érudit dans
la musique et la littérature (musicæ quoque, nec non etiam artis grammaticæ
scientia eruditus), et il enseignait ces disciplines aux autres moines.(2) La fonction
qu’exerçait Gérald était donc celle de precentor, préchantre, ou armarius, à la fois
maître des choeurs, ordonnateur de la liturgie et responsable de la bibliothèque,
office réservé généralement à un
nutritus, c’est-à-dire un moine élevé depuis
son
enfance dans l’abbaye.(3) En raison de son savoir et de son sens pédagogique, on
l’envoya vers d’autres monastères. Ainsi, il séjourna longtemps à Toulouse, au
monastère de La Daurade, au bord de la Garonne, couvent sous l’obédience de
Moissac, où il était un exemple de sainteté.
Lorsque Gérald demeurait à Toulouse, Bernard, archevêque de Tolède (1086-
1124) et ancien clunisien,4 vint à passer par là, au retour de Rome où il avait rendu
visite au pape Urbain II (1088-1099), ancien clunisien lui aussi. Ayant entendu
parler de la sainteté de Gérald, il demanda à l’abbé et à la communauté de
Moissac de pouvoir le prendre avec lui. L’archevêque l’obtint et, revenu à Tolède
avec Gérald, le nomma écolâtre et le chargea de diriger le choeur et d’enseigner
les clercs.
Or, pendant que Gérald était au service de l’archevêque de Tolède, qui était à
ce moment-là également légat du pape, le siège de Braga devint vacant. Dans le
diocèse, on ne trouva pas de candidat digne de la charge. C’est alors que
quelqu’un pensa à Gérald, dont la renommée était parvenue jusqu’à Braga. On
l’élit comme évêque. Mais il fallait
d’abord convaincre l’archevêque de Tolède,
qui ne voulait pas le laisser partir. Celui-ci finit tout de même par céder, et Gérald
__________________
1 Ursmer Berlière, L’ascèse bénédictine des origines à la fin du XIIe
siècle (Maredsous-Paris 1927),p. 9.
2 Sa vie se lit dans le manuscrit moissagais, aujourd’hui à la BNF à Paris, ms. lat. 5296 C, f. 133-
142. Éditions : Vita sancti Geraldi (BHL 3415), in : Portugaliæ Monumenta Historica. Scriptores,
vol. I, fasciculus I (Olisipone 1856), p. 53-59. – Vita beati
Geraldi, éditée d’après un manuscrit
provenant de l’abbaye de Moissac (Paris, BN, ms.lat. 5296 C, f. 133 v.), in: E. Baluze, Miscellanea,
t. 3 (Paris 1680), p. 179-205. Sur ce manuscrit, voir: Dufour 1982, p. 164-165. – J. Depeyre, « Vie
de saint Géraud », in : Bulletin de la
Société des Etudes Littéraires, scientifiques et
artistiques du
Lot 63 (1942), p. 37-51, 153-158. – Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, t.
20, col. 835-837 [J. Mattoso]. – Voir aussi : Patrick Henriet, « Géraud de Braga († 1108) : la
problématique Vita d’un moine-évêque grégorien entre Moissac et Braga (BHL 3415) », in :
Cahiers de Fanjeaux 48, 2013, p. 81 - 111. – Voir aussi: Jean Depeyre, « Introduction à la vie de
saint Géraud, archevêque de Braga (1096-1108) », in:
Bulletin de la Société des Etudes du Lot 62
(1941), p. 227-232 ; et 63 (1942), p. 37-51 et 153-158.
3 Noreen Hunt, Cluny under Saint Hugh 1049-1109 (Londres 1967), p. 62-63.
4 Hunt, o.c., p. 176-177.
_______________
page 259
fut ordonné évêque. Telle est du moins la version de la Vita Geraldi; la réalité a
dû être plus prosaïque: Braga, pas encore reconnu à cette époque comme
métropole, était soumis au primat de Tolède.(1) Celui-ci a certainement voulu
imposer un candidat de son choix.
À Braga, où il entra en fonctions le 3 juillet 1095, tout était à refaire. Le
diocèse, resté longtemps sans pasteur, était
ruiné, les affaires étaient à l’abandon,
le peuple retombé dans les crimes et les péchés. Gérald se mit au travail. Il
commença par la formation des prêtres, qu’il fit vivre en communauté. Ensuite,
il s’agissait de relever l’église, restée
à l’abandon depuis que son prédécesseur,
Pierre, avait été déposé par
l’archevêque de Tolède pour avoir accepté le
pallium
des mains de l’antipape Clément III (1080-1100). À cette occasion, le siège de
Braga, jusqu’alors archiépiscopal, avait été dégradé. Pour que le siège retrouve
son ancienne dignité, Gérald se rendit à Rome et reçut le pallium des mains du
pape Pascal II (1099-1118). En 1103, Braga fut restitué comme siège
métropolitain.
Gérald fit preuve d’une intense activité pastorale et missionnaire. Il convertit
une multitude innombrable d’hommes et de femmes. Il n’hésitait pas à faire des
tournées pastorales dans les montagnes, pour prêcher, confirmer les gens et
consacrer des églises. Mais il n’oubliait pas pour autant la vie de prière. De sa
période monastique à Moissac, il avait gardé la bonne habitude de se lever au
milieu de la nuit pour chanter les matines. Après cet office, il restait seul dans
l’église pour prier jusqu’au lever du soleil. Ensuite, c’est avec la plus grande
dévotion qu’il s’approcha de l’Eucharistie. Il ne parlait pas pour ne rien dire et il
se gardait des bavardages (la scurrilitas de l’abbé Durand !).
La vie de Gérald fut marquée par de nombreux miracles, mais aussi par
quelques tentatives d’investiture laïque qu’il s’empressa aussitôt de réprimer avec
vigueur. De son vivant, il prédit que Maurice, évêque de Coimbra, lui succéderait
sur le siège de Braga; preuve, selon son biographe, que saint Gérald possédait le
don de prophétie ! Mauritius Bordinho ou Burdinus, lui aussi bénédictin français,
succéda bien à Gérald comme archevêque de Braga, mais le don de prophétie
avait des limites, car Gérald n’avait pas prévu que ce Maurice, à la mort du pape
Pascal II en 1118, se ferait élire antipape sous le nom de Grégoire VIII ! Cela
prouve tout au moins que la Vita Geraldi a été écrite avant 1118... Maurice
Bordinho alias Grégoire VIII finit bien tristement. Il fut emprisonné en 1121, et
on n’a plus jamais entendu parler de lui.
Gérald mourut au cours d’un de ses voyages pastoraux dans les montagnes. Il
fut enterré dans sa ville de Braga, dans l’église Saint-Nicolas, qu’il avait
construite et consacrée lui-même. Plusieurs guérisons miraculeuses eurent lieu
sur sa tombe. L’un de ces miracles concernait précisément l’auteur de sa
biographie, l’archidiacre Bernald, qui se présente lui-même comme étant
Français. Il avait été appelé à Braga par Gérald. Ce Bernald ou Bernard devint
_____________
1 DHGE, t. 10, art. Braga (Alfredo Pimenta).
___________
PAGE 260
évêque de Coimbra de 1128 à 1147. Saint Gérald mourut en 1108. Sa fête est
célébrée le 5 décembre. Jusqu’à ce jour, une chapelle de la cathédrale de Braga
lui est dédiée, et saint Gérald y jouit toujours d’une grande popularité. Moissac
non plus ne l’a jamais oublié. L’anniversaire de Geraldus archiepiscopus était
porté dans l’obituaire de l’abbaye au 5 décembre.(1) Et jusqu’à nos jours, le nom
de Gérald ou Géraud est donné à de jeunes Moissagais.
C’est en Espagne et en Languedoc que se nouaient les relations avec les
musulmans (2)
et avec les Juifs, implantés dans des communautés très nombreuses
et d’une haute culture. On sait que les Xe et le XIe siècles constituent l’âge d’or
pour les Juifs. Dans la péninsule ibérique, grâce à la symbiose
culturelle judéoarabe, ils bénéficiaient
d’une position particulière. Dans le midi de la France,
où
ils n’étaient nullement inquiétés, ils participaient pleinement à la vie publique.
Abraham ben Isaac, né à Montpellier vers 1100, mort à Narbonne en 1179,
docteur talmudiste et kabbaliste, connaissait le Séfer Yetsira (Livre de la
Création).(3) Les Juifs occitans étudiaient les mathématiques, l’astronomie, la
médecine et la philosophie. Leur curiosité intellectuelle les distinguait de leurs
coreligionnaires ashkénazes du nord de la France, qui, eux, mettaient la pensée
talmudique au-dessus de la philosophie. Dans le domaine de l’exégèse aussi, les
Sépharades possédaient une large avance sur leurs frères du nord.(4) Les
philosophes juifs étaient influencés par les écoles musulmanes du Calame, des
Sunnites, du néo-platonisme, de l’aristotélisme (déjà) et quelquefois les
enseignements gnostiques et chrétiens.(5)
Malgré un vernis antisémite, les intellectuels catholiques entretenaient des
relations plus suivies qu’on ne le pense généralement avec les rabbins et les
exégètes juifs. Convaincus de l’hebraica veritas, des docteurs chrétiens
étudiaient l’hébreu et
l’exégèse juive.(6) A Tolède, où nous
rencontrions déjà le
moine moissagais Gérald, se développait après la reconquête sur l’islam en 1085,
un centre intellectuel de première importance, où traducteurs juifs et musulmans
publiaient en latin les oeuvres d’Aristote,(7) ouvrages que l’abbaye de Moissac,
plus tard, possédera dans sa bibliothèque. C’est encore en Espagne que Pierre le
___________________
1 Axel Müssigbrod, Joachim Wollasch, Das Martyrolog-Necrolog von Moissac/Duravel.
Facsimile-Ausgabe (München 1988 = Münstersche Mittelalter-Schriften, 44), p. XL + facsimile f.
95v.
2 Philippe Wolff, Histoire de la pensée européenne. 1. L’Eveil intellectuel de l’Europe (Paris 1971
= Points Histoire, 2), p. 219-232.
3 Rémy Cazals, Daniel Fabre (dir.), Les Audois. Dictionnaire biographique (Carcassonne 1990),
s.v. Abraham ben Isaac.
4 LexMA, t. 5, art. Juden, -tum (H.-G. v. Mutius).
5 Josy Eisenberg, Une histoire des Juifs (Paris 1970), p. 230-234.
6 A. Graboïs, « The Hebraica Veritas and Jewish-Christian Intellectual Relations in the Twelfth
Century », in: Speculum 50 (1975), p. 613-634.
7 Maurice de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, t. 1 (Louvain-Paris 19346
), p. 67-71, 77-78.
_______________
PAGE 261
Vénérable, abbé de Cluny, fit traduire le Coran en latin.(1) Dans le nord de la
France, à la même époque, les relations entre
exégètes chrétiens et juifs étaient
aussi étroites. A Paris, les Victorins profitaient de la présence, dans la capitale,
d’une importante communauté juive, dont les rabbins professaient une exégèse
influencée par Rashi.(2) Ainsi, Hugues de Saint-Victor († 1141) consultait des
maîtres juifs, et André de Saint-Victor († 1175) apprenait l’hébreu et prenait des
cours chez les rabbins.(3)
Inversement, on voyait des rabbins invités dans les
monastères pour donner des cours d’exégèse. Etienne Harding fit appel à des
maîtres juifs pour corriger le texte de la Vulgate.(4) Les exégètes juifs, notamment
les élèves de Rashi (1040-1106), “ont entretenu un dialogue continuel avec leurs
collègues catholiques” ;
(5) Samuel ben Meir (Rashbam), petit-fils de Rashi,
apprenait le latin pour pouvoir étudier l’exégèse catholique.(6) Ces bonnes relations
entre intellectuels chrétiens et juifs, qui dans le midi de la Gaule passent par
l’Espagne, ne se détérioraient qu’après 1160 environ.(7)
À l’abbaye de Moissac aussi, on recherchait la hebraica veritas. Dans un
manuscrit moissagais du XIIe
siècle figure un alphabet hébraïque complet,
accompagné de l’indication de la valeur numérique des lettres.(8) Dans ce même
manuscrit, un dessin montre le roi Sédécias s’adressant à Jérémie, qui porte un
phylactère portant un alphabet hébraïque (9)complet, de א à ת.
Autre témoignage de l’influence espagnole: l’usage que nous avons relevé dans
de nombreux actes moissagais du XIe
siècle, non seulement ceux concernant
l’Espagne, mais aussi des actes se rapportant à des biens situés dans le Quercy,
de dater d’après l’ère d’Espagne, qui commence au 1er janvier 38 av.J.C., année
de la conquête de l’Espagne par les Romains. Cette façon de dater les diplômes
ne se rencontre qu’en Espagne “& dans nos Provinces méridionales de France,
qui furent soumises aux Visigoths”. (10) L’usage de l’ère d’Espagne fut aboli
progressivement à partir du XIIe siècle.(11)
Enfin, témoin privilégié des relations étroites avec l’Espagne: les influences
stylistiques, marquées par l’art islamique, que l’on reconnaît à certains chapiteaux
_________________________
1 Domni Petri Venerabilis abbatis vita altera, in: PL 189, col. 50.
2 Graboïs, o.c., p. 619-623.
3Jean Châtillon, « Les écoles du XIIe
siècle », in: Pierre Riché, Guy Lobrichon (dir.), Le Moyen
Âge et la Bible (Paris 1984 = Bible de tous les Temps, 4), p. 181-184.
4 Graboïs, o.c., p. 617-618.
5 Aryeh Graboïs, «
L’exégèse rabbinique », in: Pierre
Riché, Guy Lobrichon (éd.), Le Moyen Âge
et la Bible (Paris 1984 = Bible de tous les temps, 4), p. 252.
6 Ibidem, p. 253.
7 Dominique Barthélemy, Nouvelle histoire de la France médiévale. 3. L’ordre seigneurial, XIe-XIIe
siècle (Paris 1990 = Points Histoire, 203), p. 176 et 187-189.
8 Paris, BN, ms.lat. 1822, f. 41v.
9 Paris, BN, ms.lat. 1822, f. 42r.
10 L’art de vérifier les dates [..] (Paris 1770), p. xvi-xvii.
11 A. Giry, Manuel de diplomatique (Paris 1894), p. 91-94.
______________
PAGE 262
du cloître. On pense d’abord au célèbre “chapiteau coufique”, ce chapiteau de la
galerie nord, dont le tailloir porte une décoration qui fait penser à des caractères
coufiques. L’auteur du Quercy Roman croit pouvoir y lire une inscription
signifiant ‘Louange à Dieu l’Unique’.(1) Mais ne s’agit-il pas plutôt d’une
décoration végétale, au mieux pseudo-épigraphique, comme le pensent les
spécialistes de l’Institut du Monde Arabe à Paris ? (2). Katherine Watson voit dans
l’inscription une invocation du nom d’Allah.(3) Mais cette dernière ne déchiffre
qu’une partie de l’inscription, et laisse une partie importante sans explication.
Quoi qu’il en soit, le chapiteau “coufique” de Moissac s’inscrit dans un ensemble
d’inscriptions coufiques et de motifs stylistiques islamiques dans tout le sud de la
France (Le Puy, Lavoûte-Chilhac, etc.) et le nord de l’Espagne, qui témoignent,
c’est évident, d’une forte influence islamique dans l’art.(4) Lee Sook Lee-Niinioja
relève que cinq chapiteaux du cloître de Moissac, entre autres le chapiteau dit
« coufique », présentent sur leur corbeilles le même décor de fleurs d’acanthe,
que l’on trouve aussi à l’identique sur des chapiteaux à Huertos, Loarre et
Frómista, tous lieux situés sur le chemin de Compostelle, une décoration qu’elle
attribue à une influence musulmane.(5)
Il est indéniable que l’art hispano-islamique a marqué Moissac, et que cette
influence a pu suivre les grandes voies de pèlerinage.(6) Les moines copiaient des
motifs ornementaux figurant sur des étoffes, des tapis, des soies d’Orient ou des
ivoires d’Espagne.(7) Dès 1834, Prosper
Mérimée s’étonnait « de
l’analogie que
présentent certains chapiteaux avec ceux de plusieurs édifices mauresques ». (8)
Le tailloir du chapiteau de David et les Musiciens auteurs des Psaumes porte une
décoration qu’Anglès retrouve au cloître de Silos en Espagne, qui fut peut-être
décoré par des artistes arabes. Il y voit des ressemblances avec « des animaux du
même genre sur un coffret musulman exécuté en 1026, provenant du trésor de
Silos, aujourd’hui conservé au Musée de Burgos ». (9) Momméja signale des
ressemblances entre le tailloir du chapiteau de la Transfiguration et un chapiteau
sassanide du palais de Tag-è-Bostan.(10) On trouvera dans le cloître d’indéniables
______________________
1 Quercy Roman, p. 133.
2 Lettre du 4 septembre 1989,
de Mme Hana Chidiac, chargée d’études
épigraphiques à l’Institut
du Monde Arabe (Paris), à l’auteur de ces lignes.
3 Katherin Watson, « The Kufic Inscription in the Romanesque Cloister of Moissac in Quercy:
Links with Le Puy, Toledo and Catalan Woodworkers », in: Arte Medievale 1 (1989), p. 7-27.
4 Quitterie Cazes, «
À propos des ‘motifs islamiques’ dans la sculpture
romane du Sud-Ouest », in :
Les Cahiers de Cuxa 35 (2004), p. 167-176.
5 Lee Sook Lee-Niinioja,
« Religious and intercultural influence on mozarabic capitals in
the SaintPierre abbey church cloister », in :
Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra (2014).
6 Guy de Valous, « Les monastères et la pénétration française en Espagne du XIe au XIIIe siècle »,
in: Revue Mabillon 30 (1940), p. 96.
7 G. Gaillard, « Cluny et l’Espagne dans l’art roman du XIe
siècle », in: Bulletin Hispanique 63
(1963), p. 153-160.
8 Mathieu Méras, « Mérimée en Tarn-et-Garonne », in: BSATG 102 (1977), p. 64.
9 Auguste Anglès, L’abbaye de Moissac (Paris s.d.), p. 82.
10 ADTG, Ms 225 (fonds Momméja) n° 233.
______________
PAGE 263
influences stylistiques hispano-mauresques.
Dans sa thèse et dans un article y faisant suite, Ruth Maria Capelle met en
évidence l’influence exercée par l’iconographie islamique sur un certain nombre
de motifs, figurant sur les tailloirs de La Daurade de Toulouse et du cloître de
Moissac, représentant des oiseaux, des lions, des griffons en conflit.(1) L’auteur,
tout en remarquant que ces motifs n’ont pas de modèles dans l’art chrétien, et
sont d’évidence empruntés à l’art islamique espagnol et sicilien du Xe et du XIe
siècle, insiste sur le traitement original que reçoivent ces motifs islamiques à La
Daurade et à Moissac. En outre, les motifs islamiques sont repris d’une façon très
différente à La Daurade et à Moissac.(2) Comme le souligne encore cet auteur, s’il
est vrai que le sculpteur moissagais reprend des modèles, il y attache une toute
nouvelle signification. Ainsi, les lions, de vainqueurs deviennent des vaincus.(3)
L’auteur reconnaît le thème de la lutte, du conflit, ce que je me garderai bien de
contredire, car je suis de son avis. Mais ma démarche méthodologique diffère.
Ruth Maria Capelle utilise la méthode comparative, chère aux historiens d’art, et
reste ainsi à la description stylistique. Je préfère, quant à moi, la méthode
historique qui, dans le cas présent, sera d’abord patristique.
Tout cela témoigne de l’unité culturelle dans une vaste région
méditerranéenne, englobant le royaume latin de Jérusalem, le royaume normand
de Sicile, la France du sud et le nord de l’Espagne, là précisément où « la
confrontation entre le monde chrétien et le monde islamique était très vive ». (4)
La confrontation avec l’islam a beaucoup apporté à l’iconographie romane en
général, et à celle de Moissac en particulier. Elle a aboli les derniers restes
d’archaïsme et imposé le réalisme artistique. « La nouvelle mentalité profane,
aussi bien que l’approche réaliste visible dans la description d’un thème
religieux n’ont pu naître que dans les conditions particulières d’une zone
délimitant une frontière avec l’Islam ». (5) Nous reviendrons encore sur
l’importance et la signification de l’essor du réalisme dans l’art.
Relations avec la Terre Sainte ...
____________________
1 Ruth Maria Capelle, « The Representation of Conflict on the Imposts of Moissac », in: Viator 12
(1981), p. 79-100 + 35 fig.
2 Ibidem, p. 93.
3 Ibidem, p. 94.
4 Nurith Kenaan, Ruth Bartal, « Quelques aspects de l’iconographie des vingt-quatre Vieillards dans
la sculpture française du XIIe
s. », in: Cahiers de Civilisation Médiévale 24 (1991), p. 233-239.
5 Ibidem, p. 239
|