|
L'église
romane de
SAINT-PIERRE-TOIRAC
dans
le QUERCY
Elle est considérée comme l'une des
pièces majeures du patrimoine médiéval
du Haut-Quercy, tant du point de vue de l'architecture
que de celui de
la sculpture.
Texte de Marc THIBOUT avec mes remarques en rouge
Photos de Alain DELIQUET

Les
photos sur ce site peuvent être utilisées
exclusivement
à des fins non commerciales après autorisation et
sous
réserve de mentionner la source: "http://chapiteaux.free.fr/"


Historique
D'après une tradition. l'église et le
lieu de Saint-Pierre-Toirac (1) furent donnés en 889 au
monastère Saint-Sauveur de Figeac par Caumont,
évêque de Rodez. En 1146 l'église
dépendait toujours de ce même monastère,
ainsi.qu'en 1244, date où l'on trouve le titulaire du
bénéfice mentionné dans la charte
d'élection d'Aimar à l'abhatiat de Saint-Sauveur (2).
Dès le IXe siècle, il aurait donc existé une
église à Saint-Pierre-Toirac et fort de cette tradition,
on a voulu .retrouver dans certains chapiteaux à entrelacs
des restes de ce premier édifice,
restes réemployés dans une construction plus
récente (3). C'est là une hypothèse qui ne semble
pas devoir se vérifier par la facture même des entrelacs
sculptés sur les chapiteaux et si l'on songe, que, dans le
Quercy notamment, on rencontre de nombreux exemples de chapiteaux de ce
type, non seulement bien après l'époque carolingienne,
mais encore a la fin du XIe et même au XIIe siècle.
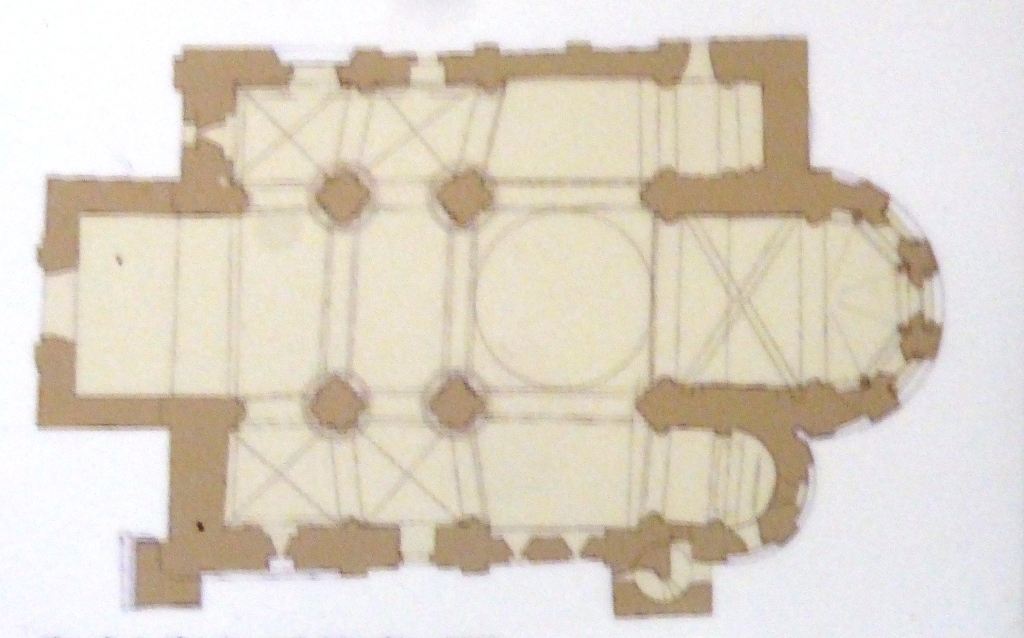
Les deux absidioles qui ouvrent sur les croisillons du transept sont
incontestablement les parties les plus anciennes de l'église;
tous les détails de leur architecture permettent d'en attribuer
la construction avec vraisemblance au milieu du XIe siècle. Mais
comment ces deux absidioles se rattachent-elles au reste de
l'édifice? Deux solutions se présentent à l'esprit
: ou bien elles constitueraient le début d'une construction qui,
faute de ressources peut-être, aurait été
menée très lentement, l'ensemble de l'église ayant
été élevé eu.plusieurs campagnes ; ou
bien elles appartiendraient à un édifice du XIe
siècle qui aurait été détruit et dont on
aurait conservé des parties plus ou moins importantes en le
relevant de ses ruines.
La seconde hypothèse
séduit bien davantage lorsque l'on constate la gaucherie
d'exécution révélée par le plan, gaucherie
qui peut s'expliquer facilement par le fait que le
maître d'œuvre aurait été
gêné par les fondations et les vestiges d'un
édifice antérieur dont il voulait tirer parti.
Actuellement, même une étude minutieuse ne permet pas de
déceler avec certitude ce qui reste de la construction du XIe
siècle, car les murs, par suite de travaux postérieurs et
de rejointoiements successifs, interdisent de tirer de l'appareil toute
déduction. Cependant, nous sommes tentés de croire que le
mur de façade, dont l'épaisseur est considérable
et, qui n'est à l'aplomb d'aucun des murs latéraux, alors
qu'il se situe dans le même axe que les absidioles, appartient
à l'édifice du XIe siècle.
Au XIe siècle
remontent aussi les parties basses des murs qui séparent le
chœur des chapelles latérales.
Un peu plus récents, mais antérieurs, cependant, au
remaniement de l'église, seraient les chapiteaux et les colonnes
qui limitent la travée droite du chœur, ainsi que quelques
éléments de décoration réemployés
dans le cordon mouluré qui passe à l'appui de la
fenêtre latérale sud, enfin les petits personnages
sculptés sur les claveaux des branches d'ogives de là
voûte.
C'est dans la deuxième moitié du XIIe siècle que
l'on peut placer le remaniement supposé et l'achèvement
de l'édifice. Mais, là encore, deux mains, sinon deux
campagnes, se révèlent. Le chœur et le transept,
où l'on retrouve des chapiteaux à feuillages
entrelacés ou à figures diffèrent assez
sensiblement de la nef dont les piles offrent des feuilles plates et
divers motifs plus évolués mais un peu maladroitement
exécutés, de sorte que, s'il est possible que peu
d'années séparent ces deux parties de l'édifice il
est à peu près certain qu'elles ne sont pas dues au
même maître d'œuvre.
Enfin achevée, l'église du XIe et du XIIe siècle
demeure sans grand changement jusqu'à une époque qui,
pour le Quercy tout particulièrement, fut extrêmement
troublée, le milieu du XIVe siècle. Les Anglais, en
effet, maîtres de l'Aquitaine, faisaient de continuelles
incursions dans les pays environnants et, en 1356, nous voyons leurs
troupes assiéger Cajarc, l'actuel chef-lieu de canton de
Saint-Pierre-Toirac (4). Quoi de plus naturel alors pour les habitants
que de songer à se protéger, eux et leurs biens, contre
l'envahisseur, et l'église, par sa masse même
et moyennant certains aménagements, ne pouvait-elle pas
devenir l'abri le plus sûr? C'est donc à cette
époque, étant donné surtout que les détails
de l'architecture viennent à l'appui de l'histoire, qu'il
faut placer les travaux qui changèrent totalement l'aspect
extérieur de l'édifice.
Un premier projet semble avoir reçu un commencement
d'exécution : l'élévation d'un clocher
fortifié sur l'absidiole du croisillon nord ; ainsi en
témoignent la disparition de la partie circulaire de cette
absidiole, remplacée par un mur plat, et les corbeaux qui. sur
une longueur de quelques mètres, font saillie à
l'extrémité du mur nord de l'église. Mais, sous
les menaces toujours grandissantes, l'idée d'un simple clocher
fortifié parut sans doute insuffisante ; un repentir eut lieu et
en même temps que l'on consolidait et renforçait les
anciens murs, on établissait sur tout le pourtour de
l'église de hautes murailles qui firent du monument un
véritable donjon. En cas de danger, les habitants transportaient
dans l'église leurs biens les plus précieux et se
logeaient au-dessus des voûtes (5) ; ils pouvaient
même y séjourner; un puits ayant été
aménagé à l'intérieur de l'église
(6).

Une enceinte, probablement le mur du cimetière, ajoutait encore
à la défense ; elle n'est plus guère visible
aujourd'hui, à l'exception de la porte, qui demeure le seul
moyen d'accès à toute une partie du village et à
l'église elle-même.
Le porche qui précède la façade occidentale ne
présente aucun élément de datation ;
l'épaisseur des murs laisse à penser que ce n'est pas une
construction toute récente ; peut-être remonte-t-il au
XVIIe ou au XVIIIe siècle. Plus tardivement, il reçut sur
la face ouest un petit portail de style classique, au fronton duquel
est inscrite la date de 1827 (7).
Intérieur

L'édifice, de dimensions
assez restreintes, comprend une nef de deux travées seulement,
accompagnée de collatéraux qui s'y raccordent
irrégulièrement, un transept non débordant sur
lequel ouvrent deux chapelles, un chœur d'une seule travée
droite que termine une abside à cinq pans inégaux.

Les absidioles témoignent d'une évidente
parenté de style. Les larges doubleaux en plein cintre qui en
limitent la partie droite et supportent la voûte en berceau ne
comportent qu'un seul rouleau non mouluré ; ils retombent sur
des colonnes engagées dont les bases se composent tantôt
d'un simple empâtement sur lequel se profilent des festons
ou des losanges plus ou moins frustes, tantôt de trois tores
égaux superposés, tantôt, enfin, de deux gros tores
que séparent des figurines ou des torsades. Quant aux
chapiteaux, larges et massifs, ils sont ornés pour la plupart de
beaux entrelacs auxquels se mêlent ça et là des
feuillages; parfois, cependant, l'artiste a renoncé aux
entrelacs pour se hasarder aux scènes iconographiques :

ainsi,
à l'entrée de l'absidiole nord, on reconnaît un
personnage à haute coiffure, assis sur un trône et
encadré de deux soldats armés d'une épée,
symbole sans doute d'une scène de justice ;
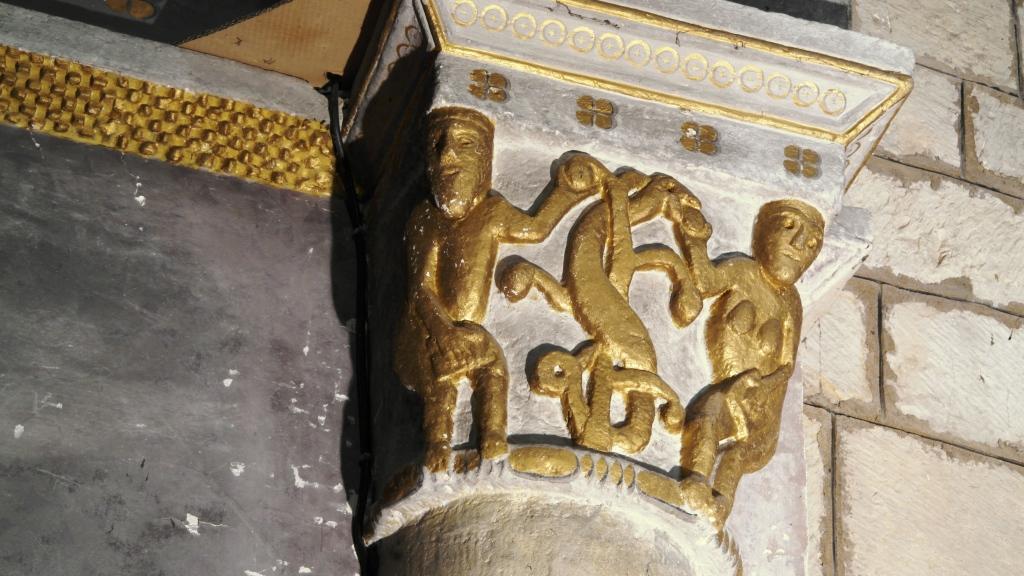
dans la chapelle
sud, ce sont, d'un côté, Adam et Eve encadrant l'Arbre de
la Science, autour duquel s'enroule le serpent,

de l'autre un homme qui
porte sur le dos un animal dont les caractères morphologiques
permettent de reconnaître un loup.
(C'est le vieil-homme barbu qui peine à marcher sur l'astragale _ l'Église et sa communauté _
dans la voie spirituelle à cause de son animalité...comme
il est en face d'Adam et Ève cueillant le fruit défendu, qui
n'est plus celui de la science, mais le péché de chair
à l'époque, la connotation sexuelle est induite.)
Ces sculptures sont, en
général, assez grossières et

(
la corde est le symbole de la communauté des clercs et les
damiers ou marches d'escalier à gravir sont signe de
progrès à faire)
la main s'y montre
moins habile que dans l'exécution des entrelacs ou des lignes de
damiers qui décorent les larges tailloirs et se poursuivent tout
le long du mur à la naissance des voûtes.
Les chapelles communiquent avec le chœur par des passages en plein cintre.
Le chœur est formé d'une large et unique travée et
d'une abside polygonale, La différence d'axe et le raccord
visible de l'abside sur les murs de la travée
droite prouvent l'antériorité des parties
basses de celle-ci par rapport à celle-là ;
néanmoins, toutes les parties hautes de la travée droite,
excepté, comme nous l'avons dit plus haut, les chapiteaux qui
supportent les arcs doubleaux et quelques autres remplois,
appartiennent depuis la naissance des deux grandes fenêtres
latérales — l'homogénéité dans la
décoration est là pour le prouver — à la
même campagne de construction que l'abside elle-même. Les
quatre grosses colonnes engagées qui limitent la travée
du chœur diffèrent de celui-ci par l'ornementation des
chapiteaux :

ici, entrelacs et feuillages encadrent une torsade
crucifère ;
(Les représentations de croix commencent après les croisades, l'influence orientale est flagrante ici)

là, ils dessinent une sorte de grillage d'un
assez heureux effet;
(Ce sont enfermées dans des cages, ce que j'ai appelé les feuilles creuses dans mon glossaire,
elles sont le symbole des relations interdites aux clercs)
ailleurs,

(Des
moines et non des anges, qui iront au ciel, car ils ne sont pas dans le
péché, leurs mains _ symbole des actions _ sont dans la
lecture ou copie de livres saints )
ce sont deux anges aux larges ailes qui
tiennent de gros livres. Les tailloirs, plus ou moins
élevés, n'ont aucune décoration, à
l'exception d'un seul, sur lequel sont sculptées de grosses
boules.

Deux baies amorties par un arc trilobé, rappel lointain
peut-être d'influence auvergnate, ajouraient les murs
latéraux ; elles durent être bouchées au moment
où l'on fortifia l'église, car, du fait même de la
fortification, elle ne donnaient plus que sur les combles ; les
piédroits sont ornés de colonnettes.

Une voûte sur croisée d'ogives couvre l'ensemble de la
travée. Ces ogives ont une forme assez archaïque : elles se
composent de larges claveaux de section carrée et la voûte
n'a pas, à proprement parler, de clef : le claveau central de
l'une des ogives a reçu, exemple peut-être unique, deux
encoches dans lesquelles viennent s'emboîter les deux branches de
l'autre ogive. Ce système assez défectueux marque
cependant un progrès sur celui qui consiste à faire buter
obliquement sans encoche les branches de l'une des ogives sur l'autre
ogive. C'est une plus grande compréhension du rôle de
la croisée d'ogives : le maître d'œuvre a voulu
parer à la tendance qu'ont normalement les branches d'ogives,
lorsque la voûte est ainsi dépourvue de clef, à
glisser l'une contre; l'autre au moindre mouvement de la construction
(8).
Des colonnettes logées dans un retrait du mur de chaque
côté des baies trilobées, reçoivent les
ogives ; la position un peu singulière de ces colonnettes
porterait à les croire ajoutées, mais elles sont
absolument du même type que leurs voisines et que celles de
l'abside ; rien n'autorise donc à admettre pareille supposition.
Les ogives à profil carré se rencontrent principalement
dans les voûtes du midi de la France ; c'est au milieu et
à la seconde moitié du XIIe siècle
qu'appartiennent la plupart des voûtes ainsi construites (9).
La
réfection du chœur, par le caractère
même de la voûte, se place donc dans la deuxième
moitié du XIIe siècle.

(Remarquez les arcades en dents de scie que d'habitude l'on ne trouve qu'à l'extérieur )
A la même campagne de construction appartient aussi l'abside. Les
trois pans du mur de fond sont, ajourés de fenêtres prises
sous une arcature en plein cintre, bordée de dents de scie ;
cette arcature se continue, mais aveugle, sur les deux autres pans.
Toutefois, la dernière arcade du côté nord est
brisée, car, en raison du désaxement de l'abside par
rapport à la travée droite, le pan nord est moins large
que celui qui lui fait face au sud. Les colonnettes qui supportent la
série d'arcades ont leurs bases cerclées d'une torsade et
leurs fûts sont de section polygonale ; chapiteaux et tailloirs
épousent la forme de l'angle auquel ils s'adossent et soulignent
ainsi les pans de la voûte, qui s'amortissent ensuite en
cul-de-four. L'infinie variété des motifs de feuillages
entrelacés qui chargent les corbeilles dénote une
recherche décorative.

(Les
léonins sont la force virile du moine représenté
au centre, celle-ci doit être maîtrisée, ce que
montre la position de la queue passant entre les pattes et se dirigeant
vers le ciel. Sinon c'est la force virile qui prend le dessus, ce que
montre le léonin maîtrisant la tête du clerc avec
ses pattes. Voir queue, maîtrise, pattes )
Si certains chapiteaux du transept portent encore des motifs analogues,
d'autres sont historiés. Là, un homme entouré de
deux lions dont les pattes de devant reposent
et peut figurer Daniel dans la fosse aux lions ;

ailleurs, cinq
personnages debout, qui tiennent par les bras, semblent mimer une danse.
(
C'est la chaîne humaine, la solidarité et l'entraide
entre moines de la communauté, celle-ci les
empêchera de
se faire dévorer l'âme comme le montre les deux
médaillons, où l'on voit les forces viriles
léoniennes engoulant leurs âmes. En effet on ne
représente pas encore l'enfer à l'époque, on est
positif, on cherche à élever l'âme positivement et
non par la terreur... Remarquez les dents qui pour une fois ne sont pas
en dent de scie, mais plutôt en boules ? Plus loin un chapiteau
sera rempli de telles boules,)
)

Une coupole couvre la croisée ; elle est moderne, comme on peut
s'en rendre compte à l'extrados de la voûte, mais les
pendentifs sont primitifs.
Des grandes arcades qui supportent cette coupole, les unes, affectent
la forme du plein cintre, les autres sont légèrement
brisées ; les voûtes en berceau des croisillons en
épousent les différents tracés.
La nef elle aussi, reproduit cette disposition : au nord doubleaux du
collatéral et grandes arcades sont brisés ; an sud. ils
demeurent, en plein cintre. Toutefois, on ne peut envisager une bien
grande antériorité d'un côté par rapport
à l'autre, mais tout au plus supposer que l'on a commencé
par monter les arcs du sud avant ceux du nord. La nef, en effet, est
une construction homogène : les piles sont des massifs à
ressauts irréguliers, flanqués de colonnes
engagées : les bases sont moulurées de deux tores
égaux séparés par une gorge.

Les chapiteaux,
assez frustes, s'ornent surtout de feuilles plates plutôt
esquissées que sculptées, parfois accompagnées de
petites figures qui se détachent aux angles de la corbeille.

Les collatéraux, couverts de voûtes d'arêtes,
offrent les mêmes caractères, à l'exception d'un ou
deux chapiteaux qui portent des sortes de palmettes ou des
rangées de dents de scie. Cependant, si le style de cet ensemble
est uniforme, le plan, par contre, comme nous l'avons
déjà noté, est fort irrégulier. En effet,
un décalage très sensible des supports des
bas-côtés par rapport aux piles de la nef a
entraîné la déformation des travées de ces
bas-côtés, déformation encore accrue par le
fait que les murs latéraux ne sont pas perpendiculaires au
mur de façade, Or, comment peut-on expliquer que l'on
ait placé si peu en face les unes des autres les demi-colonnes
destinées à recevoir les arcs-doubleaux des
collatéraux? L'hypothèse la plus naturelle serait de
penser que l'on éleva d'abord les murs extérieurs, puis les piles, en utilisant
peut-être pour celles-ci des fondations antérieures, et
que le raccord s'en trouva défectueux ; mais un détail
prouve que pareille supposition est en partie inexacte : les
demi-colonnes des piles tournées vers les bas-côtés
n'ont pas été placées dans l'axe même de ces
piles, mais ont été repoussées de manière
à racheter le plus possible la déviation. Donc, si
dès la plantation des piles, on s'est préoccupé de
redresser le gauchissement prévu des arcs-doubleaux, pourquoi
n'avoir pas établi l'ensemble de la pile de façon
à éviter entièrement ce gauchissement? Or,
cela n'était pas possible, étant donné
l'espace compris entre le mur de façade et la croisée du
transept, car celle-ci eût été rectangulaire et non
carrée, ce qui aurait empêché de monter une
coupole. En résumé, on est amené à
former l'hypothèse qu'après avoir
élevé les murs en utilisant ou non des vestiges
antérieurs, on établit les piles de manière
à laisser la largeur nécessaire au transept, mais en
s'efforçant, par le déplacement des demi-colonnes, de
redresser un peu l'obliquité des travées des
collatéraux.
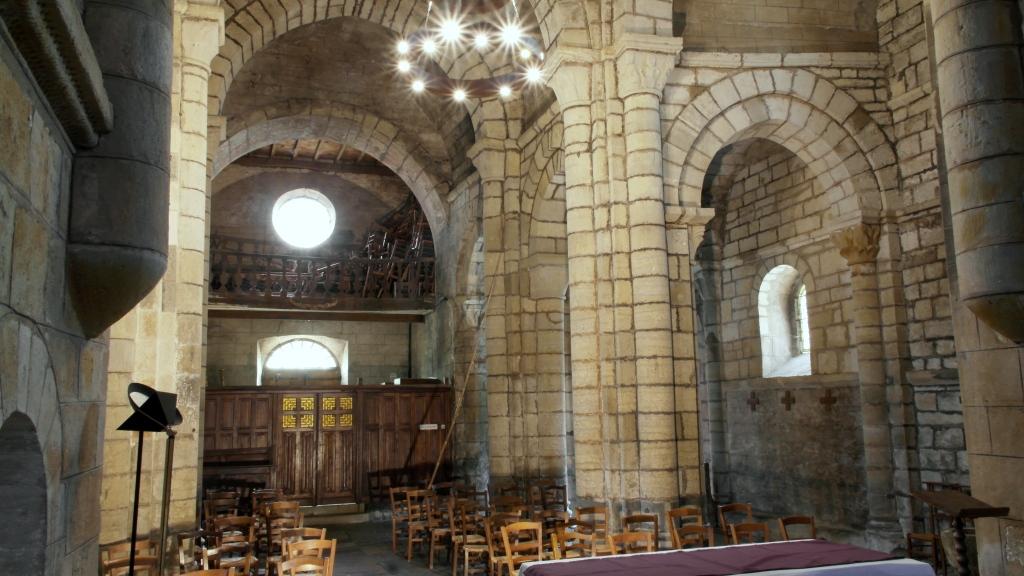
Le porche qui précède la nef ouvre largement sur celle-ci
et forme une petite travée supplémentaire,
voûtée, comme le vaisseau central, d'un berceau
brisé.
La nef, par son mode d'élévation, par sa
décoration, par ses arcs tantôt brisés,
tantôt en plein cintre, paraît devoir se placer vers le
milieu du XIIe siècle, mais, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, il est difficile d'admettre que ce
soit le même, maître d'œuvre qui s'employa à
reconstruire l'église entière; le chœur, en effet,
par sa voûte d'ogives encore très primitive, quoique
d'une technique déjà recherchée, n'a pu être
conçu que par un homme de la nouvelle école,
désireux de mettre en pratique les plus récents principes
; la nef, au contraire, bien que très voisine du chœur par
la date, sinon contemporaine, est l'œuvre d'un traditionaliste
construisant selon la vieille formule du pays : avec son vaisseau
central obscur, sa maîtresse voûte en berceau, ses
voûtes d'arêtes sur les collatéraux, elle se
rattache à la formule de la grande école, encore qu'assez
mal définie, qui s'étend au XIIe siècle de
Toulouse à Poitiers ; ces deux méthodes de construction
méritent d'être soulignées et ajoutent encore
à l'intérêt de ce petit prieuré
bénédictin.
Extérieur

A l'extérieur, si ce
n'était l'abside, qui n'est pas englobée dans les
fortifications, rien ne permettrait, au premier abord, de
découvrir l'église romane ; on se trouve en
présence d'un énorme cube de pierre, véritable
donjon dont les hautes murailles nues ne portent d'autre
décoration que les créneaux et les merlons qui en
découpent le faîte. Cependant, un examen plus attentif
révèle la présence d'étroites
fenêtres encadrées de petits contreforts plats qui
rappellent, dans la partie basse des murs, que l'on n'est pas
uniquement devant une forteresse; enfin, dans la seconde
travée du collatéral sud ouvre un petit portail en plein
cintre dont le tympan a été arraché et
encastré par la suite dans le mur latéral nord du porche.

La sculpture de ce tympan, bien conservée, représente un
personnage qui chevauche un lion et, semble-t-il, lutte avec lui.
tandis qu'en arrière un arbre sur lequel est perché un
oiseau figure probablement la forêt et qu'en face un ange
nimbé brandit une croix. Rien, dans les légendes des
saints locaux, n'éclaire la signification de cette scène
; peut-être faut-il y voir une corrélation entre l'Ancien
et le Nouveau Testament : Samson et le lion symboliseraient
celui-là, l'ange et la croix celui-ci ; quoi qu'il en soit, ce
thème iconographique est assez étrange et rare.
(Ce
thème est un clin d'oeil à Samson terrassant le
dragon. Samson, l'oing de Dieu, qui a vaincu le lion tient sa force de
Dieu, mais c'est une femme qui l'a anéanti. L'histoire est
developpée au transept de l'église d'AULNAY, le
thème de Samson maîtrisant le lion n'est pas rare mais
omniprésent!!.
Il symbolise le combat spirituel, celui que le moine doit accomplir
pour vaincre et dominer la force virile, donc son attirance pour les
femmes. Le volatile dans les branches qui sont des rinceaux est un
complément qui symbolise la victoire après les
chutes et progrès dans le parcours de la vie spirituelle du
moine. L'ange à droite lui montre la croix et les
évangiles... il est en train d'exorciser le moine au prise avec
son vice, ou bien lui montre la route à suivre ...)
Les murs
de l'absidiole sud. sur lesquels se dressent, des contreforts de faible épaisseur, ne portent aucune
décoration, pas plus que les étroites fenêtres en
plein cintre chargées d'éclairer l'intérieur de
cette absidiole. Des modillons à figures, aujourd'hui
très détériorés, couronnent le mur, que
surmonte la fortification du XIVe siècle.
L'abside polygonale est épaulée de larges contreforts
plats qui se prolongent en arcs de décharge et renforcent par
là même la partie supérieure du mur; ceux-ci,
d'ailleurs, ainsi que le couronnement lui-même, d'un appareil
assez différent, semblent résulter de travaux
postérieurs. Les fenêtres, en plein cintre, sont
ornées aux piédroits, selon le principe adopté
déjà à l'intérieur, de colonnettes aux
chapiteaux décorés d'entrelacs et aux bases garnies de
torsades. Le haut mur de défense passe d'une chapelle à
l'autre en s'appuyant sur l'arcade qui sépare l'abside de la
travée droite du choeur.
Signalons enfin pour achever la
description rapide de l'extérieur un assez large portail en
tiers-point, percé au XIV e siècle dans son le mur
de la première travée du collatéral nord. Le choix
de l'emplacement n'en a peut-être pas été
laissé au hasard, car ce portail est situé dans le
même axe que la porte de l'ancien cimetière et, en cas
d'attaque soudaine, ces deux portes largement ouvertes devaient
permettre à la population de se précipiter en masse dans
l'église et d'éviter de la sorte un encombrement funeste.
Aujourd'hui très détérioré, ce portail est
bouché dans toute la hauteur par une assise de briques.
Nous voudrions, pour terminer, montrer les rapports de l'église
de Saint-Pierre-Toirac avec les monuments qui l'environnent. Outre le
chœur et la nef. qui sont dans l'esprit du pays, l'un par sa
croisée d'ogives très caractéristique de celles du
midi de la France au milieu du XIIe siècle, l'autre par sa
traditionnelle élévation, le plan est bien celui de
tout un groupe d'édifices de la région, pour la plupart
prieurés bénédictins : aux églises du
Bourg, de Montjaux, de Castelnau-Pégayrolles, à la
chapelle de Perse, on retrouve un transept plus ou moins
débordant, sur les croisillons duquel ouvrent des
absidioles, un passage, souvent-bouché par la suite, entre
ces absidioles et le choeur, un choeur d'une seule travée
droite terminé par une abside polygonale ou ronde.
L'arcature décorative qui englobe les fenêtres de
l'abside et pour entrer davantage dans les détails, ces
chapiteaux qui. par leur corbeille et leur tailloir, accusent l'angle
du mur auquel ils s'adossent sont aussi un caractère commun
à plusieurs églises du Quercy et du Rouergue. Enfin, et
surtout, par ses fortifications, l'église de Saint-Pierre-Toirac
s'apparente à nombre d'édifices du midi de la
France, et plus particulièrement à sa voisine,
l'église de Rudelle. entièrement construite au XVe
siècle. Elle constitue un des plus intéressants
exemples de ces églises transformées ou
construites pendant la guerre de Cent ans dans un but défensif,
et ses vicissitudes en font à plus d'un titre une
véritable page d'histoire locale.
_____________________________________________________________
(1) Gant, de Cajarc, arr. de Figeac, départ, du Loi.
(2) Longnon, Pouittés du diocèse de Cahors, p. 129, 11° 463.
(3) J--A. Delpon, Statistique du Loi, 1S31.
(4) Denifle, La désolation.des églises... en France, Paris, 1899, in-80, p. 272.
(5) Voir Raymond Rey, Les vieilles églises fortifiées du midi de la France, Paris, 1925, gr. in-8n.
(6) Ce-puits existe toujours; il est situé au milieu du carré du transept.
(7)
Le Service des Monuments historiques vient de faire supprimer la
sacristie accolée à l'absidiole sud du transept, sacristie qui
défigurait le chevet du monument.
(8) V. Lasteyrie, Architecture éthique, t. I, p. 247.
(9) Marcel Aubert, Les plus Bail, mon., 1934, p. 16.
_________________________ Source du texte:Gallica.bnf.fr
________________
 Faisons parler quelques chapiteaux Faisons parler quelques chapiteaux
 |
Sous un tailloir en marches d'escalier à gravir...
sous des feuilles à 4 pétales, symboles de beauté terrestre
La feuille creuse
elle est presque toujours nouée comme ici
Remarquez les 4 stries sur l'astragale entrecoupées par des motifs presque ronds.
Mots clés:noeud, feuillages, orientation, quatre, escalier, boule |
 |
Le même chapiteau de face
L'"X" de l'interdit a été mis en valeur, il suffit de
suivre les extrémités, celle du haut forme une feuille
tournée au sol, elle se prolonge par une tige qui fait encore 5
"X" pour se terminer par une feuille dirigée vers le ciel qui
emprisonne un creux.
A l'époque ce thème omniprésent parle aux clercs !
|
 |
La suite :
Les mêmes tiges que sur le chapiteau précédent
montent en tresse pour former un entrelacs, duquel des tiges
s'échappent pour enfermer la feuille creuse ou bien plutôt
la sublimer.
Dans les angles ces tiges forment deux feuilles composées de
feuillettes lancéolées, adoubées par quelque
chose qui me fait penser à des pattes de léonins.
Mots clés:entrelacs, feuilles lancéolées, feuille creuse |
 |
J'y vois la version primitive style XIe
de l'ensemble des chapiteaux précédents.
Le but à atteindre c'est l'atlante qui supporte l'église
et l'Église au figuré, transposé en entrelacs
Le danger représenté par le léonin, la force virile qu'il faut maîtriser
transposé en feuille creuse à mettre en cage. |
 |
Deux zones séparées par un texte où l'on peut lire PETRUS (Pierre) et IOAN(E) (Jean)
M probablement pour Marie ou METE pour Mathieu ?
M ETE CITE ?
(Je prend toute suggestion)
Dessus, dans la spiritualité ou bien l'éternité,
un entrelacs léché ou bien nourrissant des
léonins. C'est "le but à atteindre" ou bien le contraire: des
léonins mangeant le symbole de la vie éternelle.
(Les sculpteurs aiment choquer comme les graphistes !)
Dans le registre inférieur des têtes léonines
léchant ( elles aiment) ou crachant ( elles tentent) des
feuilles creuses.
Les têtes naissent d'un ensemble de "X"
"le danger ou l'écueil"
|
 |
La suite sur le chapiteau suivant est aussi à 2 registres
Le danger au dessus avec des têtes diaboliques
La communauté solidaire et unie luttant devant ce danger
_ les moines se tiennent les uns les autres telle une chaîne humaine classique _ |
 |
La maîtrise
Le moine tient par ses mains _ses actions _ les barbes qui symbolisent le vieil-homme en lui.
Remarquez à droite le retournement ou conversion intérieure, à droite signe d'évolution.
Cette posture dans la scène classique des mains maîtrisant les vices est pour moi unique.
Mots clés: barbe, vieil-homme, retournement, conversion
|
 |
Un chapiteau unique en son genre
sans liens apparents avec d'autres chapiteaux..
|
A.D. mai 2023
|
|
 Vers l'album JQ
Vers l'album JQ
 Vers l'album JQ
Vers l'album JQ
Retour "ART ROMAN en
SAINTONGE"