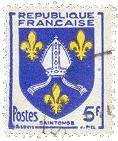|
L'abbatiale de NANT en ROUERGUE (12)
Commune
du departement de l'Aveyron ( NANT 12230)
Il semble que l'on ait fait en sorte de les multiplier à l'extrême en accroissant le nombre des colonnes à l'entour des piliers. Il y a bien là de quoi occuper l'archéologue, mais le simple visiteur ne sera pas déçu, lui non plus, devant cette multitude de chapiteaux, aux formes et styles multiples. Dans l'absidiole Nord, des chapiteaux encore, curieux à d'autres titres, ne laisseront pas de frapper, ornés qu'ils sont de masques d'animaux et d'arcatures. C'est tout cela que, dans un cadre agréable, sait dispenser l'église de nombreuses dans la région, et témoigne que nous sommes ici dans un centre important. La nef est d'apparence plus médiocre (autant qu'on peut s'en rendre compte sous l'enduit), mais cela ne veut pas dire plus ancienne, car la décoration développe avec plus de richesse les mêmes thèmes que dans le chevet. Voûtée en berceau sur doubleaux, elle est éclairée directement, mais seulement dans la première travée, par deux fenêtres, une au Nord et une au Sud, percées en pénétration dans la voûte. Les bas-côtés sont très étroits et ne correspondent nullement à l'ampleur du transept et des absides. Les piliers cruciformes, nus jusqu'à une hauteur de 2 m 50 environ, forment ainsi une sorte de soubassement, au-dessus duquel s'élèvent, sur chaque face, des colonnes jumelées : nous en avons déjà vu à Conques (dans la première travée), à Castelnau (dans la nef), ici même (à l'entrée de l'abside centrale, mais non pas des absides latérales) ; dans la nef elles sont généralisées, employées tout autour des piliers et contre les murs des bas-côtés, pour porter les doubleaux des voûtes et les grandes arcades de communication. Ce système, fréquent dans les églises romanes du Rouergue, mais qui n'est pas inconnu ailleurs, a été adopté par les Cisterciens à Silvanès et a eu dès lors un grand succès dans tout le Languedoc et en Espagne. A Nant, il a l'avantage de multiplier le nombre des chapiteaux. A la façade, comme en tant d'exemples, nous trouvons un porche surmonté d'une chapelle, qui s'ouvre sur la nef. Cette forme carolingienne résulte-t-elle ici d'un édifice plus ancien? C'est possible, mais dans son état actuel, la construction est plus récente que celle de la nef. Les croisées d'ogives (de profil carré et sans clef, dans les collatéraux du porche, de profil semi-circulaire et avec une clef à quatre branches, dans le porche lui-même), ainsi que la belle et monumentale coupole nervée sur pendentifs, au premier étage, ne datent que de la fin du XIIe siècle. Les chapiteaux du chevet, de la nef et du portail, sont presque tous du type « cubique ». Seuls s'en écartent, dans les absides, quelques rares exemples décorés de petites feuilles et deux chapiteaux étranges, ornés d'une tête de bovidé, vue de face. Le système du parallélépipède, raccordé par un tronc de cône à la colonne, est généralisé et plus rigoureux dans la nef : les arêtes sont vives, les angles strictement droits, le modelé même des ornements s'accorde plus complètement aux surfaces. Pourtant la monotonie est évitée, parce que varient les proportions en hauteur des deux parties du chapiteau : tantôt la partie supérieure est réduite, tantôt au contraire le tronc de cône disparaît presque. On trouve alors à l'extrême un parallélépipède posé sur la colonne, comme un coffret dont les surfaces sont décorées à plat. Les ornements qui couvrent les parties obliques sont des feuilles, des palmettes ou des entrelacs, parfois une petite arcature ; exceptionnellement, dans l'abside méridionale, trois têtes caricaturales qui sortent en saillie, sans rôle fonctionnel. Les surfaces planes verticales permettent plus de variété : on y voit des entrelacs, des coquilles, un damier, mais aussi des lions affrontés de part et d'autre d'un fleuron, des animaux s'entredévorant, empruntés au répertoire oriental. Grâce à la qualité du calcaire et à l'imagination du sculpteur, la forme stricte d'un épannelage géométrique aux angles vifs et aux surfaces planes, s'enrichit d'une riche et magnifique parure. ____________________ Texte intégral de G.GAILLARD " Le ROUERGUE ROMAN _ Collection "La nuit des temps" ROUERGUE ROMAN _ livre épuisé Édition: ZODIAQUE (La Pierre-qui-vire) _______________________________
|