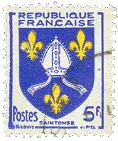|
L'église
romane de VILLARS les BOIS (17)
Photos
de Alain DELIQUET, de Michel CARON, de wikipédia et du Ministère de
la Culture VILLARS les BOIS  L'église de Villars-les-Bois est curieusement posée sur le sommet d'une haute colline et domine la contrée de très haut. De son clocher et même de son esplanade, la vue s'étend au-dessus de la plaine des « Pays-Bas » jusque vers Ruffec et Angoulême. Par sa position, son entourage et ses particularités, elle constitue un ensemble fort intéressant et un joli but d'excursion. Construite au XIIe siècle, dédiée à Saint-Victurnien, elle a été classée Monument Historique le 14 Août 1912, (pour son abside seulement). Sa position très en vue lui a valu, au cours des siècles, des malheurs sans nombre : incendies, comme l'attestent ses pierres calcinées ; guerres, les traces de balles sont nombreuses sur sa façade ; (elle servit longtemps aux Anglais de forteresse et de tour de guet) ; destructions et reconstructions avec utilisations d'anciens murs, comme il est aisé de le voir dans la nef. Au début du XVe siècle, elle fut en grande partie rebâtie avec adjonction d'une chapelle latérale surmontée du clocher actuel remplaçant celui qui existait primitivement sur la troisième travée. En 1777 la façade fut remontée, mais conserva néanmoins son portail ancien. Aujourd'hui la toiture en charpente de la nef est effondrée sur les trois quarts de la longueur et il est à craindre que par manque de fonds ou insouciance la ruine de cette église ne soit prochaine et définitive. Les réparations nécessaires ont été effectuées en 1952. La nef comporte trois travées séparées par de forts massifs de pilastres saillants à l'intérieur ; au dernier est accolée une demi-colonne. Après la première travée, le sol s'abaisse de cinq marches.    Entre les piliers existent d'autres colonnes directement appliquées sur le mur, provenant d'une construction antérieure et surmontées de chapiteaux romans. Le départ d'une ancienne voûte de pierre en arc brisé se voit encore au-dessus de la première travée. Du sommet des murs de la deuxième et de la troisième travée s'élancent des bases d'arcs ogivaux et de formerets d'inégales hauteurs, restes d'une voûte du XVe siècle. Le mur droit de la première travée est percé d'une baie ogivale dont l'arc à grosses nervures est bordé de flammes. Cette baie ouvre sur une chapelle située sous le clocher, chapelle voûtée en ogive avec formerets. Entre l'abside et le chœur, un arc large et puissant portait jadis l'ancien clocher. L'abside voûtée en cul-de-four prend jour par cinq fenêtres en plein cintre sur lesquelles subsistent des traces de litre. Une ouverture en demi-lune existe au sommet du mur latéral Sud. Elle communiquait autrefois avec des bâtiments conventuels attenants. La plupart des chapiteaux sont nus, sauf ceux des colonnes de gauche avoisinant l'entrée. Charles CONNOUË ne s'est jamais interréssé aux animaux sculptés des XIe et XIIe sauf celui-ci et autres? beaucoup plus tardifs: La baie de la chapelle de droite, banale à première vue, doit cependant retenir l'attention. Dans l'espace assez grand réservé entre les sommets des deux arcs ogivaux qui l'encadrent se détache, très apparent, un animal faisant face aux visiteurs et les fixant durement. Cette présence est assez insolite à cet endroit. C'est une réapparition du « léopard anglais » (voir à ce propos et dans l'ordre : Bougnau, Bussac, Vénérand, ensuite Villars-les-Bois, puis Les Gonds). Cet animal inquiétant n'est pas seul. On le retrouve à l'extérieur ( je n'ai pas remarqué de sculptures à cet endroit, si quelqu'un pouvait vérifier et mieux envoyer des photos, MERCI) sur les deux gros contreforts qui étayent le clocher au Sud. Cette fois l'imagier a multiplié les effigies et c'est quatre léopards, un sur chaque angle des deux glacis, qui s'imposent aux regards des passants. L'un tient dans sa gueule un objet qui ne peut être qu'une proie, un autre le plus apparent, a au cou un collier attaché à une chaîne qui paraît elle-même fixée au sol, comme à Bussac. Les autres sont simplement accroupis, mais toutes griffes dehors, comme à Vénérand et face aux passants, semblent les guetter. Bien qu'ils soient ici d'une exécution plus soignée qu'ailleurs, ils n'ont rien de commun avec les animaux, lions et surtout singes, qui dans l'art ogival de fin d'époque, figurent à petite échelle à titre décoratif sur les fenêtres et certaines bases d'arcs, ni avec le « léopardus » des modillons romans de Meursac. Ceux de Villars sont d'un volume et d'une facture qui empêchent toute assimilation. Ici l'allégorie est certaine, elle est voulue ; mieux même ; elle est parlante. C'est un avertissement, une indéniable menace. Remarquons tout d'abord qu'ici, comme à Bussac ou à Vénérand, les griffes largement étalées ont un développement nettement exagéré, par rapport à la taille de l'animal. De plus l'emplacement choisi est toujours très apparent, aussi apparent que possible : chapiteaux, base d'un glacis du contrefort le plus rapproché de la porte d'entrée. Ici à Villars ; le léopard est à l'intérieur de l'église, en bonne place et à l'extérieur sur le passage obligé et par conséquent le plus fréquenté à cette époque, entre la porte de l'église et celle du cimetière voisin. Quatre quadrupèdes sont bien visibles mais ils sont du XIIe et à l'intérieur A l'extérieur il y a bien ces animaux qui semblent également du XIe ou XIIe mais ne sont pas des léopards et sont sur la façade. Ceci posé, quelle explication donner à ces « symboles » dont aucun savant archéologue n'a parlé ; constatation tout au moins surprenante si l'on songe au nombre de lances rompues à propos de motifs souvent futiles. Celui-ci manque-t-il d'intérêt ? — Peut-être. — Cependant il y a mieux là qu'une inscription puisque c'était en quelque sorte un message permanent adressé aux Français occupés par les Anglais occupants. Ce qu'ils ne pouvaient dire à l'aide de phrases écrites... ils l'exprimaient par images; habitudes conformes d'ailleurs aux usages du temps. Au début du XVe siècle les Anglais, avec des alternatives diverses, étaient établis en France et particulièrement au Sud de la Loire — surtout au Sud de la Charente — depuis près de trois siècles. Quelques années auparavant Du Guesclin les avait chassés de la Saintonge, mais le traité de Troyes en 1420, venant après Azincourt, leur avait livré à nouveau presque toute la France. Ils reparurent donc dans leurs anciennes possessions. Dans les régions sur lesquelles ils régnaient et qui en fait étaient anglaises, les Anglais « administraient » c'est-à-dire qu'ils levaient les impôts et assuraient certaines charges, par exemple l'entretien et même la reconstruction des édifices publics. Tant que l'occupation acceptée par les habitants (souvent souhaitée même) avait été paisible, rien ne différenciait l'administration des princes Anglais de celle des représentants des rois de France ; mais quand après Du Guesclin, avec Charles VII et Jeanne d'Arc (1431), les Français entreprirent sérieusement de secouer le joug, les Anglais menacés devinrent menaçants à leur tour. A ce moment la mainmise se fit brutale et les insulaires saisirent toutes les occasions de brimer la population ; au besoin ils en créèrent. La restauration des édifices religieux (les seuls régulièrement fréquentés par les habitants), fut utilisée par eux à cet effet. Dès lors le léopard griffu ou dévorant un coq (le coq était l'emblème des Français depuis l'occupation romaine) vint rappeler aux Saintongeais qu'ils vivaient non plus au côté d'un allié, mais sous la domination d'un vainqueur implacable qui voulait demeurer et entendait leur maintenir à tout instant présente à l'esprit leur situation d'assujettis. Par les griffes étalées l'Anglais disait sa puissance et le danger d'une insoumission ; par le léopard enchaîné au sol ; il se déclarait solidement fixé à la terre qu'il occupait. La « guerre des nerfs » ne date pas du XXe siècle. Nos ancêtres avaient bien vu là un symbole de contrainte et de domination puisqu'à Vénérand et à Bougneau où les léopards étaient à portée de leurs mains, ils s'empressèrent de les marteler dès que la chose leur fut possible. A Villars, moins vindicatifs ou plus débonnaires, les habitants laissèrent subsister ces souvenirs de leur ancien esclavage. Peut-être aussi que juchés sur leurs hauts contreforts, ils étaient moins accessibles... Ces emblèmes ont été sans doute fréquents vers cette époque, dans notre région et partout où s'étendait la domination anglaise. Presque tous ont dû très tôt disparaître et nous ne voyons plus que quelques rescapés. Mais ne serait-ce pas leur souvenir qui, cinquante ou cent ans plus tard, donna aux sculpteurs du gothique flamboyant l'idée, pour le moins étrange, de charger d'abord certains glacis de contreforts (Plassay, Hiers), puis les bases d'arcs ogivaux, de quadrupèdes divers : lions, léopards peut-être et surtout singes, comme on en voit à Saint-Eutrope de Saintes et à Saint-Pierre (aux fenêtres extérieures de la nef, côté Nord). Cette question, évidemment de modeste importance, mériterait néanmoins, comme beaucoup d'autres posées par nos édifices religieux, un complément d'étude. _________________ Charles CONNOUÊ en a oublié le portail: les baies et leurs sculptures: et quelques modillons sympa: et la splendide abside  D'après Rainguet, la cloche de Villars-les-Bois serait datée de 1422 ou 1472 ( la vérification est difficile) et porterait une inscription en caractères gothiques se terminant par « ...et patriae libérationem ». « Elle appelait la libération du pays, la souhaitait, ou la fêtait » ajoute Rainguet. Mais des inscriptions similaires existent sur au moins une autre cloche en Saintonge et il ne faudrait y voir qu'un appel au pouvoir des cloches d'éloigner le feu du ciel (orages). L'interprétation de Rainguet semblerait cependant plus plausible. (Cette cloche si ancienne ne semble pas être classée ?) En définitive l'église de Villars, est intéressante à plus d'un titre. Il y a lieu d'ajouter qu'il existe sur le linteau de la fenêtre supérieure de l'escalier du clocher, une large inscription en lettres du XVe siècle, que la hauteur et les arbres empêchent de déchiffrer. Près des murs ont été découverts des débris importants de constructions romaines. ______ Au Moyen âge un château fortifié accompagnait l'église au Nord. Des courtines l'unissaient à la tour du clocher et l'ensemble constituait une position de premier ordre. Les débris de deux tours subsistent encore, ainsi que d'anciens talus et des vestiges de vieilles murailles. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________ AD Décembre 2023 |