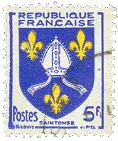|
Les quatre magnifiques chapiteaux romans de SAUJON Texte intégral de Charles CONNOUË
 Église paroissiale de Saint Jean-Baptiste. Elle serait bâtie à l'emplacement et sur les ruines d'un temple romain. Cet édifice relativement moderne est sans caractère. La nef circulaire à plafond bas, éclairée par des fenêtres en tiers-point et le chevet circulaire n'ont pas d'ornementation. En avant du chœur deux arcs en plein cintre ouvrent sur deux chapelles formant transept. L'arc de la chapelle de gauche (qui occupe la base du clocher) est cantonné de deux piliers portant de beaux chapiteaux. A côté deux demi-colonnes anciennes, posées sur des crédences, sont terminées par deux autres chapiteaux de même style et d'un égal intérêt. Ces quatre chapiteaux, qui étaient encore il y a peu de temps dans une salle de l'école municipale, ont été découverts au commencement du présent siècle (1912) au cours des fouilles effectuées sur la place du champ de foire où selon la tradition, se trouvait une ancienne église, dédiée à Saint- Martin (détruite à la révolution). Ils étaient enfouis pèle-mêle avec d'autres débris à deux mètres de profondeur dans un trou qui devait être une ancienne crypte. Ces quatre très beaux spécimens d'art roman représentent  l'un Daniel dans la fosse aux lions ;  l'autre le pèsement des âmes ;  un troisième un pêcheur avec un énorme poisson sur l'épaule, peut-être Tobie ; (il porte une ceinture de force, symbole courant indiquant un effort à faire ou un travail)  le quatrième une scène de la Résurrection : Tous ces débris, chapiteaux et colonnes étaient recouverts d'un crépissage où se discernaient encore des dessins rouges et jaunes. La technique de ces sculptures, qui méritent par leur valeur artistique d'être ainsi réemployées, accuse la deuxième moitié du XIIe siècle. Fin du texte de Charles CONNOUË _______________________________ Les églises de la SAINTONGE (livre 2 épuisé) édition: R.DELAVAUD ___________avec leur aimable permission. ou du moins essayons... DANIEL dans la fosse aux lions ? Le thème de Daniel dans la fosse aux lions est très commun, il est représenté généralement avec 4 lions qui lui lèchent les pieds... Ce n'est pas le cas ici, ce qui ouvre la porte à un clin d'oeil du sculpteur représentant un saint, un abbé par exemple.
DANIEL à Saint EUTROPE de SAINTES Il se fait lécher les pieds et lève les deux mains en signe d'innocence et il n'a pas de livre dans la main . La "pesée des âmes"   Un jugement oui mais intérieur, un examen de conscience. Les scènes du pèsement similaires à celle de SAUJON se retrouvent en façade à CORME-ROYAL et sur un chapiteau monumental dans l' église haute de St Eutrope à Saintes, à Colombiers, à Arces-sur-Gironde et aussi ailleurs qu'en Saintonge...à St Nectaire, à Lanobre, Vézelay, etc... ce serait plutôt un thème récurant... Mais souvent c'est un couple qui se présente (églises Saint-Eutrope haute à Saintes, d'Arces-sur-Gironde, Lanobre...) Aucun écrit ne décrit cette scène si souvent réprésentée: Ni dans la bible Ni dans les évangiles Ni dans les apocryphes connus Ni chez les pères de l'église Ni dans le coran !
Dans la tradition des chrétiens orientaux c'est l'archange Michel et non Gabriel qui pèse. J'ai trouvé à la MNAC un tableau du XIIe, qui cite Raphaël et Gabriel comme guides de l'âme  et Michel effectuant la pesée, avec un démon tricheur :  Alors si je peux me permettre: Une fois de plus les sculpteurs se sont appropriés une représentation non conforme à l'orthodoxie mais ils montrent une scène bien parlante pour transmettre un message. Il s'agit non pas de représenter le jugement dernier de la fin des temps (celui des tympans du XIIe et bien souvent gothiques) mais d'évoquer plutôt notre propre jugement maintenant et non celui de notre âme à la séparation d'avec le défunt. En effet notre conscience selon la pensée de l'époque est appelée constamment à un choix. Pourquoi pas entre un côté où se trouvent les anges et un autre où se trouve nos démons. Toujours le même combat spirituel! J'y vois un appel à notre jugement de libre arbitre, à stimuler notre conscience d'être intelligent et libre, et non pas rester passif comme le personnage nu. Le sculpteur nous incite à réagir, puisqu'il montre le Malin actif ! Dans la première conférence de Jean Cassien qui était très lu dans les monastères et dont les textes servaient de guide aux moines on peut trouver la réponse Il s'agit de notre jugement intime.
Le pêcheur avec un énorme poisson sur l'épaule ...  Une énigme et plein de versions (ce qui est normal pour un chapiteau isolé d'un contexte en lien avec le thème). Le thème de l'homme portant un énorme poisson se retrouve également sur des chapiteaux à Courpiac (33), à Arbis (33), à Saint-Fort-sur-Gironde (17) à Moulis, à Bouliac, à Loupiac, à Cerons, à Saint-Macaire, à Esclottes, à Coutures, et c'est en raprochant de ses lieux que l'on peut peut-être découvrir une ligne directrice. à Lagraulière (19 Corrèze) et probablement encore ailleurs. A Saujon l'homme portant l'énorme poisson est associé à un autre homme portant une houe sur l'épaule; s'agit-il du même personnage? De l'humanité en général ? Mon hypothèse : Ne serait-ce pas la représentation de la culture de l'âme : Si le poisson est le symbole du chrétien comme cela était aux premiers siècles; porter ce lourd poisson est une tâche éprouvante et demande un travail en profondeur comme le fait le paysan en retournant la terre. Tobie n'a selon moi rien à voir ! A ARBIS (33) on retrouve la paire homme portant un poisson et paysan laboureur, sur la même fenêtre:  ARBIS (33)
"les femmes au tombeau" Le sculpteur passe le message de la résurrection et donc de la vie éternelle. Ceux qui croient en la résurrection et qui s’y préparent contrôlent leurs instincts et soumettent leurs passions. Ils se préparent spirituellement et vivent dans la vertu. D'où peut-être le gros poisson à porter, et la houe... Un site avec plus de détails, dont l'auteur s'est aussi intéressé de près à ces 4 chapiteaux: http://lepetitrenaudon.blogspot.fr/2013/09/les-chapiteaux-de-saujon.html Voici un article du bulletin de la Société d'histoire et d'Arquéologie en Saintonge Maritime N° 22 _ 2001 UN CHAPITEAU ROMAN DANS L'ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE SAUJON Jean-Pierre HIBLE « UN HOMME PORTANT UN POISSON » « Au Moyen Age, le génie humain n'a rien pensé d'important qu'il m l'ait écrit dam la pierre, » Victot Hugo L'un des quatre
chapiteaux déposés dans l'église
paroissiale de Saujon et provenant du prieuré Saint-Martin,
aujourd'hui disparu, représente un homme portant sur son
épaule un poisson. Ce thème a suscité
des interprétations différentes et
contradictoires.
Conditions
de la découverteEn 1912,
alerté par la découverte de sarcophages,
Léon Massiou entteprend des fouilles sur le site de l'ancien
cimetière. Il va ainsi mettre à jour des
éléments architecturaux provenant de l'ancien
prieuré Saint-Martin.
Contexte
historiqueParmi ces éléments quatre chapiteaux historiés - Daniel dans la fosse aux lions, Le Pésement des âmes, Les Saintes Femmes au Tombeau et la Résurrection, un Homme portant un poisson, -qui après quelques tribulations vont être déposés dans l'église paroissiale. L'un d'entre eux « L'homme portant un poisson » sera l'objet de cet article. La documentation
écrite sur ce monastère est bien pauvre. Seuls
quelques lambeaux d'informations sont parvenus jusqu'à nous.
Ce prieuré aurait été fondé
au Ve siècle et relèvera de l'abbaye
Saint-Martial de Limoges, au Xlle siècle.
Description
du chapiteau.La date de sa destruction est incertaine : 1415 « le Comte d'Autinton (Hutington) et ses gens anglois qui prirent l'église de Saint Martin dudit lieu de Saugeon, et détruisirent tous les biens, meubles et héritages des habitants dudit lieu... » ; 1556, on trouve « Messire Michau Boucquet prêtre et chapelain de la Chapelle fondée par feu Nicolas Rouillard, desservie en l'église de Saint Marthin de Sauion... » ; en 1568, les Huguenots occupent Saujon ; en 1571, Denis de Campet épouse Bertrande Burlé, dame de Saujon et en partie du Chay, en août 1573, il acquiert la partie de Saujon qui lui manque, attribuée à l'un des fils La Trémouille. Denis de Campet et sa femme appartiennent à la religion réformée. La destruction du prieuré a pu se dérouler en plusieurs étapes entre 1571 et 1628 (chute de La Rochelle). Malgré la destruction des bâtiments, réduits à l'état de ruines, l'abbaye de Saint-Martial continue à procéder à la nomination de prieurs, coseigneurs de Saujon (du baillage de Ribérou). En 1631 (12 juin), Anne d'Authon acquiert une maison au lieu dit La Croix et un pré sur le Dalon, du seigneur de Saujon (Samuel-Eusèbe de Campet) et du prieur. En 1685, inauguration de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, édifiée ou réédifiée sur une partie du cimetière protestant, établi en 1629. En 1683, le Pouillé de Saintes indique la présence d'un prieur et de six religieux, nommant deux bénéfices : l'Eguille et la paroisse de Saujon. Au début du XVIIIe siècle, les ruines sont toujours apparentes, et Claude Masse y voit de façon erronée des restes de fortifications. Au milieu de ce même siècle, le prieur de Saujon nomme encore le curé de Saujon et celui de l'Eguille. En 1772, le Relevé de Vérifications des biens ecclésiastiques donne 2575 livres de revenus annuels au prieuré. Donc la destruction matérielle du prieuré a pu s'échelonner entre 1571 et 1628, bien que la charge et les revenus du prieuré soient maintenus bien après cette date. A la destruction physique, la mise en commande du prieuré ajouta à son démantèlement, par exemple, à l'époque de la consécration de l'église paroissiale (1686), Jean-Baptiste de Vertamon (f 02 août 1688) en est le prieur, il réside à Paris. Composition générale Un homme ploie -
au point de mettre un genou à terre - sous le poids d'un
énorme poisson qu'il porte sur son épaule gauche
et un second personnage portant une houe à
l'épaule gauche soutient la queue du poisson de sa main
droite. Les deux hommes se font face sur deux
côtés du chapiteau et sont vêtus de
robes ornées. Seuls deux pans de la corbeille du chapiteau
sont sculptés. Tailloir et astragale limitent la
scène inscrite totalement sur la corbeille. Le relief est
bien dégagé. Il est à noter qu'il n'y
a pas de fond à la scène et que seule une
ébauche de volume en souligne la partie
supérieure. La totalité du chapiteau mesure
environ 0,63 m, on remarquera l'importance du tailloir, brut, sans
aucune trace de travail de la pierre outre la taille, qui occupe
environ 1/3 de la totalité du bloc (0,20 m). Il est
vraisemblable que l'importante surface lisse du tailloir ait
été destinée à recevoir une
peinture, comme semblent l'indiquer les traces de peintures
découvertes sur les colonnes lors de l'invention. Nous
retrouvons la même proportion entre le tailloir lisse et la
corbeille historiée, ainsi que l'espace laissé
à la peinture sur les trois autres chapiteaux saujon-nais,
ce qui conforte l'impression d'unité stylistique entre eux.
Les
figuresLes deux
personnages sont richement vêtus et portent une sorte de
chaussons effilés. Le poisson apparaît -
à l'évidence de grande taille et donc d'un poids
certain. Les yeux des deux personnages sont creusés au
trépan.
L'homme portant un poisson II plie le genou
sous le poids du poisson qu'il porte sur l'épaule gauche, la
tête derrière son dos et soutient la partie
postérieure de l'animal à deux mains, l'une -la
main gauche- au-dessus du corps, l'autre en dessous. La
moitié gauche du visage disparaît, enfouie, dans
le corps du poisson. Le genou droit au sol donne une sensation de
pesanteur, le mouvement principal s'exerçant de haut en bas.
La tête mesure environ 0,12 m pour un corps
-redressé- que l'on peut estimer à 0,40 ou 0,45
m, ce qui fait une proportion d'à peu près un
tiers (proportion naturelle : environ 1/7). Les traits de la
tête sont grossiers et nets, ils ressortent de la sculpture
romane saintongeaise contemporaine, le nez est fortement
prononcé, la bouche bien dessinée, le menton
légèrement prognathe, la chevelure est
composée de plis en mèche sur le front, les
cheveux longs descendent sur la nuque de ce premier personnage. Le
corps se détache bien du fond et présente une
fermeté certaine. La robe portée par cet homme
suit le mouvement du corps et le souligne, elle est indiquée
par une alternance de trois bandeaux horizontaux, l'un vierge de
décoration, le deuxième constitué d'un
rang de petites boules, le troisième de petits trous
alignés. Le bas de la robe est souligné pat une
sorte de feston. Cette robe est comparable à celle de l'ange
qui se tient derrière la balance sur la Pesée des
âmes et évoque celle de l'ange assis sur le bord
du tombeau des Saintes Femmes au Tombeau. Cette robe est
fermée par une ceinture nouée en x , identique
à celle de la première Femme au Tombeau. Les
mains et les doigts sont nettement figurés. Une impression
globale d'aisance du mouvement malgré l'effort ressort de ce
premier personnage.
Le
poissonLa taille du
poisson dont la tête pend dans le dos de l'homme est
imposante. Les écailles, par rang de cinq sont parfaitement
lisibles, bien marquées par le sculpteur. Les trois parties
du poisson sont bien identifiables : la tête arrondie, les
yeux importants, la mâchoire légèrement
courbe, de petites taches rondes sont visibles sur le sommet de la
tête ; le corps ferme ; la queue, large, bien
dessinée et marquée par une série de
traits qui vont en s'évasant. Les nageoires apparaissent
très clairement : de chaque côté,
près des ouïes, une autre sur le ventre et deux sur
le dos du poisson. On peut estimer la taille de la
représentation du poisson à environ 0,50 m donc
plus grande que l'homme qui le porte.
Le
deuxième hommeII
apparaît sur la seconde face taillée du chapiteau,
le visage dans l'angle de la corbeille. Lui aussi, plie le genou. Il
soutient la
queue du poisson de la main droite et tient de la main gauche une houe qu'il porte sur l'épaule gauche. Les proportions sont sensiblement les mêmes que celles de son compagnon : la tête mesure environ 0,115 m pour une hauteur totale d'environ 0,31 m, donc un rapport proche de 1/3. La houe est, elle aussi, imposante : le manche mesure 0,26 m et le fer, de forme arrondie, 0,14 m. Ici aussi, on notera l'importance donnée à l'objet porté. Son vêtement est différent, il est constitué de courbes épousant et soulignant le mouvement du corps qui vient en aide au premier homme. La robe rappelle celle de l'ange Saint Michel de la Pesée des âmes et celle de la troisième Femme au Tombeau. La tête est forte aux traits simples, le nez et la bouche sont bien marqués, on remarquera les deux rides partant des ailes du nez et descendant vers les commissures des lèvres. La chevelure, faite de mèches plus souples, tombe sur le front et descend sur la nuque, atteignant le manche de la houe. Le regard semble fixer un objectif hors de la scène. La face de la robe vers le fond de la sculpture n'est pas travaillée . L'extrémité d'une des chaussures de cet homme déborde légèrement sur l'astragale. Pour ce second personnage, aussi, on remarquera l'aisance du mouvement. Hypothèse de datation Le vocabulaire
restreint du sculpteur pour marquer les visages, les
vêtements malgré la facture soignée, le
soin et la minutie apportés, l'identité des
thèmes (Daniel, la Pesée) indique la filiation
directe des quatte chapiteaux de Saujon avec ceux de la
croisée du transept de Saint-Eutrope de Saintes, d'une
datation probable autour de 1110. Un certain nombre
d'éléments s'en éloignent pourtant et
ainsi évitent la copie servile. En outre, le raffinement des
plis des vêtements, le traitement des écailles du
poisson, etc., laissent à proposer de les dater des
années 1120-1130. Il faut aussi noter la parenté
stylistique entre les chapiteaux de Saujon.
Le
thèmeDes quatre chapiteaux exhumés : Daniel dam la Fosse'aux Um, Le Pésement des Ames, La Résurrection et les Saintes Femmes au Tombeau, L'Homme portant un poisson, seul ce dernier semble ne pas être de caractère directement religieux. Ce thème se retrouve -de façon relativement exceptionnelle- dans quelques lieux : En Saintonge : - à SAINT-FORT-sur-Gironde, sur un modillon de la façade occidentale, le poisson que le pêcheur porte avec difficulté est de grande taille. En cela le thème se rapproche de celui de Saujon. En Guyenne : -
à SAINT-MACAIRE (près de Langon), un chapiteau du
chevet présente un homme de face en position
fléchie, genoux écarrés qui porte,
comme un haltérophile, un énorme poisson.
En Corrèze :-à GERONS (près de Cadillac), un modillon, très abîmé, côté Sud du chevet, montre un homme portant avec difficulté un imposant poisson sur l'épaule. - à LOUPIAC (près de Cadillac), un modillon, très érodé, de la façade montre un homme tombant à genoux sous le poids d'un énorme poisson porté sur le dos. - à COURPIAC (près de Rauzan), petit édifice du Xlle siècle, sur un chapiteau de la porte au Sud, au bas de la nef, un homme porte sur l'épaule un gros poisson. - à COUTURES (près de Sauveterre-de-Guyenne), sur un chapiteau du portail d'entrée, un homme de facture proche de celle de Courpiac et en position similaire à celui de Saint-Macaire porte un poisson de grande taille qui relève la queue. - à BOULIAC (près de Bordeaux), en deux exemplaires, l'un dans le narthex, l'autre dans le chœur. Sur celui de l'entrée, un homme debout porte un poisson de taille extraordinaire sur l'épaule, la tête et la queue touchent le sol. Un second personnage vient par derrière à son aide. La seconde représentation, dans le chœur, à gauche, montre un homme seul portant un poisson de plus petite taille, mais imposant, sur l'épaule. Cette scène partage le chapiteau avec un homme luttant contre un monstre. - à MOULIS (en Médoc) sur un chapiteau, au côté gauche du chœur est représenté un homme debout portant sur l'épaule un poisson de très grande taille, la tête et la queue touchent le sol. La précision des détails du poisson, écailles, nageoires, tête et queue, rappelle celle de Saujon. - à ESCLOTTES (près de Duras/Saint-Germain-de-Duras, Lot-et-Garonne) où l'énorme poisson, porté sur les épaules d'un homme (Tobie - ?-) enjambe l'angle d'un chapiteau de premier plan que l'on peut rattacher à l'œuvre du grand sculpteur qui a travaillé à l'abbaye voisine de Saint-Ferme. L'homme est dans la même position que celui de Saint-Macaire, peut-être est-il assis, il porte une sorte de robe dont les jambes se dégagent, genoux à angle droit. On remarquera les traces de polychromie (rouge, de la robe). à LA GRAULIERE, sous le porche. En Agenais : à LAUZUN où l'homme au poisson partage un chapiteau avec un homme qui tient en laisse un singe enchaîné. En Auvergne - à l'église abbatiale Saint-Pierre de MOZAC (ou Mozat), où Tobie et Sanson (?) se partagent un chapiteau, séparés par un arbuste aux branches curieusement dissymétriques, si toutefois cette interprétation, des deux personnages -l'un chevauchant un énorme poisson et serrant contre sa poitrine une outre à fiel qui doit guérir son père, l'autre terrassant un monstre (lion -?-) est correcte. On peut se demander si le prétendu Tobie ne recopie pas simplement un personnage chevauchant un dauphin dans un paysage marin participant au décor général d'inspiration profane antique. Ce chapiteau ne ressort donc pas de notre thème. Nous l'utiliserons comme référant. Charles Dangibeaud signale un exemplaire de ce thème à BESSE - ex Besse-en-Chandesse, aujourd'hui Besse-et-Saint-Anastaise - («Toèie est accompagné par un ange appuyé sur un bâton »)(1). Après analyse visuelle, le chapiteau montre un personnage, debout, tenant à la main une sorte de flacon ; mais aucun poisson n'est représenté. Il s'exclut donc de notre étude. Et peut-il être identifié à Tobie ? En Béarn : à OLORON-SAINTE-MARIE, sur la voussure extérieure du clocher-porche portée par des colonnes - voussure consacrée à la Terre - c'est toute la vie paysanne de l'époque que le sculpteur a représentée : chasse au sanglier, pêche et fumage du saumon, fabrication du fromage, préparation du jambon, travail de la vigne. En Navarre : à SAN SALVADOR de LEYRE (abbatiale). Il est possible
maintenant de remarquer deux points communs : tous les poissons sont de
taille extraordinaire, la majorité de ces
représentations se trouve à proximité
d'un fleuve ou d'une rivière : Saujon, au bord de la Seudre
; Saint-Fort et Moulis, près de la Gironde ; Bouliac,
Gérons, Loupiac, Saint-Macaire, sur la Garonne ; Courpiac,
Coutures et Esclottes, entre Dordogne et Garonne, proches d'affluents
de ces cours d'eau ; à Oloron-Sainte-Marie, les gaves d'Aspe
et d'Ossau se réunissent pour former le gave d'Oloron ;
Mozac, les saumons de l'Allier sont célèbres et
Furetière écrivait dans son Dictionnaire
Universel (1690) : « On pêche des saumons jusques
dans l'Auvergne »
TypologieNous pouvons,
dès lors, proposer la typologie relative suivante :
1 - L'homme porte le poisson sur une épaule et plie le genou (ou les deux) sous le poids. Il est de profil. 1-1 L'homme est seul. 1-2 L'homme est accompagné d'un second personnage. 2 - L'homme porte le poisson sur une épaule sans plier sous le poids. Il est de profil. 2-1 L'homme est seul. 2-2 L'homme est accompagné d'un second personnage. 3 - L'homme porte le poisson et effectue une action sur celui-ci. Il est de profil. 4 - L'homme porte le poisson sur les deux épaules, les jambes en flexion. Il est de face. 5 - L'homme ne porte pas le poisson
Saumon ou esturgeon ? Bien que la
ressemblance n'ait pas été une
préoccupation majeure des sculpteurs romans, nous pouvons
nous demander sile poisson est un saumon ou un esturgeon. Certains
auteurs ayant tranché, un peu rapidement. Les
éléments descriptifs correspondent à
la description et à la gravure du saumon dans
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, nous pencherons
donc pour cette identification. Elle correspond à celle
d'autres sites présentant ce thème : à
Oloron-Sainte-Marie, à Mozac, il s'agit
évidemment de saumons.
InterprétationLa
pluralité de sens des symboles romans rend toute
tentative d'interprétation périlleuse. Comme
exemple nous ne citerons que la dualité du « lion
», monstre androphage, symbole à la fois du Mal
(vaincu dans Daniel et les Lions), ou de
l'hérésie, menaçant le
pêcheur mais aussi de la force chrétienne (saint
Marc, citant Isaïe : « Le chrétien doit
être sans crainte comme un lion ») ou plus
explicitement encore dans la description du Tétramorphe dans
l'Apocalypse de saint Jean IV, 6-7-8, sous le nom des «
quatre Vivants »:{...] « Le premier Vivant
est
comme un Lion {...}».
Deux
écoles s'affrontent. Pour la première,
représentée par Emile Mâle, les auteurs
de la collection Zodiaque, et plus récemment M.
François Garnier, au Moyen-Age « tout est signe
», même si aujourd'hui - huit siècles
après l'époque romane - peu d'entre eux nous sont
accessibles. Pour la seconde, suivant Henri Focillon, quelle que soit
l'importance du symbole, ce qui importe, c'est sa fonction
décorative. Il s'agit là bien
évidemment d'une simplification des deux thèses.
Une
synthèse pourrait être proposée :
nous ne connaîtrons jamais les hommes des Xl-XIIe
siècles, nous ne pouvons qu'approcher leurs modes de
fonctionnement. Le Symbole et le Décor ne sont pas
antinomiques ; ces deux lectures peuvent se juxtaposer. Le symbole
-figure emblématique du Moyen-Age-n'empêche pas le
désir de jouer avec les formes et les lumières.
De même, le symbole peut se retrouver derrière
l'anecdotique. S'agit-il d'une représentation
réaliste d'un pêcheur et d'un paysan ? Ce
thème peut sembler profane, aujourd'hui. Le
pêcheur et le paysan, le travail de la mer ou du fleuve et le
travail de la terre étaient les deux volets de la production
vivrière médiévale de la Saintonge
maritime. C'est en cela que la lecture profane du thème nous
semble le plus proche des préoccupations des commanditaires
d'Oloron-Sainte-Marie. Une lecture chrétienne de ce
thème profane peut se surim-poser : la pêche
miraculeuse. Le poisson plus grand que l'homme, la richesse des
vêtements des deux hommes.
Présentation des différentes thèses Les tenants de Tobie. Certains auteurs ont voulu le rattacher à l'histoire de Tobie. Le Livre de Tobie Les trois livres
de Tobie, de Judith et d'Esther font partie ou suivent
immédiatement les livres historiques de l'Ancien Testament.
Le livre de Tobie est une histoire familiale. A Ninive, Tobit, un déporté de la tribu de Nephtali, pieux, observant, charitable, est devenu aveugle. A Ecbatane, son parent Ragouël a une fille, Sarra, qui a vu mourir successivement sept fiancés, tués au soir des noces par le démon Asmodée. Tobit et Sarra demandent l'un et l'autre à Dieu d'être délivrés de la vie. Dieu va envoyer son ange Raphaël, qui, sous le nom d'Azarias, accompagne Tobie, fils de Tobit, chez Ragouël, lui fait épouser Sarra et lui donne le remède qui guérira la cécité de son père : le fiel d'un poisson. La tradition sculpturale romane ne gardera que cet aspect du récit, si toutefois, ces représentations correspondent bien à l'histoire de Tobie. Rien n'est moins assuré. Les tenants de Tobie sont souvent anonymes et évoqués collectivement et ceci dès l'article de Ch. Dangibeaud publié le 1er Octobre 1912, quelques mois après l'invention (Août 1912) : « un porteur de poisson que beaucoup d'archéologues identifient avec Tobie ». C'est le point de départ de l'interprétation reprise de nombreuses fois, sans avoir poursuivi la lecture dudit article, identifiant Tobie. Cependant, page 256 du même article Ch. Dangibeaud précise : « Est-ce Tobie ? J'en doute très fort (,..)». Cette opinion s'est propagée dans le grand public par des articles de presse la reprenant, sans vérifications. Pour M. Jean Clouet
(2) « {...} C'est le responsable moral que
le décor sculpté désigne à
la réprobation des spectateurs. {...} Cependant, une raison
de commodité et de clarté venait à
l'appui d'un tel système de schématisation :
point n'était besoin de représenter une
pluralité de personnages accomplissant le forfait au nom et
à l'acquit du responsable, et d'expliquer de
surcroît que c'est ce dernier qu'il faut incriminer.
».
M. J. Clouet
ajoute : « On ne saurait dire que
les commentateurs aient reconnu Tobie d'un élan unanime ; il
faut dire que la présence du «paysan »
les gênait. C'est bien de Tobie qu'il s'agit cependant.
». Il poursuit en résumant l'histoire de
Tobie en
privilégiant l'épisode de Sarra et du malheureux
sortilège que lui fait subir le démon
Asmodée. Ragouël, le père de Sarra,
avait fait creuser une tombe pour Tobie. Mais Tobie ne meurt pas
pendant sa nuit de noces. Ragouël fait donc reboucher la tombe
par ses domestiques.
II conclut par : «
// nous apparaît donc
à Saujon, la bêche sur l'épaule, m
confirmation de la règle avancée plus haut :
c'est celui qui ordonne ou permet l'action, c'est le responsable, que
met m scène l'auteur de la décoration, et non le
simple exécutant. {... ). Tobie, en rendant la vue
à son père grâce au fiel du poisson du
Tigre, c'était Jésus apportant la
lumière au peuple de Dieu devenu aveugle.».
Dans le cas qui
nous intéresse, il ne s'agit pas de susciter
la réprobation envers l'instigateur d'un méfait.
M. J. Clouet passe du thème de l'expulsion du
démon qui habite Sarra (thème jamais
associé à la représentation de
l'histoire de Tobie dans l'iconographie
médiévale) à la guérison de
la cécité de Tobit. Pour tenter de montrer que le
second homme est Ragouël, M. J. Clouet part del'a priori que
le premier est Tobie. Ce qui ne le démontre
évidemment pas. Il confond aussi bêche et houe
dans sa description qui entraîne l'interprétation
du chapiteau historié : on ne creuse pas une tombe avec une
houe (outil que le second personnage porte sur l'épaule)
mais avec une bêche. C'est pour pouvoir confirmer sa
démonstration que M. J. Clouet « confond
» les deux instruments.
La présence d'un second personnage près du pêcheur, ainsi que le genou à terre de ce dernier sont pour J. Lamberton (3), une indication que la scène pourrait avoir été inspirée par un texte biblique : le voyage de Tobie et la capture du poisson. Il semble difficile -hors de tout contexte- de souscrire à cette assertion. D'autant plus que la houe n'est pas en rapport avec l'ange Raphaël, et surtout que les deux personnages sont de la même taille, c'est-à-dire qu'ils ont le même statut. Charles Connoué
(4) hésite : « Ces quatre
très beaux spécimens d'art roman
représentent l'un « Daniel dans la fosse aux lions
» ; l'autre « lepésement des
âmes » ; un troisième « un
pêcheur avec un énorme poisson sur
fépaule », peut-être « Tobie
» ; le quatrième, une scène de la
« Résurrection ». Il ajoute, quant
à la datation : « la technique de ces sculptures
qui méritent d'être ainsi
réemployées, accuse la deuxième
moitié du XIIe siècle ».
R. Colle (5), lui aussi ne prend pas réellement position : « Les chapiteaux qui représentent « Daniel {...}, Tobie portant un poisson {...} étaient couverts d'un crépissage où l'on distinguait encore des dessins rouges et jaunes {...}. Il ajoute : « Ces œuvres sont de la fin du Xllème siècle », sans étayer son affirmation par quelque argument que se soit. Puis, il décrit ce chapiteau ainsi : « Tobie ( ?). Un homme chargé d'un énorme poisson met un genou à terre. Un autre homme, portant une houe, soulève la queue du poisson. Ils sont très richement vêtus, et portent des chaussons ». Il fait le commentaire suivant : « Ce thème rare en Saintonge {Saint-fort - Rioux { ?} ) est fréquent en Gironde. On le signale jusqu'en Corrèze ». Puis, il rappelle les doutes de Dangibeaud, en simplifiant l'identification du poisson : il ne mentionne que l'hypothèse de l'esturgeon. Et pose la question : «mais, alors pourquoi ces riches habits ? ». Autres interprétations Charles Dangibeaud,
dans le même article - p.25, relativise
le poids du poisson et suppute que l'attitude du personnage est
harmonisée par le sculpteur à celle du second. Or
presque toutes les autres représentations de la
même scène insistent sur la taille dudit poisson
et sur une position de l'homme équivalente. La taille du
poisson donc son poids explique cette flexion.
Dangibeaud doute donc de Tobie -qui serait explicite à Mozat (pendant de Sanson). Il faut avoir recours aux réserves de J. Wirth ; et à Besse, où le personnage est accompagné d'un ange appuyé sur un bâton - mais le poisson n'y est pas représenté. Il voit
à Saujon « un vulgaire pêcheur
chargé d'un énorme poisson par allusion
à quelque pêche fameuse qu'il arrivait de faire
dans la Seudre. On remarquera que cette scène s'est
rencontrée surtout sur les bords des rivières
Garonne, Gironde, Seudre, où les pêcheurs sont
à même de prendre de très gros poissons
: saumons, esturgeons (vulga, créas). Les porteurs sont des
hommes robustes et le personnage qui leur prête aide ne
ressemble point à un ange, mais à un simple
ouvrier des champs. Nous sommes donc très loin du poisson
qui épouvante Tobie, loin de l'ange qui donne le conseil de
s'emparer du fiel salutaire. A titre de comparaison, on pourrait citer
les bergers chargés d'une brebis qui ne sont pas tous des
Bons Pasteurs. » Donc, pour Ch. Dangibeaud, il
s'agit bien
d'un pêcheur.
Pour François Eygun
(6), cette figure : « ne
pouvait être Tobie ni un symbole uniquement abstrait
». Et il compare ce chapiteau à la
voussure romane
du tympan de Sainte-Marie d'Oloron. Il ajoute : «
s'il
fallait y chercher une allusion mystique, comme c'est probable, ce ne
pourrait être que le bienfait providentiel de la manne du
désert ». Il ouvre, là, une
nouvelle
piste d'interprétation.
Françoise
Leriche-Andrieux(7) se contente de :
«
une histoire plus quotidienne : la pêche au saumon et le
travail de la terre (.,.). ». Elle souscrit donc
à
une lecture profane.
René Crozet
(8) évoque, pour les
réfuter, l'opposition de deux allégories : la
Terre et la Mer. Dès la description du chapiteau, il indique
que deux personnages s'opposent, alors qu'au contraire, ils se viennent
en aide. Même si nous conservons l'hypothèse des
allégories, elles ne s'opposent pas, mais se
complètent. Il réfute cette lecture par
l'éloignement de la mer de nombreux sites
possédant cette représentation (il oublie de
citer Moulis). S'il s'agissait des allégories du travail de
la terre et de la pêche son argument tomberait. Ce qu'il faut
cependant retenir de Crozet, c'est sa comparaison avec Oloron :
" A
Oloron, les personnages porteurs de poisson -ils sont trois- sont
mêlés à des égorgeurs de
porcs évocateurs de festins très profanes. "
M. Christian Geinsbeitel
rappelle le portail de Notre-Dame d'Oloron et
son inspiration profane. Et ajoute qu'une interprétation
plus religieuse est possible : Tobie et Tobit. (voir la
réfutation supra). Mais il conclut en précisant
qu' « // est difficile de trancher dans un cas aussi
éloigné de son contexte ».
Pierre Bouchoulle
(10) voit en « le laboureur et le
pêcheur », les symboles du
clergé
régulier (laboureur-défricheur) et du
clergé séculier (pêcheur
d'âmes). Vision totalement anachronique, au XHe
siècle les ecclésiastiques étaient-ils
perçus comme au XIX et XXe siècles ?. De plus,
quant à la datation il suit Dangibeaud, à partir
de l'analyse des coiffures des Saintes Femmes analogues à
celle d'Aliénor d'Aquitaine sur son gisant de Fontevrault
qui daterait de 1210-1215.
Notre
interprétationII ne peut s'agir
de Tobie : aucune allusion au fiel et à un
contenant (outre, flacon, ou autre -qui parfois peuvent suffire pour
symboliser Tobie). De plus, le second personnage ne peut être
assimilé ni à l'ange Raphaël (il ne
porte pas d'ailes, la houe n'a jamais été
l'attribut de cet ange et il est chaussé ; seuls le Christ,
les Apôtres et les Anges sont
généralement pieds nus dans la sculpture romane),
ni à Tobit (il est aveugle et ne pourrait utiliser la houe
ni pour travailler la terre, ni pour ensevelir les morts, ni aider son
fils à porter le poisson salvateur - chronologiquement
impossible dans le Livre de Tobie. On notera l'importance du second
personnage dans les arguments de réfutation. Il s'agit donc
d'un thème profane : le pêcheur et le cultivateur.
La richesse, matérielle, apportée par une
pêche exceptionnelle, mais l'est-elle réellement,
pourrait être symbolisée par la richesse
vestimentaire.
Mais on peut
formuler une hypothèse
d'interprétation religieuse, une proposition de lecture qui
ne contredirait pas la première thèse, au
contraire. Elle lui donne un second sens symbolique, comme souvent dans
la sculpture romane.
Outre l'homme
transportant un poisson = pêcheur,
thème éminemment profane, la comparaison avec
Oloron s'impose, alors - un élément constitutif
du thème - la présence d'un second personnage,
souvent négligée par les commentateurs - nous
semble donner une nouvelle perspective à la
première lecture d'un homme portant un poisson
assimilé à un simple pêcheur. Cette
seconde présence, rare puisque rencontrée
uniquement à Bouliac (narthex) et à Saujon,
traduit un acte d'entraide qui modifie la lecture du message. Et s'il y
a message chrétien c'est là qu'il faut le
chercher : la solidarité. En cette époque de
croissance économique, d'expansion démographique
et simultanément des prémices de
l'individualisation (début des dénominations
individuelles), l'aide est primordiale, vitale. Le Pêcheur et
le Paysan s'associent dans l'effort pour produire des ressources
vivrières. Le discours de l'Eglise tend à
proposer aux hommes une vision en perpective de leur avenir,
au-delà d'une durée de vie. La richesse de la
récompense lors du Jugement Dernier,
l'éventualité du Salut grâce
à la protection divine, démontrées ici
par la richesse vestimentaire, qui s'explique ainsi. La richesse des
âmes, la richesse symbolique du vêtement.
L'excès même de la richesse des
vêtements et des chaussures en accrédite la valeur
symbolique. Ce que l'on peut savoir, grâce aux quatre
chapiteaux retrouvés à Saujon, et
malgré leur indépendance de tout contexte, du
programme iconographique du prieuré Saint-Martin, donne
l'impression d'un acte de foi -la Résurrection, la
Prorection divine, la Délivrance du
péché de l'âme chrétienne.
La position
fléchie des deux hommes, le genou à
terre pour le porteur du poisson, pourrait être lue - aussi,
sans perdre de vue
l'interprétation profane - comme signe d'infériorité, de soumission à Dieu, à qui serait offert le poisson, symbole des richesses terrestres et symbole religieux (l'offrande du poisson étant un thème biblique présent dans l'iconographie médiévale). L'offrande du poisson serait le geste symbolique du passage d'un monde à l'autre : de la Terre au Ciel, de l'humain au divin, rite de passage, rite d'éternité. Ce chapiteau de
première lecture -apparente- profane
s'inscrit donc bien dans une volonté mystique, dans une
pensée cohérente orientée vers la foi
dans le Salut et vers une vision eschatologique. Ce programme
iconographique est courant au début du Xlle
siècle. La parenté factuelle entre les quatre
chapiteaux de Saujon est aussi le signe d'une appartenance à
un même projet, relayé par les moines
bénédictins.
Conclusion
sous forme de vœuxl/ II serait opportun
pour mettre réellement en valeur ces
spécimens remarquables de la sculpture romane saintongeaise
de les faire profiter d'un meilleur éclairage.
2/ La reprise des fouilles aurait l'avantage de faire resurgir du sol qui a si bien conservé ces chapiteaux un des plus anciens éléments du patrimoine architectural de Saujon et peut-être de découvrir un contexte iconographique qui ferait avancer la recherche historique. Bibliographie Outre les
ouvrages référencés dans le
corps de l'article nous avons utilisé :
Barrali Altet (X.), Art roman en Auvergne, Ouest-France, Rennes, 1984. Craplet (B.), L'abbaye Saint-Pierre de Mozat, Imprimerie Lescuyer, Lyon, 1989. Davy (M.-M.), Initiation à la symbolique romane (Xlle diècle), Flammarion, Coll. Champs, Paris, 1977. Duguy (R.), Petit bestiaire roman d'Aunis et Saintonge, Rupella, La Rochelle, 1998. Fornas (F.-P.), Le bestiaire roman et son symbolisme, La Taillanderie, Châtillon-sur-Chalaronne, 1998. Garnier (F.), Le langage de l'image au Moyen Age I, Signification et symbolique, Le Léopard d'Or, Paris, 1982. Garnier (F.), Le Langage de l'image au Moyen Age II, Grammaire des gestes, Le Léopard d'Or, Paris, 1989. Garnier (F.), Thésaurus iconographique, système descriptif des représentations, Le Léopard d'Or, Paris, 1984. Garnier (F.), L'Ane à la lyre, Sottisier d'iconographie médiévale, Le Léopard d'Or, Paris, 1988. Wirth (].), L'image à l'époque romane, Cerf, Paris, 1999. La Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 1998. (1) Cb.
Dangibeaud : * Fouilles à
Saujon » dans la Revue de
Saintonge et d'Aunis. Bulletin de la Société des
Archives Historiques.
XXXHe volume, 5ème Livraison, 1er Octobre 1912, p. 256.
(2) J. Clouet, Un « roman » à clé : la statuaire religieuse du Xlle siècle en Saintonge —II- Dans l'Ancien Testament : les ascendants du Christ. SEFCO -Tome XIX- lOème livraison, juillet-Août 1986, N°135,p.580-582. (3)J. Lamberton, Lire nos vieilles pierres. Le Cercle-d'or, Les Sables a"0lonae, 1979. (4) Ch. Coanoué, Les églises de Saintonge. Livre II « Saintes et Marennes », p. 123- (5) R. Colle, Une église disparue de Saujon. Texte polycopié. (6) F. Eygun, Saintonge romane. Abbaye de La Pierre-qui-vire, Coll. Zodiaque, 1970,p.238. (7) P. Leriche-Andrieux, Itinéraires romans en Saintonge. Abbaye de La Pierre-qtii-vire, Coll. Zodiaque, Les travaux des mois, 13, 7976, p.76 (8) R. Crozet, l'Art roman en Saintonge. Ed. A. et}. Picard, 1971,p.l60-161 (9) Ch. Geinsbeitel, in L'imaginaire et la foi. La sculpture romane en Saintonge, s.d. Jacques Lacoste. Christian Pirot éditeur, 1998, article : « Saujon. Chapiteaux de l'ancienne église Saint-Martin » p.328-329. (10) P. Bouchoulle, Saujon, seigneurie-baronnie et le cardinal de Richelieu. Luçon, 1965.p.27. Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie en Saintonge Maritime N°22-2001 Mise à jour dec 2013/nov 2014 avec les photos d' ARBIS/janv 2015 Lagraulière et le sermon/2019/2020 ajout de la publication de J.P. Hible./2023 présentation revue |
||||||||||||