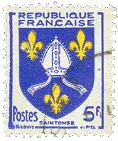|
L' ÈGLISE de PETIT-NIORT (17)
PETIT-NIORT (Rattaché à Mirambeau et à 15 kms au Sud-Ouest de Jonzac)  A un kilomètre au Sud de Mirambeau, au hameau de Petit-Niort, sur une courte section du vieux chemin royal, aujourd'hui doublé et remplacé par une route en lacets qui permet de gravir plus commodément la forte côte en direction de Bordeaux, se rencontre une curieuse et intéressante église.  C'est un très ancien édifice que les vicissitudes n'ont pas épargné et qui malgré de nombreuses mutilations a conservé des parties remarquables ainsi que des détails bien particuliers. Elle n'a pas été « construite par les Anglais » comme le dit la légende, mais très probablement réparée et modifiée par eux. La façade, le chevet et le chœur ont été classés en 1921. Petit-Niort est dotée d'une façade carrée qui l'apparenterait à la peu nombreuse catégorie des églises en arc-de-triomphe, comme Echillais, par exemple; mais il est possible que tel n'ait pas été son dessin d'origine. Vraisemblablement un pignon abattu en même temps que la nef et le clocher roman, n'a pas été rétabli. Au-dessus de modillons en bec de flûte d'une corniche disparue a été disposée une suite de petits arcs formant bande lombarde qui couronne aujourd'hui l'entablement. La façade, que n'encadre aucun contrefort d'angle, (mais il en existe sur les retours) se sompose essentiellement d'un grand portail en plein cintre, sans baies aveugles latérales et d'une galerie de sept cintres occupant l'étage dans toute sa largeur.  Le portail, que précède un large escalier de quatre marches, compte cinq voussures et un cordon double. Les claveaux sont nus, mais le cordon est orné d'un câble et de motifs géométriques. Les pieds-droits sont garnis chacun de quatre colonnettes à chapiteaux cerclés de listels. Les dents de scie des tailloirs, en se prolongeant à droite et à gauche, forment un bandeau qui s'étend jusqu'aux extrémités de la façade. La galerie s'appuie sur une étroite corniche ornée de chevrons. Les cintres retombent sur des colonnettes séparées par d'étroits pilastres et là, comme au rez-de-chaussée, les sculptures des tailloirs prolongées établissent un second bandeau interrompu seulement par le vide de la baie centrale. La façade se continue à droite par un mur de simple maçonnerie que perce une unique porte rectangulaire. Les murs latéraux, presque tous entièrement reconstruits en moellons, sont percés de fenêtres à un meneau, mais sur le côté Nord vers le milieu de la nef, une très ancienne et très remarquable fenêtre a été conservée. Peut-être plus ancienne que les similaires de Fenioux elle est aussi plus fruste. La clôture se compose de trois plaques de pierre. Celle du bas, est percée d'abord d'un rang de petites ouvertures cintrées, puis de plusieurs rangées de triangles irréguliers. Celle du milieu de plusieurs alignements et de nouveaux petits triangles et celle du haut, arrondie à son sommet, de trous vaguement carrés, grossièrement disposés en cercles concentriques.  Ces plaques de pierres ajourées, ancêtres des vitraux, très rares aujourd'hui, étaient destinées à éclairer les églises à une époque où le verre n'était pas d'un emploi courant. Celle de Petit-Niort est peut-être mérovingienne, (mais aujourd'hui elle ne traverse plus le mur). Le clocher reconstruit est une simple maçonnerie sans style, à toit pyramidal d'ardoise. Une ouverture cintrée perce chacune de ses faces. La cloche daterait de 1631. Le chevet, plus haut et moins large que le reste de l'édifice, a conservé au Nord des arcades indiquant de ce côté l'existence d'anciens bâtiments conventuels. Il est consolidé au Sud par des contreforts du XVe siècle entre lesquels s'ouvrent des fenêtres en ogive. Son mur oriental est curieux et mérite une mention particulière. Quoique plat, il comporte sur sa partie droite un bel ensemble roman, à éléments superposés. Au bas, presque au ras du sol, s'ouvrent deux petites baies très voisines l'une de l'autre avec bordure en tore et onglet entourant les cintres. Au-dessus trois étroites fenêtres (murées) dont les pleins cintres s'appuient sur de fines colonnettes adossées disposées 1, 2. 2, 1, avec chapiteaux annelés. Les voussures, entourées d'un cordon à pointes de diamant, sont décorées de losanges. Entre ces deux groupes d'ouvertures, une croix de pierre (aujourd'hui grecque) fait saillie sur le mur. Pareille disposition se rencontre très rarement en Saintonge, où, à part quelques exceptions, 3 ou 4 au maximum, les absides romanes généralement clunisiennes étaient toutes demi-circulaires. L'autre partie de cette face orientale, celle de gauche plus récente, est percée d'une grande verrière flamboyante à deux meneaux. Le tout est surmonté d'un pignon obtus. Une pierre porte une inscription latine. Acollée au mur Sud existe encore la base de l'ancienne tour d'escalier qui desservait le clocher roman. Elle est arasée et percée d'ouvertures en meurtrière. L'intérieur révèle mieux encore que l'extérieur les diverses campagnes de reconstruction qui, du XIVe au XVIe siècle, tant à la nef qu'au chevet, ont profondément modifié l'aspect de cet édifice.  La nef, aujourd'hui sans ornements, chaulée et plâtrée, a deux collatéraux. Celui de gauche, qui n'englobe pas le croisillon, est séparé de la nef centrale par des piliers carrés. Celui de droite, plus large, se poursuit jusqu'au mur du chevet. Trois de ses travées, voûtées en ogive, et dont les nervures se perdent sur des colonnes rondes ont des clés écussonnées. Les deux travées du chœur sont particulièrement curieuses. Elles ont aussi des voûtes d'ogive, mais leurs nervures sont, soit ondulées, soit bordées de chaque côté d'une ligne de chevrons très accusés, qui leur donne une apparence dentelée. Cette fantaisie est seule de son espèce en Saintonge. Dans cette partie de l'édifice se voient encore quelques colonnes romanes, mais leurs chapiteaux ont disparu et ceux qui restent ont été martelés. Près du croisillon Nord un escalier conduit à une chapelle-crypte en partie souterraine.  Très simple, avec sa grande voûte en berceau plein cintre, elle n'a comme ornement, à mi -hauteur des murs latéraux, qu'un cordon sculpté de feuillages et de losanges, le tout peint. Dans la nef il y a lieu de remarquer au-dessus de la porte d'entrée (en même temps que la menuiserie de celle-ci) un cordon de petits cylindres debout entre deux croix de consécration entaillées dans la pierre; un Christ en bois; une peinture bien mutilée représentant le Christ sur la Croix et quelques stalles en bois très simples. L'église de Petit-Niort est dédiée à saint Médart. ____ En avant de sa façade, qui porte les traces de nombreuses arquebusades, des sarcophages affleuraient le sol. Derniers vestiges de l'important cimetière entourant autrefois le sanctuaire et qui recueillit pendant des siècles les dépouilles de nombreux pèlerins, succombant à l'aller ou au retour sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice. Une belle croix de procession se dresse au sommet de la côte qui domine Petit-Niort au Sud. Elle a remplacé une croix plus ancienne, élevée peut-être pour commémorer un combat. (MASSIOU nous indique, en effet, dans son « Histoire de la Saintonge » que non loin vers l'Ouest eut lieu une rencontre des armées anglaises et françaises, en 1195, sur les bords du ruisseau le Gaure : rencontre, rendue sérieuse par l'importance des intérêts en jeu. Les troupes en présence étaient commandées par les deux rois en personne. Richard Cceur-de-Lion d'une part et Philippe-Auguste de l'autre. Des évêques-médiateurs négocièrent la paix (1). (1) Cette indication répétée par nombre de chroniqueurs, est cependant inexacte, tout au moins quant aux données géographiques. Le ruisseau « le Gaure » n'existe pas aux environs de Petit-Niort. Il est plus vraisemblable d'admettre que la rencontre (non suivie de bataille) eut lieu au Sud-Est de Niort (2 Sèvres) non loin d'un hameau nommé « La Gorre » près d'Epannes. Ajoutons que jadis Petit-Niort, alors plus important que de nos jours, se désignait rarement ainsi. Il s'appelait couramment Niort et ses habitants les Niortais. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________ A.D. oct 2023 |