|
L'église
romane de MONTMOREAU (16)
en
SAINTONGE
Texte
intégral de
Charles CONNOUË
Photos ex wikipédia que je soutiens
et Ministère de la Culture et de Mr Jean-Marie Sicard pour la chapelle.
MONTMOREAU
Chef-lieu de Canton, Arrondissement de BARBEZIEUX (à 26 kilomètres au Sud-Est de Barbezieux)
Montmoreau n'a pas fait partie de l'ancien
diocèse de Saintes, mais est à la limite même de ce
diocèse vers l'Est et possède deux bijoux de l'art roman :
A. — L'ÉGLISE SAINT-DENIS

Cette belle et importante construction est donnée ici pour le
parfait classicisme de ses lignes et la pureté de son dessin.
Elle date, dans son ensemble du XIIe siècle, mais a
été restaurée aux XVe et XIXe siècles. Elle
figure depuis 1840 aux Monuments Historiques.
Bâtie sur un plan en forme de croix latine, elle comprend, une
nef à trois travées et, demie, un large transept avec
absidioles et une abside demi-circulaire.
La façade à pignon est divisée verticalement en
trois aires inégales par quatre fortes colonnes montant
jusqu'à la corniche, sur laquelle s'appuie le pignon. Cette
corniche à modillons (quelques-uns travaillés) porte une
fenêtre romane à colonnettes.
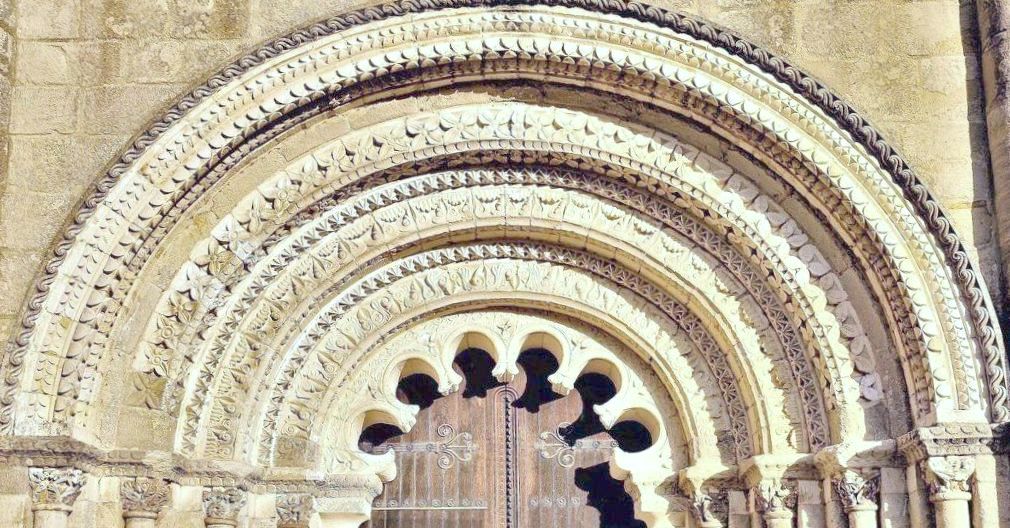
Au rez-de-chaussée, s'ouvre un grand et profond portail à
cinq voussures ornées de motifs géométriques. La
plus petite est découpée en lobes. Les deux baies
latérales aveugles, à double voussure, ont
été agrémentées d'un lion sculpté
sur chacun de leur tympan. Au premier étage
s'élèvent sur un fin bandeau cinq hautes baies à
colonnettes disposées 1, 3 et 1. Leur largeur est
inégale, la centrale seule est percée. Tous les cintres
extérieurs sont ornés de cordons à pointes de
diamant très accentuées qui constituent, à eux
seuls, une décoration et suffiraient presque à donner
à cette façade, un cachet de réelle
élégance. Tous les cintres, bien qu'inégaux, ont
tous à peu près la même hauteur. Il en
résulte que certains sont surbaissés et d'autres
outrepassés.
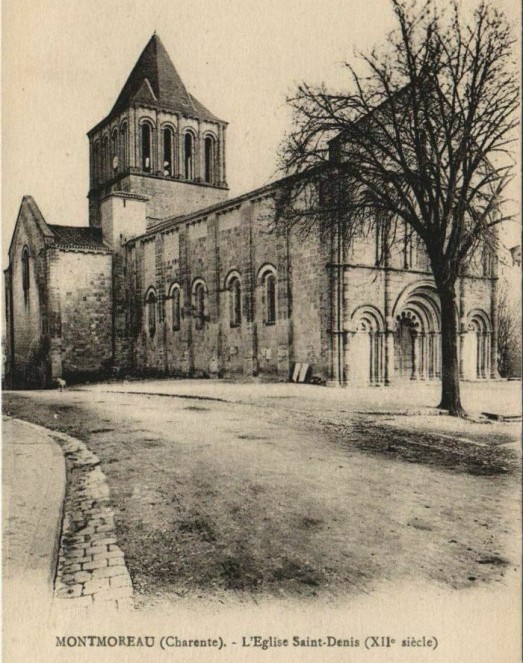
Le clocher, reconstruit dans le style roman, élève sur
une haute souche carrée et nue un étage ajouré sur
chaque face de quatre longues fenêtres à colonnettes
encadrées par des colonnes à chapiteaux. Ces colonnes
montent jusqu'à une corniche à modillons portant une
flèche pyramidale d'ardoise. Sur de longues colonnes formant
contreforts autour de l'abside (percée de cinq larges baies en
plein cintre), repose une corniche à modillons ouvragés.

A l'intérieur, vaste et élevé, où l'on
descend par dix marches, les travées de la nef, toutes
voûtées en berceau légèrement brisé,
sont séparées par des doubleaux posés sur de
hautes colonnes adossées à des pilastres. Sur ceux-ci
retombent des arcs à double rouleau coiffant soit une
fenêtre, sans ornements, soit deux, alors séparées
par une colonnette à chapiteau nu. Un cordon de pointes de
diamant suit les cintres et un autre court à hauteur des
tailloirs des grandes colonnes.
Une belle coupole sur pendentifs recouvre le carré du transept
dont les croisillons sont, eux aussi, voûtés en berceau
brisé. L'absidiole de gauche a été au XVIe
siècle, remplacée par une petite chapelle gothique.

L'abside, du type régional, et voûtée en
cul-de-four, est décorée d'une arcature à sept
cintres posés sur six colonnes à beaux chapiteaux.
Le ruisseau voisin guérissait de la stérilité les femmes qui venaient s'y baigner.
B.
CHAPELLE DU CHÂTEAU
Montmoreau est bâtie sur le versant
oriental d'une haute colline, au pied de laquelle coule la Tude et dont
le sommet est occupé par un vieux et important château
encore entouré de ses anciennes défenses.

La partie habitable, reconstruite au XVIIe siècle et
encore occupée récemment, est abandonnée
aujourd'hui, et s'achemine, malheureusement, elle aussi, comme les
bâtiments plus anciens, vers la ruine définitive.
Non loin de l'entrée principale de l'enceinte, sur l'esplanade,
d'où la vue est superbe et à laquelle on accède
par une suite de rues bordées de belles et nombreuses maisons
bourgeoises qui ne dépareraient pas une grande ville ; existe
encore à moitié enfouie dans la terre (ou à
moitié dégagée) une ancienne chapelle seigneuriale.
C'est un très curieux monument qui étonne à
première vue par sa position, son appareillage, mi-partie
moellons

Photo Jean-Marie Sicard
et par ses sculptures qui en font un des plus beaux ouvrages d'art roman qui se puissent voir en Saintonge.
Il est lamentable que de pareilles beautés, souvenirs d'un
passé aussi riche de perfection que d'histoire, soient ainsi
livrées à toutes les déprédations.
Cette petite chapelle, complètement isolée, affecte une
forme curieuse, Extérieurement, ses murs droits et à
moitié enterrés n'ont aucune décoration. Son plan
est bizarre. Autour d'une demi-coupole sont disposées en
trèfle trois toutes petites absidioles et vers l'Ouest, une
courte nef traversée par un large passage ouvert en biais et de
guingois. Mais la coupole (en moellons) repose sur une arcature
appuyée sur huit colonnes. Les arcs, les portes, les
fenêtres et les colonnes sont ornés de motifs divers et
surtout de très beaux et très riches chapiteaux
supérieurement travaillés.
Piscine, armoire, cuve baptismale et tous détails encore
existants sont à remarquer, à détailler et
même à étudier.
Dans ce petit monument de dimensions restreintes, mais si curieusement
disposé et dessiné, se trouvent accumulées une
profusion de sculptures d'époque et de détails
excellemment exécutés, qui suffiraient à orner et
à faire la réputation d'une église bien plus
importante. Ce bijou roman devrait avoir depuis longtemps retenu
l'attention des Pouvoirs Publics.
Il existe en Saintonge des édifices classés qui sont loin
de valoir celui-ci. Dégagé des terres et des pierrailles
qui l'entourent, il mériterait d'être
protégé des méfaits des galopins du voisinage qui
en ont fait un terrain de jeux, puis après quelques
légères restaurations, enfermé dans une
clôture et conservé pieusement et précieusement.
Mais le département de la Charente est (sans l'être
toutefois autant que son voisin de l'Ouest) riche en œuvres d'art
médiévales. Est-ce la raison pour laquelle il semble se
soucier si peu de beautés aussi irremplaçables que
celles, par exemple, de Conzac (voir Saint-Aulais), de
Marcillac-Lanville, de celle ci-dessus, etc... Peut-on dire, exprimant
l'idée de maints visiteurs, que c'est regrettable.
____________________Fin du texte de Charles
CONNOUË
Les
églises de SAINTONGE
livre IV épuisé
édition:
R.DELAVAUD (Saintes)
avec leur aimable
permission._______________________________
__________________
La chapelle Notre-dame
( texte sur le site de la mairie)
La
chapelle Notre-Dame faisait partie de la première enceinte du château
et n'existe plus aujourd'hui que dans sa partie basse. L'édifice a été
classé monument historique en 1952. Située dans l'allée nord de la
colline, elle se compose de deux parties bien distinctes appartenant à
des époques différentes : la nef porche et la chapelle proprement dite.

Photo Jean-Marie Sicard
On
accède à l'édifice par la nef porche. C'est la partie la plus ancienne,
elle date de la fin du 10e siècle. Elle comporte deux travées de voûtes
plein cintre d'inégales grandeurs parce que l'arc doubleau qui les
réunit n'est pas à angle droit. Les murs nord et sud de la travée
principale servant de porche sont percés de deux hautes arcades à jour
sans fermeture. La travée située à l'ouest ne comporte aucune
ouverture. Elle est plus haute que la travée principale, mais moins
large et moins longue. Elle forme le narthex de l’édifice cultuel. Vers
l'est, une arcade basse donne accès à la chapelle. Dans son orientation
nord-sud, cette nef est donc le porche du château et, dans son
orientation liturgique traditionnelle ouest-est, elle sert de vestibule
à la chapelle.
Le sanctuaire de la chapelle proprement dite date
de la fin du 11e siècle. Il est construit sur la plan du saint
Sépulcre. Il présente une rotonde romane où rayonnent trois absidioles
en cul de four. Elles sont éclairées par des fenêtres cintrées à
colonnettes d'ouvertures inégales. Des colonnes libres supportent huit
arceaux sur lesquels s'élève la coupole centrale de 5, 85 m de
diamètre.

Photo Jean-Marie Sicard
Ces colonnes sont ornées de chapiteaux de grande beauté. Dans
l'une des absidioles, une piscine baptismale se trouve dans l'évidement
du mur : elle rappelle les éviers en pierre des anciennes maisons
rurales de la région. Cette chapelle était couverte de fresques
aujourd'hui disparues. Elle abrita des reliques offertes à la
vénération des pèlerins. On peut également remarquer un curieux
bénitier rudimentaire, en forme d'auge.
Ce type d'édifice,
offrait aux pèlerins un abri et un lieu de prière accessible jusqu'à ce
que le pont-levis soit relevé. Ils trouvaient ainsi un asile dans
l'enceinte du château, mais sans pouvoir accéder aux autres édifices.
Les photos de Jean-Marie Sicard sont sous droits réservés.
|