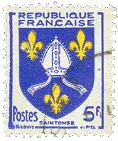|
L'église de JONZAC en SAINTONGE
JONZAC , sous-Préfectnre à 40 kms an Sud de SAINTES Le « Pays de Jonzac » a connu une grande activité dès l'antiquité romaine et même gauloise. Des voies de grandes communications le traversaient, des chemins nombreux, signes de la richesse de son sol, le sillonnaient. La douceur de son climat retint, en effet, de bonne heure, une abondante population qui fut à l'origine des multiples agglomérations, villages et bourgs qui y existent encore de nos jours. Zone de passage, la féodalité y entretint en divers points stratégiques d'importantes forteresses.. Jonzac fut, à son origine, l'un de ces points et de ce fait ne rentra guère dans l'Histoire qu'aux XIe et XIIe siècles et surtout aux XIVe et XVe, c'est-à-dire au moment où, par suite de la guerre de Cent ans, son château place forte et sentinelle avancée aux marches méridionales de la Haute-Sain-tonge, était « en perpétuel éveil ». Alternativement français et anglais, ce château vaste, bien et solidement construit, dont les importantes parties encore debout font la renommée touristique de la ville actuelle, accuse par son aspect général le XIVe siècle. Il fut la propriété successive de puissantes familles seigneuriales qui illustrèrent les annales de la région : Les Lusignan, les de la Roche-Andry, les Sainte-Maure, les d'Esparbès de Lussan, etc... Assiégé trois fois en 145o, 1453, 1570, plusieurs fois mulilé et modifié, il commença au XVIe siècle son rôle encore actuel d'immeuble d'habitation, par l'adjonction d'une aile au levant. Il reçut dès lors des hôtes illustres : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Au XIe siècle, la châtellenie de Jonzac, à laquelle Charlemagne avait donné un commencement d'attention deux cents ans plus tôt, était intégrée dans les immenses domaines des Lusignan. Elle devint barorinie, puis comté. Il n'existait à cette époque qu'une simple chapelle dans l'enceinte du château et le nom de Jonzac ne s'appliquait alors qu'à un ensemble fortifié. Puis vers la fin du XIIe siècle une église fut construite, mais de l'autre côté de la Seugne. Elle resta de ce fait longtemps dans la dépendance de la grosse paroisse de Saint-Germain, avant de passer dans celle d'Archiac. Cette situation se prolongea pendant tout le Moyen Age. En 1671, Elie VINET ne mentionnait pas Jonzac parmi les villes de la Saintonge, et l'agglomération ne prit vraiment figure de cité qu'au commencement du XVIIIe siècle, grâce à l'excellence de son terroir, partagé entre la Petite Champagne, les Fins Bois et les Bons Bois qui fournit un « Cognac » renommé. Ce n'est cependant qu'après la Révolution que Jonzac devint Sous-Préfecture. Son église très éprouvée par la guerre de Cent ans fut, après de grosses réparations au XVe siècle et de nouvelles mutilations au XVIe, presqu'entièrement reconstruite de 1847 à 1864. Elle le fut alors sur des bases élargies mais dans un style roman exact, afin d'harmoniser les restaurations avec quelques parties qui avaient pu être conservées, le portail notamment et divers pans de murs (sur lesquels se remarquent de nombreuses traces de mousqueterie). L'élévation occidentale, très large, a, grosso modo, la forme d'un triangle dans lequel s'inscrit une façade romane carrée. Un clocher, carré aussi, s'élève au sommet du pignon obtus. La partie romane, restaurée avec art, comprend un rez-de-chaussée et deux étages. Elle est divisée en trois aires par quatre colonnes changeant plusieurs fois de diamètre. En bas s'ouvre un large portail accompagné de de deux baies aveugles. Les trois pleins cintres (quatre voussures nues pour l'un, une seule pour les autres) sont bordés d'un cordon sculpté. Des chapiteaux à feuillages et à crochets surmontent les colonnes des pieds-droits. Deux de ces chapiteaux, à gauche, sont anciens et historiés. Leur mutilation les rend malheureusement presqu'illisibles. Le premier étage est occupé par quatre larges baies aveugles en plein cintre à deux voussures et cordon. Le deuxième par une baie centrale entourée de cinq gros tores et accompagnée à droite et à gauche de trois baies aveugles à voussure unique. Les arcs s'appuient sur des colonnettes à chapiteaux. Certains tailloirs prolongés forment bandeaux. Les colonnes et colonnettes de séparation qui, au nombre de huit, se dressent sur cette façade, présentent une disposition des plus curieuses. Elles se terminent toutes, en haut du deuxième étage, par une sorte de petite lanterne formée d'un côrie très pointu porté par quatre minuscules colonnettes entre lesquelles apparaissait une tête humaine. Aujourd'hui, il ne reste que deux de ces têtes. Nous ignorons la signification et l'origine de cette bizarrerie dont nous regrettons de n'avoir pu trouver l'explication. L'agrément de cette jolie page d'architecture provient de l'heureux agencement de ses lignes courbes et droites; mais la décoration sculptée est intéressante aussi. Elle abonde en tores, pointes de diamant, guirlandes de fleurs rondes, câbles, torsades, arabesques enlaçant des animaux : oiseaux, poissons, sangliers, etc..., feuilles de laurier, d'acanthe, disques avec croix, tulipes, épis de blé, etc. Aux extrémités de la façade, s'ouvrent deux portes auxiliaires, surmontées chacune d'une fenêtre ogivale à un meneau. Le clocher se dresse au sommet même du pignon. Les faces sont ornées de trois fenêtres imitées du roman avec colonnes simples ou doubles, portant sur une corniche, une flèche pyramidale. Les fenêtres sont toutes surmontées de deux petites baies aveugles cintrées. Sous le pignon du mur plat du chevet s'ouvre un grand oculus à quatre lobes. Le mur Sud, divisé en cinq aires inégales par des contreforts, est percé dans les parties reconstruites, de cinq grandes ouvertures en plein cintre. Le mur Nord, entièrement remonté et celui du chevet — légèrement en retrait — ont de grandes fenêtres ornées de tores, de cordons et de tailloirs sculptés prolongés. A l'intérieur, trois nefs larges, voûtées en plein cintre (matériaux légers) développent leurs cinq travées séparées par des groupes de quatre colonnes engagées sur des piliers carrés. Les chapiteaux modernes sont garnis de feuillages. En avant de la nef principale un porche-narthex occupe la base du clocher. L'abside est toute entière revêtue d'une décoration ogivale tri et quadrilobée. Aux murs se remarquent quelques bonnes toiles dont une Sainte Rose-de-Lima (voir Agudelle). L'église de Jonzac est dédiée à saint Gervais et à saint Protais, martyrisés à Milan, au IIe siècle. Annuellement a lieu à Jonzac, le 16 Juillet, « la Mont-Camel » qui fut jadis la fête très courue de Notre-Dame du Mont-Carmel. A l'origine de cette solennité il y a le souvenir d'un antique sanctuaire élevé à la gloire de la mère de Dieu sur le Mont Carmel en Palestine. Toute l'église observa longtemps cette fête qui engendra de nombreux pèlerinages. Beaucoup se sont perdus. Celui de Jonzac subsista, aidé et entretenu par une confrérie de Carmes, qui disparut à la Révolution. (La chapelle du couvent sert aujourd'hui de Palais de Justice). Les fidèles venaient de très loin et se pressaient par milliers aux différentes messes de la journée où ils recevaient une bénédiction spéciale. Au siècle dernier une fête profane se greffa sur la fête religieuse. Aujourd'hui, et bien que la célébration des offices ait toujours lieu, il ne s'agit plus guère que d'une frairie et d'une sorte de foire commerciale qui dure trois jours. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________
AD mai 2023 |