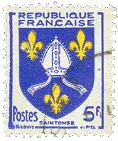|
L'église
de GRÉZAC
Commune du Canton de COZES (à 3 kilomètres au Nord de Cozes et à 24 kilomètres de Saintes) Très belle crypte Inscrite aux Monuments Historiques et très curieuse église inscrite l'Inventaire supplémentaire des M.H.Cet édifice est un amalgame de constructions, d'âges et de styles divers, de décorations variées et de motifs inhabituels dont l'ensemble produit d'abord une certaine surprise, mais dont l'examen détaillé intéresse au plus haut point. Dédiéeà Saint Symphorlen, l'église de Grézac a été bâtie au XIIe siècle. De cette première construction qui a constitué la nef gauche actuelle, subsiste l'abside romane. Au XIVe siècle il y eut adjonction d'une chapelle sur le coté droit. La démolition de la façade occidentale de cette chapelle, effectuée une centaine d'années plus tard, fut à l'origine de la création de la nef de droite obtenue par le prolongement des murs jusqu'à l'aplomb de la façade alors existante, celle de la nef de gauche. Ces remaniements et ces modifications successives ont finalement donné un ensemble large et écrase dans lequel les diverses parties se pénètrent sans s'ajuster. C'est ainsi que les deux constructions accolées, séparées par un rang de fortes colonnes cylindriques se terminent chacune par une abside différente, l'une demi-circulaire romane, l'autre à chevet plat avec entre elles un pan de mur percé de fenêtres en plein-cintre qui ouvraient primitivement sur l'extérieur. Photo internet Le clocher, petite et simple élévation sans style, flanqué à gauche la façade du XVe siècle. Celle-ci est tout entière occupée par une grande baie ogivale qui en coiffe deux plus petites dont les cintres sont garnis de lobes ajourés Au-dessus règne un fronton où se remarquent plusieurs scènes sculptées originales et fort curieuses. C'est tout d'abord deux baies en tiers-point qui encadrent quatre personnages figurant le jugement d'un martyr. Celui-ci reçoit la bénédiction divine et est conduit au supplice par un soldat. A droite et à gauche de ces deux baies s'alignent des sujets divers : ( Le tardif symbole de la recherche du Christ symbolisé par un cerf _ guide sacré et sacrifié disent certains _ la flèche étant l'âme visant la perfection et le centaure l'homme encore empétré dans le non spirituel, d'ou le corps animal-homme du centaure) un centaure décochant une flèche à un cerf qui fuit vers une forêt et surtout un petit tableau amusant et fort bien rendu représentant la fable du « Renard et de la Cigogne »  (Photo internet) Le mur droit de la nef est extérieurement consolidé par de nombreux contreforts. L'un deux est creusé d'une niche avec entourage en ogive trèflée. Le mur gauche, refait récemment, percé d'une seule fenêtre, est nu. L'abside double, mi-partie romane mi-partie ogivale, fait curieusement ressortir la soudure extérieure des deux constructions. A l'intérieur les anciennes voûtes de la nef ont disparu, remplacées par un tillis horizontal sur la nef de gauche et arrondi sur celle de droite. Mais ce plafond n'a pas suffisamment d'élévation de sorte que le tillis échancré devant chaque fenêtre les coupe disgracieusement. A droite le chœur et l'abside, surhaussés de sept marches, sont recouverts d'une seule voûte sur croisée d'ogives en matériaux légers qui écrase les belles fenêtres gothiques surfout celles du chevet. De larges baies latérales en tiers-point sont séparées par des massifs d'élégantes et fines colonnettes. De beaux chapiteaux ornent les angles.. A gauche la deuxième abside ou plus exactement la première, puisqu'il s'agit de la plus ancienne, développe sa demi-circonférence ornée de remarquables fenêtres romanes avec cintres et colonnettes a chapiteaux très fouillés. Une voûte en cul-de-four la recouvre et s'appuie sur quatre colonnes à chapiteaux intéressants. ( le signe du bélier _ symbole de naissance animale _ est omniprésent. Il se termine ici en boule symbole de la perfection. C'est en quelques sortes le thème archaisant de la quête du spirituel) Une fenêtre en plein-cintre est ornée d'un cordon richement sculpté qui se prolonge d'un côté et de l'autre. Ici la décoration est purement romane et le contraste est vif entre les deux parties de ce chevet. Mais le mélange des styles ne s'arrête pas là. De nouveaux " embellissements " sont venus, après le XVe siècle, s'ajouter à ceux existant déjà. C'est ainsi que dans l'abside romane on peut voir près d'une fenêtre et plaqué au mur un grand motif en stuc du plus pur style flamboyant et dans l'angle gauche de la nef près de la porte d'entrée une importante scène, avec sujets presque grandeur nature, représentant le « Baptême du Christ ». Une quinzaine de personnages bibliques sont agenouillés ou debout sous des palmiers, tandis que dans le ciel Dieu le père apparaît dans une gloire... Cet ensemble, a vrai dire en plâtre, qui semble dater du siècle dernier, surprend par sa présence même. Il rappelle la décoration des églises espagnoles — couleurs en moins. Cependant l'église de Grézac a d'autres raisons de mériter sa renommée artistique et archéologique. Sous l'abside de droite existe une crypte des plus remarquables. Dans son état actuel cette crypte-ossuaire a près de 5 mètres d'élévation. C'est un carré parfait de 7 mètres de côté. Au centre s'élève une colonne surmontée d'un extraordinaire chapiteau, malheureusement mutilé et difficile à détailler, même à voir. Il représente les damnés aux enfers. Ce chapiteau reçoit les retombées d'arcs ogivaux qui divisent la voûte en quatre compartiments fermés chacun en ogive ài huit branches. Dans les angles les arcs retombent sur quatre courtes colonnes à très curieux chapiteaux bizarement ornés et au milieu des murs sur des crédences sculptées. Les colonnes sont portées par une large corniche à modillons qui, à hauteur d'homme, fait le tour de l'ossuaire. Des traces de peinture du Moyen Age se voient encore aux murs et à la voûte. Quatre cheminées-fenêtres débouchent à l'extérieur. Cette crypte est une des plus belles qui se puisse voir en Saintonge. Près de l'entrée de l'église dans la nef, une magnifique pierre tombale du XV tiède est dressée contre le mur. Cette pierre brisée et incomplète a été sauvée par hasard au siècle dernier d'une totale destruction. Elle avait déjà été employée par des ouvriers dans les fossés d'un chemin vicinal. Elle porte gravée en trait l'effigie d'un chevalier de Longchamp qui fit reconstruire en partie l'église au XVe siècle. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________
|