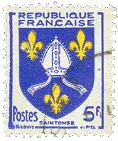|
L'église
romane de CHALAIS (16)
CHALAIS Chef-lieu, de Canton, Arrondissement de BARBEZIEUX (à 28 kilomètres au Sud-Est de Barbezieux)  La coquette petite ville de Chalais est dominée à l'Ouest par une haute colline à pic, couronnée par un important château de date relativement récente, mais qui a cependant conservé quelques parties du XIVe siècle, un pont-levis et un puits extraordinaire. Le château a remplacé une forteresse plus ancienne, longtemps occupée par les Anglais. Au pied de la colline coule la Tude. Chalais est presqu'à la limite de la Saintonge vers le Sud-Est. Au delà de la rivière la campagne change brusquement d'aspect et annonce le Limousin. L'église de Chalais, dédiée à saint Martial, située sur la colline et près du château, faisait partie de l'ancien diocèse de Saintes. Elle date de la deuxième moitié du XIIè siècle, mais n'a conservé que sa façade, elle-même très mutilée. Tout le reste brûlé et détruit par les calvinistes en 1569, a été sur d'autres plans, rétabli au début du XVIIè siècle et restauré il y a quelques années. Cette façade remarquable est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1902. Très large, car elle précédait jadis un intérieur à trois nefs et dressée sur une banquette, elle ne présente plus aujourd'hui qu'un rez-de-chaussée, surmonté d'un pignon obtus. Elle est encadrée et divisée en trois aires inégales par quatre groupes de deux colonnes montant jusqu'à une corniche presqu'entièrement détruite par la chute des parties supérieures. Un vaste portail occupe l'aire centrale. C'est un des beaux portails romans de la province. Il comprend cinq voussures en plein cintre complétées chacune par une fine archivolte sculptée (sauf la plus petite qui est découpée en lobes). Sur ces cordons se distinguent des palmes, des arabesques, des pointes de diamant, une suite de fleurs (tulipes), etc. Les quatre grandes voussures richement décorées, même sur leur intrados, ont reçu : la première, des motifs en forme de croix de Malte ; la deuxième, une suite de médaillons ornés au centre d'un animal ; la troisième, des rubans dessinant des losanges ; la quatrième, des marguerites à quatre pétales perlés. Les chapiteaux des colonnes des pieds-droits, très fouillés, sont garnis de végétaux et d'animaux. Malheureusement les incendies du XVIè siècle ont dégradé les sculptures, surtout celles des grands arcs, au point de les rendre, pour beaucoup, à peu près indiscernables.  Les femmes au tombeau Chacune des aires latérales est occupée par une baie aveugle à deux voussures, de décoration identique à celle du portail. Les deux tympans sont historiés ; à gauche, trois personnages assis, la Vierge, saint Jean et le Christ ; à droite, la Résurrection. Remarquer sur le fronton du tombeau les mêmes croix que sur les voussures du portail. Les vestiges de six statues se voient encore de chaque côté des grands cintres, ainsi que d'autres traces d'ornementations disparues, sur les parties anciennes de la façade. Le pignon reconstruit a remplacé un étage, peut-être deux, comme à Aubeterre, vraisemblablement très ornés. Cette façade dans sa gloire d'origine devait être splendide ; mais peu de ses pierre son demeurées intactes. Récemment beaucoup ont été remplacées. Néanmoins cet ensemble constitue une superbe page d'art roman, d'une conception très pure, d'un réel caractère artistique et d'une parfaite exécution. Sur les retours des angles de façade, des colonnes jumelées consolident les murs latéraux qui, construits en moellons, reposent sur des restes de l'ancienne construction. Un petit clocher carré à longue flèche d'ardoise, sans aucune prétention, s'élève sur le côté Sud. L'intérieur, aujourd'hui à nef unique, est voûté jusqu'au carré d'un tillis cintré peint de personnages en buste dans des médaillons. Le chœur étroit, avec une petite tribune de chaque côté, précède une abside sous cul-de-four percée de trois fenêtres. De nombreux tableaux garnissent les murs, quelques-uns de bonne facture. Des bâtiments conventuels du XVIIè siècle existent encore derrière l'église. Un souterrain est signalé sous l'église. Il faisait probablement partie de« défenses de l'ancien château dans lesquelles l'église était incluse. Il est nécessaire, après la visite de l'église de Chalais, d'aller voir celle d'Aubeterre à 12 kms à l'Est (se reporter à ce nom sur ce site). Les deux édifices d'une même époque, d'une même conception et très probablement construits par le même atelier, ont été soumis aux mêmes vicissitudes. Ils s'expliquent l'un l'autre. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________
|