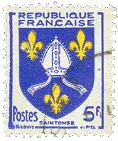|
L'abbaye de CHASTRES (16) en Saintonge
Texte intégral de Charles CONNOUË Commune de SAINT-BRICE, Canton de COGNAC (à 5 kilomètres à l'est de Cognac) Dans un vallon solitaire et boisé, d'accès difficile (impraticable en hiver) entre Saint-Brice et Julienne, à quelques centaines de mètres du beau logis de Gardépée, s'élèvent les ruines de ce qui fut au XIIIe siècle, temps de sa splendeur, l'opulente Abbaye de Châtres. Ruines en bon état d'ailleurs : « restes abandonnés » (restaurés en 2021), devrait-on plutôt dire. Abandonnés ils le sont depuis des siècles, oubliés même et utilisés au gré des preneurs d'occasion, tantôt comme remise à fourrage ou écurie à bestiaux ; tantôt comme fabrique de poterie ou refuge de vagabonds. Ce très bel édifice, heureusement parvenu jusqu'à nous, n'a dû qu'à la solidité de sa construction et peut-être aussi à la difficulté particulière de sa démolition, de ne pas disparaître complètement. Il est aujourd'hui (vers 1950 !) un but d'excursion d'autant plus fréquenté qu'il permet d'unir dans un même agrément, le charme d'une promenade dans un site pittoresque et le plaisir que procure la visite d'un chef-d'œuvre riche en beautés artistiques et archéologiques. (en 2013) L'Abbaye de Châtres, de l'ordre de Saint-Augustin, fut fondée en 1077 (certains disent entre 976 et 1002) par un Seigneur de Bourg-sur-Charente. Elle connut vite une grande prospérité, car ses revenus étaient considérables et ses privilèges fort nombreux. Elle bénéficiait de redevances provenant de points très éloignés : Pérignac, Saintes, Pons, Oléron. Son église, dédiée à Notre-Dame de l'assomption, qui seule, a subsisté, fut construite, ou plutôt reconstruite, entre la fin du XIIè siècle et le début du XIIIè sur un plan classique en forme de croix latine. A ses voûtes d'abord en berceau succédèrent bientôt des coupoles : trois sur la nef et une sur le carré du transept, alors surmonté, dit-on, d'un clocher roman. En partie ruinée par les Anglais, au cours de la guerre de Cent ans, puis restaurée (au XIVè siècle, un chevet droit remplaça l'ancienne abside demi-circulaire) elle fut, deux cents ans plus tard, victime cette fois de discordes religieuses, saccagée par les protestants. Les bâtiments conventuels détruits ne laissèrent aucune trace. Le bras Nord du transept s'écroula, les objets du culte incendiés disparurent. Les moines dispersés ne reconstituèrent jamais leur communauté, le vallon privé de leurs chants retomba dans sa solitude et les vieilles murailles s'empanachèrent peu à peu de lierre et de ronces. Dégagée, au début du présent siècle puis timidement réparée, il y a quelques années (le pignon a été remis en état et la toiture refaite), Châtres dresse aujourd'hui dans sa prairie marécageuse, la haute et prestigieuse masse de sa claire construction dont la présence étonne en ce lieu. Mais le pur dessin de sa façade, l'exceptionnelle qualité de ses sculptures et la majestueuse hauteur de ses voûtes, classent cette ancienne église abbatiale parmi les plus beaux monuments de la région et même de la province.  La façade est d'une rare distinction de lignes. Son type (trois portes, deux arcatures superposées, un pignon) se retrouve fréquemment dans cette partie de la Saintonge, mais aucune imitation n'égale le modèle ou, si elle même est imitation, elle dépasse largement celles qui ont pu lui servir de modèle. Élevée, élancée même, elle est enserrée entre de fins contreforts d'angle auxquels sont adossées deux très longues colonnes qui, montant du sol atteignent jusqu'au pignon. Ces colonnes qu'aucun cordon, aucune corniche ne viennent couper, accentuent encore cet « élan vers le haut » que l'architecte a voulu et parfaitement réalisé. Le vaste portail en plein cintre flanqué de deux fausses portes, compte quatre voussures et un large cordon. Les claveaux sont nus, mais les angles des voussures, comme ceux de toutes les autres voussures de la façade, sont amortis en tore. L'arc intérieur du portail découpé en lobes était pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle un signe de ralliement. En route pour l'Espagne ou sur le chemin du retour, ils savaient trouver là, en tout temps : vivres, gîte et soins. Un large bandeau sculpté réunit les chapiteaux du rez-de-chaussée et traverse la façade. Sa décoration à seule base d'arabesques et de feuillages est l'œuvre d'un maître et révèle une habileté rarement atteinte dans l'art de travailler la pierre. Le premier étage, d'une hauteur inaccoutumée, s'élève sur une fine corniche sans modillons, mais ornée de feuilles arrondies en crochets. Il est garni d'une arcature à cinq cintres légèrement brisés sauf celui du centre qui, plus large et plus élevé, est seul percé d'une grande fenêtre à deux rouleaux. Les arcs bordés d'un cordon s'appuient sur de longues colonnes isolées ou groupées (une est torsadée, une autre couverte d'écailles). Un nouveau bandeau délicatement travaillé coupe la façade à hauteur des chapiteaux. Le deuxième étage dressé également sur une frise finement ciselée est occupé, d'un contrefort à l'autre, par une suite de neuf baies aveugles aux cintres à peine brisés retombant sur des colonnes à chapiteaux d'une excellente composition. Enfin, une troisième frise semblable aux précédentes souligne le pignon et termine une façade qui est une des plus parfaites de la Saintonge. Voici d'ailleurs ce qu'en disait, vers 1900, le grand voyageur Ardouin-Dumazet auteur de nombreux ouvrages de « Voyages en France » aujourd'hui à peu près introuvables : « ...Certes, elles sont nombreuses (en Saintonge) les églises romanes où le goût sobre et pur de nos pères, s'est donné carrière, mais nulle part l'art roman ne se montra avec plus de délicatesse, nulle part les ornements simples et exquis à la fois, n'encadrent mieux les fenêtres et le porche ; nulle part les colonnettes ne sont de proportions aussi parfaites que dans cette page pleine de force, de grâce et d'harmonie ».  L'intérieur, non clos et entièrement nu, est impressionnant d'étendue et d'élévation. La nef comprend trois travées couvertes de vastes coupoles sur pendentifs justement qualifiées d'aériennes. Elles sont portées par de hautes colonnes à chapiteaux nus adossés à de fins pilastres. Ces derniers sont réunis latéralement par des arcs qui encadrent de grandes fenêtres en plein cintre.  Le transept a son carré couvert aussi d'une imposante coupole. Il est fermé à gauche par un mur élevé dans l'ouverture de l'ancien bras Nord, tandis que son croisillon Sud s'étend sous une voûte de pierre en berceau brisé. Une absidiole existe encore sur ce croisillon, mais elle est masquée par des pans de murs provenant d'anciennes constructions où, de la Révolution jusque vers 1810, le céramiste Mouchard, le seul artiste-décorateur sur porcelaine ayant opéré en Saintonge, avait installé son usine et ses magasins. Son four situé à l'extrémité droite utilisait comme tuyau de tirage une ancienne échauguette encore visible à l'extérieur. Le chevet droit ogival est recouvert d'une voûte sur nervures avec formerets. Sa belle fenêtre axiale est aujourd'hui murée. Un chemin de ronde masqué par un exhaussement des murs fait tout le tour de l'édifice. Puisque Châtres a enfin réussi à intéresser à son sort les Pouvoirs Publics, ne pourrait-on souhaiter que soit enlevé le monceau de terre et de pierrailles qui encombre le chevet et déshonore ce superbe monument. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les églises de SAINTONGE (livre IV épuisé) édition: R.DELAVAUD (Saintes)______avec leur aimable permission_________________________
|