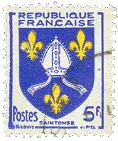|
L'église de CASTELVIEL en GUYENNE (33) (hors Saintonge mais de style saintongeais)
L'église Notre-Dame de Castelviel
Commune
du département de la Gironde ( 44°46' 06'' N, 0°05' 11'' E) L'édifice a été édifié au cours du XII e , l'abside vers 1130 et le portail vers 1150-1160. transformé au XIV. En 1867, le bâtiment a été remanié et en grande partie restauré dans la décennie 1990-2000. On est surpris de voir une très pauvre église  (la nef est large de 6.70 m et sa charpente très ouvragée, devait être destinée à rester apparente) (nef lambrissée et travée droite de chœur romanes, mur occidental et  sanctuaire carré gothiques) posséder l'un des plus somptueux et l'un des plus beaux portails de la Guyenne,  comparable aux créations les plus réussies de la Saintonge, dont il prolonge la résonance en affirmant une personnalité propre. Un large, très large et très profond portail à cinq voussures en plein-cintre y est encadré de deux minuscules fausses-portes à un seul rouleau, accentuant le contraste . L'ensemble, logé dans un massif avant-corps très saillant de 8.75 m de long sous une corniche à modillons nus, possède la majesté carrée d'un arc de triomphe antique. On songerait à la façade, semblablement assise, de Saint-Martin-de-Sescas, si la sculpture de Saint-Martin ne se contentait d'une exécution artisanale sans surprise, tandis que l'artiste de Castelvieil est touché par cette grâce indicible dont naissent les œuvres d'exception. La porte centrale fait alterner cinq larges rouleaux dont la section quadrangulaire disparaît sous l'ornementation, avec quatre voussures étroites en biseau, ou couvre-joints (cinq si l'on compte l'archivolte). Les voussures larges reposent sur des colonnettes, sauf l'intrados, reçu par les chambranles de la porte, tandis que les couvre-joints s'appuient sur les piédroits intercalaires à angles vifs. On a refait au XIX e siècle le chambranle de droite de cette porte, qui était nu, sur le modèle de l'autre. Partant de l'intérieur, on voit donc se succéder des tranches inégales de décor : tores encadrant une gorge semée de fleurettes, rinceaux vigoureux faits d'une succession de tiges végétales en S, tore entre deux gorges garnies de festons opposés par le sommet. Le portail, par sa composition recherchée et l'ampleur de sa décoration, ne déparerait aucunement un édifice beaucoup plus important. Il ne s'agit pas seulement d'un portail mais plutôt d'une entrée majestueuse composée d'un passage ouvert dans un avant-corps sous de multiples voussures en plein cintre et de deux arcades latérales aveugles de moindre développement, tous ces éléments étant abondamment couverts d'une décoration sculptée souvent historiée. Ces dispositions, qui rappellent celles d'édifices de la Saintonge, de l'Angoumois ou du Poitou, sont ici empruntées à la partie centrale d'un frontispice plus ancien, celui de la grande église de Sainte-Croix de Bordeaux érigée vers 1140, lequel, a été l'un des relais de la diffusion de ces schémas venus du nord de l'Aquitaine, non seulement vers Castelviel mais également celle de l'église de Haux ou celle de l'église de Saint-Martin-de-Sescas. Pour une partie de son iconographie, la porte de Castelviel est également tributaire de l'oeuvre bordelaise. En effet, on y découvre comme à Sainte-Croix une voussure évoquant avec les occupations de l'homme pendant les divisions zodiacales de l'année, le temps qui lui est imparti pour faire son salut. On remarque, qu'à l'imitation de Sainte-Croix, le signe du Verseau est attribué au mois de février et non au mois de janvier ainsi que c'est plus fréquemment le cas dans les calendriers du Moyen Age.  Puis vient la troisième voussure large, qui fait se succéder, à raison d'un par claveau, des hommes tirant sur une corde;  Les images sont d'une extrême précision et permettent notamment de constater que seules quelques scènes étaient déjà dégradées et que la dégradation ne s'est pas sensiblement accrue depuis lors. Comme à Sainte-Croix également, sur un autre arc, sont disposées deux files de personnages qui tirent en sens contraire sur la même corde. Cette dernière scène, que l'on retrouve à Haux et à Sainte-Croix-du-Mont, n'est pas commode à expliquer. Il ne semble pas qu'elle évoque l'action des apôtres "pécheurs d'hommes", car apparemment cette corde n'est pas un filet. On serait davantage tenté d'y voir -mais ce n'est là qu'une hypothèse - une allusion à 1' Ecclésiaste 4,12: "une corde à triple brin ne rompt pas facilement", texte parfois cité pour symboliser l'union des croyants. (Les personnages tirant sur la corde comme dans les jeux les uns à droite contre les autres à gauche représentent le choix de vie, l'homme tiraillé... voyez au sommet le visage additionnel qui s'allie avec ceux de droite) un chanfrein couvert de demi-palmettes les sépare d'une longue théorie de femmes armées, infléchies dans le sens de la courbe de l'arc; ce sont les Vertus, terrassant les Vices, illustration de la Psychomachie de Prudence. Les trois figures de la moitié gauche de l'arc sont belles, sereines dans le combat, aisément victorieuses.  Elles foulent sous leurs pieds des serpents et autres bêtes grouillantes, allégories des Vices.  Dans la partie droite de la voussure, le tassement de quatre Vertus, dont l'une ploie curieusement les jambes, la férocité plus agressive des monstres, ôtent à cette partie de la scène une part de sa monumentalité. Telle quelle, sans égaler Blasimon, cette représentation reste hautement honorable, et l'on regrette la disparition des têtes. Un étroit rouleau énigmatique, où l'on voit des lions en marche alterner avec des hommes courbés qui cherchent à leur saisir les pattes arrière, sépare la Psychomachie de la large voussure suivante, consacrée au calendrier. C'est la plus belle zone du portail et peut-être le meilleur zodiaque roman du Sud-Ouest.  Au sommier de gauche de l'arc, Janvier, mois des bombances, un homme attablé mange et boit, un Capricorne aux pieds fourchus le surmonte. On distingue la cape et sa fibule  Février, un personnage qui se chauffe, accompagné du signe du Verseau. Il montre comme à FENIOUX (17) la coiffure du sol invictus et est placé sous un dais et se chauffe comme à FENIOUX.  Mars, un vigneron taille un cep, un Bélier au-dessus.  Avril, une jeune fille (?) accompagnée du signe du Taureau.  Mai, une scène mutilée suivie de la représentation des Gémeaux.  Juin, un faucheur.  Les figures de Juillet et Août ont été martelées et sont peu lisibles;  on distingue les signes de la Vierge  et de la Balance, et un personnage qui bat le blé. Septembre, un vigneron foule le raisin dans une cuve  . Octobre, un cueilleur de fruits suivi d'un signe mutilé du Scorpion. (Non personne ne cueille les fruits assis sous un dais !)  Novembre, un homme (sous un dais) , le coutelas sur l'épaule (?), et près de lui un porc (?) pendu, le Sagittaire au-dessous.  Enfin, au sommier de droite, Décembre, un homme assis à une table.  Une chasse au cerf, une chasse au sanglier, une chasse au lièvre se répartissent l'archivolte;  un tireur d'épine s'intercale entre une femme et le porteur d'une pièce de gibier. La verve de l'imagier se donne encore libre cours sur le rouleau des fausses-portes ;  à gauche, des monstres sauteurs ( quadrupèdes) mordillent des rinceaux harmonieux sous une archivolte à palmettes (feuilles creuses ),  et à droite, deux guerriers arc-boutés, dont la courbe des corps accompagne celle du cintre, s'opposent épaule contre épaule à la clé de l'arc; c'est un morceau remarquable. L'archivolte multiplie indéfiniment de petits basilics dont la queue se retrousse joliment en palmette. La diversité des supports — grosses demi-colonnes aux bords extrêmes de l'arcature, colonnettes géminées à l'extérieur de la porte, alternance de colonnettes et de ressauts pour recevoir voussures larges et minces de l'ébrasement, pilastres enfin à l'intrados - permet d'intensifier encore la variété du décor par le nombre des chapiteaux et des tailloirs. Les chapiteaux coté gauche du portail exception faite du chapiteau rapporté ils font plutôt honneur aux femmes:  En voici, partant de la gauche, la rapide nomenclature :  1 - Le gros chapiteau, à gauche, était fruste en 1845, selon Léo Drouyn; on y a sculpté des femmes allaitant des serpents; le tailloir, ancien (seul le tailloir est authentique) , montre deux quadrupèdes bicorporés, dont les têtes occupent les angles. (la corbeille n'est qu'une copie du XIXe d'un chapiteau de l'abbaye St Nicolas d' Angers)  2 — Chapiteau double; on y voit deux hommes en lutte qu'une femme (implore) cherche à séparer, (La femme mariée tente de mettre fin à la lutte entre les deux hommes, elle est mise en valeur pour son rôle pacifiant et de résolution des conflits, remarquez les jambes en X des deux hommes)  et un joueur de viole entre une femme penchée et un chien qui saute vers lui ; d'épais rinceaux de feuillages sortent des masques d'angle du tailloir. ( l'homme coupe évidemment un pain, ainsi que le premier personnage du zodiaque au dessus. L'homme est tiraillé d'un côté par sa femme de l'autre par un mauvais conseillé qui est probablement son désir de ne pas partager, le message serait encore favorable à la femme qui incite au partage du pain car il est évident que le carnassier n'est pas bon conseiller)  3 - Jolie corbeille sous un tailloir de palmettes; on y voit deux quadrupèdes dont les queues se relèvent en fleurons, qu'un homme, dont la tête dépasse entre leurs cous, saisit dans ses mains. (Remarquez que les fleurons des extrémités des queues ne sont pas dirigés que vers le ciel _ Les aspirations profondes du personnage ne sont pas de progresser spirituellement!_ L' homme (ou la femme ?) passant la tête entre les deux quadrupèdes en saisit les queues_ c'est l'anti-maîtrise spirituelle) 
4 — Un joueur de viole et un harpiste encadrent une femme debout; les acanthes du tailloir se poursuivent sur le suivant. (Une danseuse élégante en costume typique du XII e avec les longues manchettes se tient débout les mains sur les hanches. A sa gauche un joueur de psaltérion est assis sur un tabouret. A sa droite , un homme joue de la harpe.Ces instruments n'étant pas des tambourins mais ceux utilisés en liturgie, il ne s'agit pas d'une danseuse _ elle chante plutôt qu'elle ne danse ; c'est un appel à chanter des louanges. C' est l' opposé au chapiteau de l'autre coté où Salomé la danseuse reçoit la tête de Jean-Baptiste. Rappel de l'épisode: Salomé _la fille d'Hérodiade dont Jean-Baptiste critique les meurs_ danse devant Hérode Antipas. Charmé, celui-ci promet de lui accorder ce qu'elle voudra. Sur le conseil de sa mère, elle réclame alors la tête de Jean Baptiste, qu'Hérode Antipas fait apporter sur un plateau. Ce chapiteau rappelle peut-être aux femmes de prier plutôt que de danser !)  5 - Ornée de palmettes bien équilibrées, cette corbeille aurait, selon Drouyn, peut-être été refaite avec fidélité; elle semble pourtant ancienne. (J'y voit le symbole de la féminité au milieu de feuilles orientées vers le ciel signe de vie _ vie tout court et aussi vie spirituelle d'après le contexte) ON CHANGE DE COTÉ: (d'habitude l'on trouve à droite les chapiteaux positifs et à gauche ceux négatifs mais à CASTELVIEL c'est l'inverse)   6 - Ce premier chapiteau à droite de la porte montre deux quadrupèdes assis adossés, tournant la gueule vers un gros masque humain tenant la place de la volute d'angle; de jolies palmettes leur tiennent lieu d'ailes; au tailloir, et sur les deux suivants, crossettes, et palmettes où l'on a vu, avec trop de complaisance, des fleurs de lys. (Deux lions adossés dont l'un porte encore visible des attributs démoniaques . Les ailes habituelles sont remplacées par des feuillages qui sont dirigées vers le sol Les queues également _ce n'est pas la bonne direction ! Ce personnage écoute ou adoube ses mauvais penchants!)  7 - Une femme présente à un homme une tête coupée. Il pourrait s'agir d'Hérodiade tenant le chef de Jean-Baptiste. A l'arrière-plan apparaissent des mufles de lions. (Salomé reçoit la tête de Jean-Baptiste: Remarquez l'effet de mouvement de danse dans les vêtements. Dans chaque coin de la corbeille, se trouve un masque diabolique.) La femme n'appairait plus sous un jour favorable: elle danse au lieu de louer Dieu et fait assassiner les saints !)   8 - Un roi couronné sur un trône ordonne le meurtre d'un personnage incliné vers lequel un autre brandit un glaive. Une tête de démon grimace à l'angle de la corbeille. On pourrait, vu la date tardive du portail, y voir le martyre de saint Thomas Beckett, à moins d'en lier le sens au précédent, et d'y lire le meurtre de saint Jean-Baptiste ordonné par Hérode. Les scènes se liraient alors de l'extérieur vers l'intérieur. Remarquez la figure diabolique qui tire la langue en signe de victoire!   9 — Le chapiteau double représente les Saintes Femmes au Tombeau; à gauche, l'ange, et un personnage tenant un livre. ( L'ange soulève le couvercle et montre aux trois femmes venues embaumer le corps de Jésus que le sarcophage est vide.)  10- Le dernier chapiteau à droite, chargé d'hommes et de griffons affrontés, est moderne. Les bases, qui se prolongent en stylobate, ont été largement, mais fidèlement restaurées. Ces sculptures ont toujours paru tardives à ceux qui les ont étudiées. Brutails, qui rapportait les voussures « à la fin du XII e siècle au plus tôt », à cause de la forme des écus, s'inquiétait des mentonnières des chapiteaux 2 et 9, qui lui paraissaient « à la mode parmi les contemporains de saint Louis ». On voit de ces mentonnières dès le début du XIII e siècle, période à laquelle il faudrait alors reporter ces belles sculptures, qui seraient donc l'ouvrage d'un artiste âgé et traditionaliste, mais de grand talent, qui aurait continué à travailler dans l'esthétique de Chadenac, Aulnay ou Blasimon. Mais peut-être ces chapiteaux sont-ils des réfections un peu plus récentes que le reste ? Quoi qu'il en soit, Castelvieil constitue l'une des belles pages de l'art roman tardif dans le Sud-Ouest. ____________________Fin du texte de P. Dubourg-Noves (Guyenne romane_la nuit des temps_page 297&298) Guyenne romane_la nuit des temps édition: ZODIAQUE (La Pierre-qui-vire) _______________________________ Le style des figures des nombreux ornements végétaux du portail se rapproche beaucoup de celui de Blasimon dont l'influence reste essentiel. Par exemple, dans le traitement des figures ce style est nettement caractérisé par l'allongement, lasveltesse des corps au modelé délicat mais néanmoins bien apparent. Les étoffes collent souvent aux membres pour suggérer, comme par transparence, les formes anatomiques, et à côté de ces procédés qui dérivent de ceux de la sculpture antique se remarquent des plis aux dessins et aux techniques bien romans, qui, cependant ne choquent pas car ils sont appliqués très judicieusement et avec peu de relief. La sculpture du portail de Castelviel fournit, à elle seule, un excellent exemple de l'emprise que l'art des façades de l'ouest - de la Saintonge principalement -a exercé sur une grande partie des monuments romans de la région bordelaise en se propageant en ondes successives qu'une dizaine ou une quinzaine d'années seulement séparent, à partir d'oeuvres relais telles la façade de Sainte-Croix de Bordeaux ou celle de Blasimon. A Castelviel, se fondent les deux strates d'influences, dans une réalisation ambitieuse présentant de nombreux reliefs sculptés sur lesquels les images symboliques en côtoient d'autres plus anecdotiques et voisinent également avec des motifs de pur décor, suivant des conceptions générales qui sont tout à fait celles de l'art de l'ouest, pendant toute la période romane. Des travaux récents de mise en valeur et de restauration intérieure, ont été menés en 1994 et 1995 par le ministère de la culture avec le partenariat de la commune, du département et de la région. Ils ont permis de redécouvrir, pour le plaisir de tous, une charpente moulurée de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, masquée jusqu'alors par un lambris en bois. Sol et murs, porte et vitraux ont été repris en respectant la nature historique de ce monument. Dans le retable somptueusement restauré, la présence de la toile tient du miraculeux. Elle a été retrouvée chiffonnée parmi les décombres de l'ancienne tribune et il a fallu mettre en oeuvre tout le talent du restaurateur pour la sauver de la ruine et lui redonner tout son éclat. Le paysage sonore a été gratifié d'une nouvelle cloche placée à côté de l'ancienne dans le clocher-mur à l'ouest. Dans le moule même, pour bien imprégner la matière de la cloche, le fondeur a gravé le nom du parrain, le maire de la commune et celui de la marraine, la doyenne du village alors âgée de 104 ans. Un gisant en pierre très dégradé semble garder l'entrée de l'église à droite du portail. L'imagerie populaire se plaît à voir en lui l'effigie d'un ancien glorieux Castelviellois, grand chevalier parti en 1096 pour la première croisade. Soldat anonyme ou héros oublié, ni l'histoire, ni la légende n'ont retenu son nom. _________________ Texte de Charles CONNOUË livre V épuisé CASTELVIEIL (Gironde)
Les cinq voussures de la grande baie
légèrement surbaissée sont toutes abondamment
travaillées et toutes accompagnées d'un cordon
sculpté. La troisième
voussure, renommée dans les milieux archéologiques
au même titre que la célèbre « cordée
» de Sainte-Croix-du-Mont, présente 36 petits personnages
debout, tous traités pareillement, robes et jambes
repliées sous l'intrados, tirant 18 contre 18, gauche contre
droite, sur une corde. Des feuillages en palmettes, légers mais
très fouillés, composent une fine archivolte
d'accompagnement. |