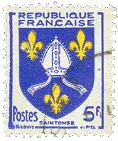|
L'église
romane de BASSAC (16)
Commune du Canton de Châteauneuf, Arrondissement de Cognac (à 9 kms au Nord-Ouest de Châteauneuf et à 20 kms à l'Est de Cognac) BASSAC Le bourg de Bassac était autrefois entouré de murailles. De plus certains de ses monuments, en particulier l'église et ses dépendances, étaient fortifiés. Tous les bâtiments attenant à l'église étaient, sur l'extérieur, dotés de moyens de défenses : meurtrières, trous à couleuvrines et à canons, que l'on voit encore aujourd'hui. Les bâtiments non attenants, mais voisins, étaient reliés à ceux de l'Abbaye par des planches, jetées des fenêtres en travers des ruelles étroites qui les séparaient. L'ensemble constituait une sérieuse organisation défensive qui joua un rôle important dans l'histoire de la région. Au XVe siècle une partie des remparts existait encore ; aujourd'hui il est possible de discerner, ça et là, quelques traces des anciens fossés de la ville. Il y avait jadis à Bassac deux églises : Saint-Nicolas, paroissiale et Saint-Etienne, abbatiale. La première complètement ruinée, et ses matériaux vendus, a disparu. La seconde maintes fois pillée, saccagée, remontée et restaurée, fait de nos jours la gloire du bourg de Bassac. Avec ses bâtiments conventuels, sa curieuse façade, son splendide clocher et les merveilles de son intérieur, elle constitue un des plus beaux groupes archéologiques et artistiques de la Saintonge, en même temps qu'un des plus riches en intérêt et en particularités-diverses. L'Abbaye de Bassac fut fondée au début du XIe siècle, en l'an 1009 précisent certains, par Wardrade ou Gardrade, comte de Jarnac et son épouse Rixendis, à la suite d'un voyage-pèlerinage, qu'ils firent à Rome. Située dans l'ancien diocèse de Saintes, elle fut d'abord rattachée à l'Abbaye de Saint-Jean-d'Angély. Des moines bénédictins y conservèrent longtemps les « Saints Liens », c'est-à-dire les cordes qui lièrent le Christ au moment de sa passion, ainsi que d'autres précieuses reliques rapportées des croisades. Toutes ont disparu. Cette noble Abbaye, richement pourvue de biens temporels, était une seigneurie véritable qui tenait ses cours de justice et disposait d'un nombreux personnel domestique. Son influence s'étendait loin aux alentours. Son passé connut des périodes de splendeur, à côté d'années de troubles et de détresse. En 1434, notamment, les Anglais l'incendièrent, détruisirent ses annexes, dispersèrent les religieux, les habitants de la petite ville et emmenèrent prisonniers plusieurs d'entre eux. En 1451, Henri de Courbon, prieur de Jarnac, entreprit de dégager les décombres et commença une restauration qui s'imposait. La longue période de tranquillité relative qui suivit la fin de la guerre de Cent ans permit de mener à bien, cette importante entreprise. Mais un siècle plus tard éclatèrent les guerres de Religion et Bassac en souffrit tout spécialement. En 1564, l'Abbaye fut attaquée par les protestants. Les moines se défendirent courageusement, mais cédèrent sous le nombre et furent finalement mis à mort. L'Abbaye disparut en partie dans d'énormes incendies alimentés par le mobilier, les boiseries, les statues, les manuscrits et les reliques. Cinq ans plus tard, ce qui avait échappé à la destruction subit de nouvelles violences. C'est, en effet, en 1569 qu'eut lieu la fameuse bataille, dite de Jarnac, qui se passa en fait à Bassac et dans ses environs et au cours de laquelle fut tué Louis de Bourbon, prince de Condé. Le combat s'engagea aux portes mêmes du monastère, alors occupé par les calvinistes, pour aller s'achever sur les bords de l'étang de Triac, où le chef des armées protestantes trouva la mort « lâchement assassiné, dit D. Massiou, citant de Thou, d'une pistolade par la tête ». Longtemps l'Abbaye abandonnée demeura à l'état de ruines ; puis vers 1666, les Bénédictins se remirent au travail. Les murs remontés, les voûtes rétablies (elles portent les dates de 1677 et i683) reconstituèrent l'important édifice que nous voyons aujourd'hui. Les boiseries, les stalles, le jubé, le rétable suivirent et furent l'œuvre d'une autre période qui s'étendit jusqu'au XVIIIe siecle et s'avéra particulièrement active de 1699 à 1710. Les bâtiments annexes réédifiés, tels qu'ils existent de nos jours, permirent la reprise de la vie communautaire. Elle dura peu, la Révolution, supprimant les vœux religieux, l'interrompit brutalement, dispersa les moines et vendit par lots une partie des bâtiments à des particuliers. En 1895, un séminaire s'installa dans ce qui restait des locaux utilisables, mais l'entreprise n'eut qu'une existence éphémère et le monastère connut à nouveau une longue période de total abandon. Réparé enfin et restauré en 1947, il abrite aujourd'hui les Missionnaires de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Le splendide ensemble architectural que forme Bassac, ensemble d'une beauté rarement égalée, permet au Touriste d'admirer en même temps: un clocher de la seconde moitié du XIIe siècle ; une église du XIIIe, à citer parmi les plus remarquables de la Saintonge ; un cloître curieux et enfin une collection de détails magnifiques.  Le clocher attire tout d'abord le regard. C'est une superbe construction carrée élevée et très ornée qui présente au-dessus de sa souche, trois étages à retraits successifs percés d'ouvertures en plein cintre de formes diverses, mais toujours élégantes et harmonieusement disposées. Il se termine par une très belle flèche conique à écailles accompagnée à sa base de quatre pyramidons en pierre pleine. La façade retient ensuite l'attention. Elle est particulière d'aspect. Deux gros contreforts à angles évidés et ornés de colonnes l'encadrent. Ces contreforts sont surmontés, à hauteur du pignon, d'échauguettes à meurtrières et trous à couleuvrines. Son rez-de-chaussée s'orne d'un portail en plein cintre et de deux baies aveugles. Le portail compte quatre voussures amorties en tore sauf la plus petite qui, découpée en lobes, indiquait aux pèlerins de Saint-Jacques que là existait un relai à leur usage. Des chapiteaux à feuillages garnissent les pieds-droits. L'arcade de gauche est surmontée d'une niche du XVe siècle, polylobée également.  Un épais bandeau souligne l'étage et porte cinq longues baies disposées 2, 1, 2, du même style que le portail. Toutes sont aveugles, sauf la centrale, plus large et plus haute. Le pignon est percé de meurtrières. Il y a lieu de remarquer, dans l'étroit espace enclos à gauche, un élégant petit ensemble de pierre, composé d'un cône à écailles porté par six ou sept colonnettes très rapprochées ; c'est un des clochetons d'angle qui accompagnaient anciennement la flèche du cloher. A droite et en avant de la façade s'ouvre une belle porte du XVIIIe siècle suivie d'un long couloir voûté débouchant dans la cour de l'ancien cloître, au centre de laquelle se voit un vieux puits. Les fenêtres qui éclairent ce passage sont, pourrait-on dire, des fenêtres de combat. Murées à mi-hauteur, elles sont garnies, à l'intérieur, de marches à l'usage des tireurs. D'autres fenêtres de guet ajourent le pignon obtus du chevet ; elles éclairent une vaste salle de garde qui, par un chemin couvert, communiquait avec les fortifications de la façade. L'intérieur de l'église, forme un rectangle de 135 mètres de long, divisé en quatre travées égales, séparées par des arcs en tiers-point, relativement bas. portés par des groupes de fines colonnes. Elles sont couvertes de voûtes en ogive avec liernes et formerets. La disposition des clés plus élevées que le sommet des doubleaux (style Angevin) accroît très sensiblement l'ampleur du vaisseau. Un jubé de pierre et de marbre le sépare en deux parties égales ; en avant la nef proprement dite ; au delà le chevet qui se révèle magnifique, aussi bien dans son ensemble que dans ses détails. Le chœur est garni sur les côtés de quarante stalles en bois merveilleusement ouvragées. Tout est sculpté : consoles de séparation, miséricordes, dais, panneaux, fronton, etc... Des cariatides et des paniers de fleurs méritent une mention particulière et constituent autant de remarquables œuvres d'art. De même le lutrin avec son aigle éployé, pièce rare et peut-être unique en France. D'autres magnificences sont encore à citer et parmi elles : le rétable avec pilastres cannelés, chapiteaux corinthiens et tableaux ; l'autel à colonnes de marbre ; le tabernacle d'ébène ; la frise de pierre ornée d'arabesques d'une étonnante délicatesse. Enfin, des médaillons et des statues. Toute cette précieuse décoration a été exécutée par les moines de l'Abbaye. A gauche de la troisième travée deux baies en plein cintre donnent accès à deux petites chapelles, dont une située sous le clocher est couverte d'une coupole sur pendentifs. Des fenêtres en tiers-point et une grande verrière flamboyante, ajoutent à cet extraordinaire ensemble les notes chaudes et chantantes de vitraux aux tons vigoureux. D'autres vitraux modernes, mais très remarquables, sont à voir dans le petit oratoire aménagé dans l'une des salles qui occupent aujourd'hui les galeries couvertes de l'ancien cloître. Dans la nef à droite, se dresse sur un haut piédestal, une statue du patron de l'ancienne église saint Nicolas. Les pieds de cette statue ont été usés et « grignotés » au cours des ans par les ongles des jeunes filles qui, pour se marier dans l'année, devaient venir gratter les pieds du Saint. Bassac, a été classée parmi les Monuments Historiques dès 1880. ____________________Fin du texte de Charles CONNOUË Les
églises de SAINTONGE édition: R.DELAVAUD (Saintes) avec leur aimable permission._______________________________ |