|
Ci-dessous
voici la publication presque intégrale
de
M Jacques TERRISSE
article
paru dans le cent soixante quatorzième volume des travaux de
l'académie
nationale de REIMS dont il est membre titulaire
(Rèmes:
habitant de
l'antique région de REIMS)
"LE
DIEU A TROIS TÊTES DES RÈMES
le
TRICÉPHALE"
par Mr Jacques TERRISSE.
Les tricéphales,
quelquefois appelés "trifrons". sont des sculptures ou
peintures
représentant des personnages humains dotés de
trois têtes partiellement
fusionnées, d'où leur nom. Ces
représentations sont de toutes les
époques depuis les Étrusques au moins
jusqu'à nos jours.
(...)
L'inventaire succinct qui
suit
mettra en évidence le foisonnement et l'extrême
dispersion géographique
et chronologique.
On peut
distinguer deux types
principaux courants, avec toutes sortes de différences de
détail :
- la première forme présente trois visages
fusionnés, un vu de face, un
tourné vers la gauche et un vers la droite, si bien qu'en
les
regardant, on ne voit que deux yeux. Les trois visages sont
très
ressemblants l'un à l'autre. Dans une variante
très répandue, les
figures latérales sont en oblique, si bien que quatre yeux
sont
visibles.
- un deuxième modèle possède les trois
têtes séparées mais
attachées à
un seul corps. Les visages peuvent alors être très
différents l'un de
l'autre. Une variante fréquente dans l'antiquité
consiste à répartir
les trois têtes autour d'une colonnette, surmontant un corps
unique
plus ou moins esquissé.
- parmi les genres plus rares on voit par exemple associer trois
têtes
dessinées tournant dans un cercle à 120°
l'une de l'autre, la barbe de
chaque personnage servant de cheveux au suivant, etc...
De nombreux auteurs se sont attaqués à ce
problème :
- d'un côté, on trouve les archéologues
et les historiens de
l'antiquité (HATT, S.REINACH, DE VRIES, DUMEZIL, MOINE
etc..) qui
s'attachent à trouver un sens aux nombreuses
représentations
tricéphales gallo-romaines qui forment un ensemble
très important,
- d'un autre on a les spécialistes du symbolisme
médiéval ou de
l'iconographie religieuse (E.MALE, BOESPFLUG etc..) qui cherchent une
lecture spirituelle,
- s'intéressent aussi à la question des personnes
qui y voient des
symboles initiatiques, maçonniques ou templiers (le
Baphomet), ou se
servent du thème pour appuyer ou illustrer des
idéologies de type
occultiste ou anti-chrétien, par exemple les
Témoins de Jéhovah dans
leur argumentation anti-trinitaire.
L'inventaire chronologique qui va suivre n'est pas exhaustif,
simplement il énumère un certain nombre de
modèles sur lesquels il a
été possible de trouver des documents de
qualité suffisante.
(...)
L'époque
gallo-romaine siècles I et II
A partir du premier siècle de notre ère, on
assiste à un foisonnement
de modèles, d'abord dans le pays Rémois, puis
tout au long du réseau
routier "AGRIPPA", de TRÊVES à NIMES. Ces
sculptures, très généralement
en pierre, exceptionnellement en céramique (BAVAY) ou en
métal (bronze
d'AUTUN) sont les survivantes d'une très vaste production,
tant à
l'époque de l'indépendance que durant l'Empire,
et dont les
réalisations, qu'on peut supposer majoritairement en bois,
ne nous sont
pas toutes parvenues. Quelle que soit l'interprétation
donnée par les
chercheurs, tous y voient une représentation religieuse.
Le tricéphale type des productions
Rèmes
est un parallélépipède de pierre,
d'environ 20 à 25 cm de haut, un peu
moins de large et 10 d'épaisseur. C'est donc un petit objet,
le plus
grand, exceptionnel, est celui de SOISSONS qui atteint environ 35 cm de
haut. La petite taille de ces sculptures fait penser
à
une utilisation religieuse familiale plutôt que publique. Le
catalogue ESPERANDIEU en décrit une demi-douzaine, presque
identiques,
rien que pour REIMS même (3651, 3652, 3654, 3656, 3657, 3658,
3659)
entiers ou endommagés.Dans ces blocs, l'image
tricéphale se présente de
face.
Le visage est toujours
garni de
moustaches, barbu ou non. On ne voit que deux yeux. Les
côtés sont
décorés de motifs divers : figures normales,
couteaux etc.. la partie
supérieure est surmontée d'un animal, un
bélier la plupart du temps
(coq à SOISSONS). Ces décors annexes sont
utilisés par certains auteurs
(Mme MOINE par exemple) pour identifier le sujet.
A REIMS, on trouve également un très beau pilier
à trois faces (ESP
3655). d'autres, plus frustes, proviennent de tout le pays
Rème : REIMS
(3661 - 3745), BRIMONT(3751), NIZY-LE-COMTE (3762), BROUSSY et AY.
Les vitrines de la grande salle gallo-romaine du
rez-de-chaussée et de
la salle celtique du 1° étage du Musée
Saint Remi présentent la plupart
de ces oeuvres.
Un bloc (ESP 3756) taillé provenant de LA MALMAISON,
près de LOR,
c'est-à-dire des confins Nord du pays Rème,
montre les trois visages de
trois-quarts, et représente en quelque sorte
l'intermédiaire entre le
modèle classique et celui sur colonnette. Au
Musée des Antiquités
Nationales à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
La densité particulièrement forte des trouvailles
à REIMS et dans les
environs proches fait évidemment penser à une
origine Rème du thème.
Mais le manque de précision des datations est
extrêmement gênant : il
faut dire que presque tous ces blocs sculptés ont
été trouvés au 19e
siècle, au hasard des travaux de construction, en
particulier dans les
quartiers nord de REIMS, hors contexte archéologique. Les
datations ne
peuvent donc se baser que sur des critères stylistiques, par
exemple la
présence de barbes ou la manière de dessiner les
yeux, ce qui laisse
une marge d'imprécision trop grande.
Au
nord de REIMS, en pays Nervien, à
BAVAY (et aussi à TOURNAI et L1BERCHIES en Belgique), on
trouve des figures tricéphales en appliques de vases.
Ce
système d'appliques à motifs religieux
indigènes semble être une
spécialité de la région et peut
concerner d'autres thèmes comme celui
de MERCURE (vase de SAINS DU NORD près d'AVESNES par
exemple). On
constate, dans ces réalisations Nerviennes une nette
différence d'avec
les modèles Rèmes : en effet les visages sont
assez nettement séparés,
collés l'un à l'autre plutôt que
fusionnés. De la sorte, quatre yeux
sont visibles.
En dehors du pays
Rème et Nervien,
presque toutes les trouvailles s'éparpillent au long du
réseau routier
stratégique et commercial (Voie AGRIPPA) qui
s'étend de la vallée du
Rhône à la Germanie d'un côté
et à la Manche de l'autre : de TRÊVES à
NIMES. Celle dispersion est généralement
interprétée comme une
diffusion à partir du pays Rème.
Ce sont en général des
modèles très
classiques, comme celui de TRÊVES (ESP 4937). METZ (ESP
7234), des deux
de LANGRES (ESP 3287 et un non répertorié).
A COLOGNE, il s'agit d'un petit vase à trois têtes
réparties autour de
la circonférence, très différent comme
style des céramiques nerviennes.
Le Musée des Antiquités Nationales
possède un modèle très voisin,
d'allure et de taille, mais en verre (provenance non
signalée).
Les modèles Eduens des Musées d'AUTUN (ESP 2131-
Provenance DENNEVY en
Saône-et-Loire), de BEAUNE (ESP 2083) et de
NUITS-SAINT-GEORGES (Les
Bolards), se présentent tous trois sous la forme d'un groupe
de trois
personnages dont l'un est tricéphale. Le groupe des BOLARDS
est
complété par des animaux dans la partie
inférieure : taureau, cerf,
sanglier etc... de véritables miniatures, en rapport avec la
petite
taille de l'ensemble (environ 30 cm de haut).
Un autre provient d'ETANG-SUR-ARROUX
(Saône-et-Loire, région d'AUTUN) mais se voit au
Musée des Antiquités
Nationales à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Il s'agit d'une
très petite
statuette de bronze montrant un personnage assis en tailleur. De chaque
côté de sa tête se trouvent deux autres
visages nettement plus petits.
Le sujet principal se rapporte donc au "DIEU ASSIS EN TAILLEUR" que
certains chercheurs considèrent comme une entité
particulière dont il
existe plusieurs modèles (Dieu de BOURAY dans l'Essonne,
Dieu
d'EUFFIGNEIX en Haute-Marne, un autre à
ST-MARCEL-ARGENTOMAGUS dans
l'Indre, au moins un personnage du laineux CHAUDRON de GUNDESTRUP
assimilé à CERNUNNOS. cl derrière lui
les autres CERNUNNOS de REIMS et
de VENDOEUVRES dans l'Indre etc...
Au M.A.N. se trouve également un modèle
très fruste provenant de
Bourgogne sans autre indication et de datation très floue.
De la région de NIMES provient un très beau
modèle (ESP 2668) figurant
dans les collections du Musée de LYON.
En dehors de cette voie AGRIPPA, les découvertes sont rares :
- A PARIS, au Musée Carnavalet,
un
exemplaire qui a peut-être appartenu au PILIER DES ARMES DE
MARS.
- Au Musée de BORDEAUX, un modèle provenant de la
Dordogne
(CONDAT-sur-TR1NCOU) avec trois têtes assez bien
séparées, le
personnage unique étant doté du torque,
- A AUCH(ESP 1055)
- A CABAZAT (Puy De Dôme) où la figure centrale
est féminine, ce qui
est exceptionnel.
Dans d'autres catégories d'objets, deux figurations
tricéphales sur
intailles, d'origine romaine ou gallo-romaine, sont
signalées, mais
sans indication de dates ou de provenances, l'une ayant
été réutilisée
comme sceau par THIBAUD DE NAVARRE vers 1245, l'autre étant
d'un modèle
"tournant".
Pour ces
tricéphales antiques, les commentateurs et
analystes se répartissent en quatre courants :
Les deux premiers groupes pensent que l'aspect triple de la
tête est
une manière un peu originale d'exprimer le superlatif, la
puissance, le
chiffre 3 étant, dans beaucoup de cultures, le symbole de la
grandeur.
- les uns (S. REINACH, N. MOINE etc...), s'appuyant sur certaines
décorations annexes, pensent qu'il s'agit d'un MERCURE local,
- les autres (DE VRIES. S. DEYTS etc...) estiment qu'il peut s'agir de
n'importe quelle divinité.
A l'appui de celte idée générale de
puissance, s'inscrivent les
représentations où figurent des groupes de trois
animaux identiques
(les grues du PILIER DES NAUTES à PARIS par exemple), des
taureaux à
trois cornes etc...
Par contre. DUMEZIL considère qu'il s'agit de l'expression
des trois
pouvoirs tels qu'il les a distingués dans le monde
indo-européen, et
particulièrement dans les cultures celtes : pouvoir royal,
sacerdotal
et économique.
Enfin, pour J.J.HATT le tricéphale représente,
soit Trois personnages
divins associés dans un mythe commun, soit le même
personnage dans
trois étapes (avatars au sens hindou du terme) d'un parcours
mythique
personnel, ou un mélange des deux.
Du
troisième au XI e siècle:
Après le troisième
siècle, on constate une absence
presque complète du thème dans nos
régions pendant environ un millénaire,
aussi bien dans la sculpture que dans les dessins et peintures, par
exemple on n'en trouve nulle part dans les manuscrits carolingiens. Ne
font exception que deux spécimens qu'on peut classer dans la
bijouterie
:
Le petit personnage
à trois têtes
figurant sur une des CORNES DE GALLEHUS (Slesvig) date probablement du
début du Ve siècle de notre ère, cette
datation étant tirée de l'étude
de l'ensemble du décor de ces cornes. Mais aucune conclusion
définitive
ne peut être établie par suite du vol et de la
fonte en 1802 de ces
objets en or.
Un peu plus tard (VIe/VIIe siècles) se situe une boucle de
ceinture
mérovingienne en bronze publiée par MOREAU et
provenant du site du
MOULIN DE CARANDA, commune de CIERGES dans le Tardenois.
De date assez imprécise, mais antérieures
à la christianisation qui
s'étend dans l'Est de l'Europe à partir des
IXe/Xe siècles, sont les
sculptures slaves à trois faces identifiées
tantôt au dieu TRIGLAV et
dont on trouve des représentations en Bulgarie (PLOVDIV), en
Ukraine
(IVANKOVSKY) et beaucoup plus au nord à STETTIN, et
tantôt au dieu
SVENTOVIT (Pologne). Cela prouve au moins que cette tradition
iconographique n'est pas limitée au monde celte, bien
qu'elle y soit
particulièrement répandue.
A
partir du XII e siècle:
A partir du XII e siècle et de l'extension de
l'art
roman, les modèles se multiplient dans toute l'Europe de
l'ouest.
La
fresque de GURK en Carinthie
(Autriche) attribuée au XIIIe siècle, est d'un
modèle tournant.
Des sceaux tricéphales apparaissent en Angleterre au XIIe
siècle, et la
Trinité chrétienne dans des illustrations (BIBLE
MORALISES 1226). A la
fin du XIIIe siècle, le HORTUS DELIC1ARUM, manuscrit
alsacien bien
connu, présente une Philosophie coiffée d'un
casque à triple tête. A
peu près à la même époque,
à ROUEN, à la fontaine des
Évèques de
Lisieux, le triple casque devient une triple tête.
Une
certaine confusion règne dans les datations des sculptures
et
décorations secondaires des églises romanes, car
beaucoup de celles-ci
ont été fortement restaurées
après la Guerre de Cent Ans. En effet, les
églises des XIe et XIIe siècles
équipées à l'origine pour leur presque
totalité de plafonds horizontaux de bois,
incendiés ou au moins
endommagés par suite d'un siècle de combats et
d'abandon, ont été.
lorsque les moyens locaux le permettaient, dotées de
voûtes de pierre
lors de leur reconstruction. Il faut donc reporter
à la
période 1450/1550 tout ce qui se rapporte à ces
voûtes nouvelles :
nervures de soutien, corbeaux d'appui, colonnes
supplémentaires et
d'une manière générale tout le
décor des parties hautes : modillons,
frises etc... Le même raisonnement peut s'appliquer aux
bas-côtés de
certaines grandes églises, construits en
matériaux légers à l'origine
et reconstruits en dur aux XVe & XVIe siècles avec
voûtes,
colonnes d'appui, contreforts etc...
Parmi les
tricéphales attribués au XIIIe siècle,
mais douteux, et ceux nettement placés au XVIe, on trouve un
très grand
nombre de petites pièces de sculptures : corbeaux,
modillons,
chapiteaux par exemple. La liste est longue. A noter que c'est
seulement à cette époque que se
généralisent les modèles à
4 yeux,
rares à l'époque gallo-romaine.
Dans la
région : NOTRE DAME EN VAUX à
CHALONS, églises de TAGNON, LEFFINCOURT, NESLES le REPONS
(1518), St
AMAND sur FION, POISSONS (Hte Marne 1530), plus loin CLUNY, St JEAN de
LOSNE (Cote d'Or), MIEGES (Jura -1603), Hôpital de DOLE,
ANGERS (un
modillon à la Cathédrale et un chapiteau
à ST-NICOLAS), Cathédrale de
VANNES (1517). Cathédrale de BAVEUX. OLORON-STE-MARIE. etc...
Il est évident, si on considère l'emplacement de
toutes ces pièces, qu'elles
ne représentent que des thèmes mineurs et ne
peuvent en aucun cas être
considérées comme des images trinitaires.
Détail
singulier, ces sculptures sont à peu près toutes
placées sur le côté
nord (gauche) des églises.
En même temps que les modèles en pierre, on
trouve des
quantités de tricéphales en bois,
dans les sculptures
dites "gothiques" réalisées après
1440, pour l'essentiel
des miséricordes de stalles,
particulièrement groupées
dans le secteur Alsace du sud -Franche-Comté - Suisse
occidentale -
Savoie : Église ST-THIBAUT de
THANN - 2 ex
(1441). Cathédrale de SAINT-CLAUDE (1465),
Cathédrale de
SAINT-.IEAN-DE-MAURIENNE ( 1498), Collégiale de CUISEAUX
(Saône-et-Loire - Fin 15e), SAINT-POL-DE-LEON (1512),
Collégiale de
CHAMPEAUX (Seine-et-Marne -1522), Cathédrale de LAUSANNE,
Église
ST-LAURENT à ESTAVAYER-LE-LAC (Suisse - 1525),
Église des Dominicains à
COPPET (Suisse - 1525). ST-GERVAIS (PARIS - 1550), Chapelle du
château
d'USSÉ (1645) etc... I1 est
évident que le
thème ne représente alors aux yeux des sculpteurs
rien de très glorieux
et certainement pas la Trinité chrétienne. Mais
cela ne veut pas dire
qu'il se fasse n'importe quoi : là aussi, on note que les
miséricordes
à tricéphales se trouvent à peu
près dans tous les cas dans les stalles
nord, côté gauche du choeur .
Autres que les miséricordes, mais toujours dans le
même contexte des
stalles gothiques en bois et toujours au nord, on trouve des
décors
d'accoudoirs ou de fin de rangées (LAUTENBACH,
près de THANN - 1466).
A l&exception de la miséricorde de PARIS-ST-GERVAIS
qui
est un tricéphale tournant, tous sont du modèle
le plus classique en
majorité à deux yeux, un peu moins
fréquemment à quatre. Les
ressemblances entre certaines réalisations d'artistes
différents font
penser à des carnets de croquis circulant dans les ateliers.
Aucune
trace de ces cahiers ou carnets n'a cependant été
conservée. Les
archives anciennes du Compagnonnage ont disparu au début du
XIXe siècle.
Fin
du Moyen-Age
A la
fin du Moyen-Age, dans la décoration des
édifices religieux, les tricéphales n'ont
probablement représenté dans
le foisonnement des modèles, qu'une bizarrerie de plus,
tolérée par
l'Église parce que finalement dénuée
de signification inquiétante.
Dans les illustrations de manuscrits, il peut en être
différemment : le
Lucifer de l'HISTOIRE DU SAINT-GRAAL (15e) est un démon
à triple
visage, cette vision remontant au moins à ORIGENE et
peut-être avant.
A l'inverse,
à partir du début du XVIe siècle, on
voit apparaître de nombreux personnages
tricéphales franchement
trinitaires : le plus ancien et le plus typique se
trouve dans une gravure du "MISSEL DE VERDUN" datée de 1509
et recopiée
en de nombreux exemplaires, tant sur d'autres ouvrages
imprimés ou
xylographies que sur des panneaux sculptés (porte
à BORDEAUX).
Peu après, les images trinitaires se
multiplient sur les
vitraux, et cette fois à des endroits et suivant des
modalités ne
laissant aucun doute : NOTRE-DAME-EN-VAUX
à CHALONS (1527). MESN1ERES-EN-BRAY (Seine-Maritime - 1550),
AMBRONAY
(Ain) etc... Le symbole est si évident que des artistes
dessinent des
anti-trinités également tricéphales
(Mathias GRUNEWALD - 1523).
Plus tardives sont les peintures, généralement en
zone germanique :
Alsace (KAYSERSBERG), Allemagne, Autriche (SALZBOURG).
Au
XVII et XVIII è condamnations
Les représentations trinitaires de ce type,
considérées par certains
théologiens comme impossibles dans la nature et donc
monstrueuses, vont
être interdites par URBAIN VIII en 1628. cette condamnation
étant
confirmée par BENOÎT XIV au milieu du
18è siècle.
Ailleurs
et plus loin encore
Hors d'Europe, et à des dates telles que tout contact avec
les cultures
occidentales chrétiennes semble exclu, on trouve quelques
réalisations
en Amérique précolombienne : un pectoral maya en
jade du 9è siècle et
un vase Zapotèque du 13è (OAXACA).
Une tradition hindouiste et bouddhiste semble s'être
répandue en
Extrême Orient à partir du 8è
siècle (TRIMURTI de la Grotte des
Eléphants à BOMBAY), puis du 13è
(Cambodge), du 15è (Tibet). S'inscrit
dans cette tradition le dieu ASHURA du Japon. Dans tous ces
modèles
asiatiques, les têtes sont juxtaposées,
accolées, plutôt que
fusionnées, mais portées par un corps unique. De
nombreuses sculptures
similaires à quatre têtes voisinent avec celles
à trois, si bien qu'on
peut se demander si, dans cette aire de culture il ne s'agit pas du
même symbole.
Le problème reste posé, car il n'est
véritablement résolu par personne,
de savoir si le tricéphale est une variante du
bicéphale, ou bifrons,
type JANUS, ou s'il est véritablement quelque chose d'autre.
La même
question reste non résolue aussi pour les modèles
à quatre visages, en
particulier en Extrême-Orient. Par contre, les
très rares exemples à
quatre visages (miséricorde de stalle à ZURICH -
fin 14è) dans nos
régions peuvent être
considérés comme des variantes accidentelles d'un
tricéphale dont la signification symbolique
s'était perdue et qui
n'était plus qu'un modèle de sculpture comme un
autre.
Parmi les représentations n'ayant pas de
caractère religieux, direct ou
non, les plus anciennes semblent être celles de PISANELLO. La
première,
un dessin à la plume, daterait de 1440/50 et se trouve au
Louvre.
L'autre est un revers d'une médaille à l'effigie
de LIONEL D'ESTE
antérieure à 1443, car reproduite à
cette date par le peintre BADILE
dans une fresque d'une église de VERONE.
LE TITIEN (1565) réalise un tableau assez curieux avec les
trois âges
de la vie d'un homme (National Gallery - LONDRES) où les
trois têtes
humaines accolées sont accompagnées d'autant de
têtes d'animaux
symboliques : un lion de face, un ours à gauche et un loup,
ou un chien
à droite. Suivant l'expression de BALTRUSA1T1S, "c'est un
essaim de
gueules et de visages enchevêtrés". Le tableau est
assez bizarrement
considéré comme une "allégorie de la
Prudence".
Au 19è siècle, DAUMIER, dans la foulée
de ses "poires"
anti-louis-philippardes, exécute une caricature assez
drôle : une tête
à trois visages très piriforme et fort
ressemblante.
Le thème de la fusion des visages a
été repris récemment par COCTEAU,
puis par une société de formation et de gestion
de ressources humaines.
Plus près de nous encore (1987) Henri de MONTROND a
symbolisé de cette
manière l'unité des trois races humaines dans un
dessin destiné à
illustrer la Fête de Pentecôte dans le Missel des
Dimanches de 1987.
Une autre version a été
créée par cet artiste en 1990.
CONCLUSION
Que dire en conclusion de cette brève évocation,
sinon que nos ancêtres
nous ont laissé là une bien belle image toujours
actuelle et toujours
chargée de nouvelles significations. Peu de
thèmes graphiques ont eu
cet honneur.
et
voici des
trifrons du XIII è

BM
Beaune
ms0039f002 Psautier 13e
Envois de Mr
Michel Terrier qui chasse les trifrons lièvres
|

Trifrons
de REIMS Faubourg de Laon:
(II è siècle)
(2
yeux partagés) Photos J Terrisse

Trifrons de
REIMS (II è siècle) (2
yeux partagés)
Voici
un Trifrons photographié sous
remontrances justifiées au musée gallo-romain de
LYON:

Trifrons
originaire de Nimes au musée de LYON (4 yeux
partagés), II è siècle.
Deux des
visages sont barbus et la couronne est faite de torsades de baies de
lierre.

Cul de lampe
trifrons à
NESLES-le-REPONS (Marne)
Photo
J.Terrisse.
____________
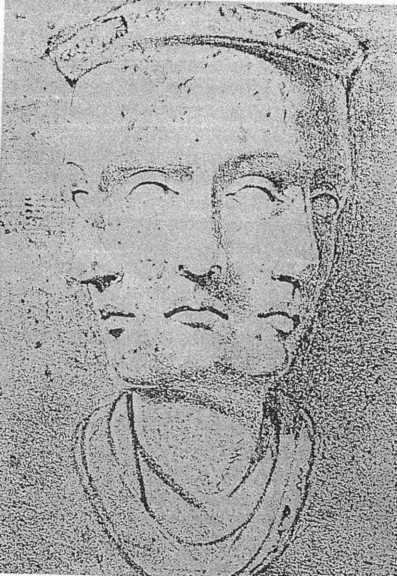
Trifrons
collégiale N-D en VAUX
achevée en 1217 à CHALONS-sur-MARNE, XIIe/XIIIe
Photo
J.Terrisse.

PISANELLO -
Médaille de Lionel d'Esté
1443
Photo
Rizzoli source J Terrisse.

Miséricorde
de stalle située au
milieu du rang haut coté sud datée de 1465 dans
la cathédrale St Pierre
de SAINT-CLAUDE (Jura)
envoyé
aimablement par Mme Véronique
Blanchet-Rossi - Archiviste à St CLAUDE
Toutes
les miséricordes sont
sculptées la liste des détails à:
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-36-11758-81687-P68768-201730.html

Christ
trifrons sur un vitrail de CHALONS-sur-MARNE, XVIe siècle
(1527),
église N-D-en VAUX
envoyée
par Mr
Ravaux Jean-Pierre.
Voici une
icône TRIFRONS

Icône
église
St Quiriace de PROVINS XVIe siècle.
Source Internet
Voici un
TRIFRONS espagnol

Modillon
à
ARTAIZ (Espagne) envoyé par Mr Emmanuel Pierre.
et un à Vitré (35) sur la chaire façade Sud.
 
Envoie de M Buno Lysée
|
___Quatre
yeux __Incarnation













